Timothy Findley
Le Dernier des fous (The Last of the Crazy People)
traduit de l'anglais (Canada) par Nadia Akrouf
Préface de Daniel Arsand
chez Libretto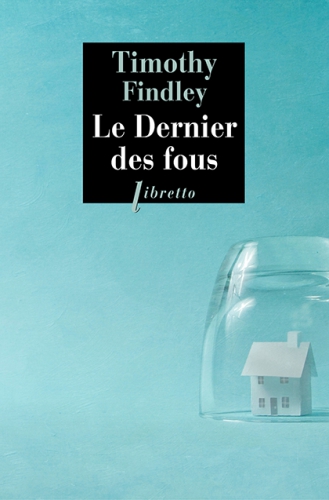 Il s'agit de la réédition du premier roman de cet écrivain disparu en 2002. Le Dernier des fous parut en France en 1967. La présente édition poche, est accompagnée d'une préface de Daniel Arsand qui prévient : « l'essai n'est pas qu'un coup de maître, mais la pierre angulaire d'une œuvre complexe, à la fois fluide et labyrinthique, chatoyante et violente ». Ce qui définit ainsi toute l'œuvre convient aussi pour ce seul roman. Fluidité du récit, labyrinthe des atermoiements dans l'esprit des personnages, chatoiement des des scènes, c'est-à-dire variété des rythmes, des genres (dialogues, descriptions des paysages), et violence enfin, sidérante (et presque apaisante).
Il s'agit de la réédition du premier roman de cet écrivain disparu en 2002. Le Dernier des fous parut en France en 1967. La présente édition poche, est accompagnée d'une préface de Daniel Arsand qui prévient : « l'essai n'est pas qu'un coup de maître, mais la pierre angulaire d'une œuvre complexe, à la fois fluide et labyrinthique, chatoyante et violente ». Ce qui définit ainsi toute l'œuvre convient aussi pour ce seul roman. Fluidité du récit, labyrinthe des atermoiements dans l'esprit des personnages, chatoiement des des scènes, c'est-à-dire variété des rythmes, des genres (dialogues, descriptions des paysages), et violence enfin, sidérante (et presque apaisante).
Nous sommes dans les années 60, non loin de Toronto, dans une belle maison de la classe aisée. La famille Winslow est en apnée. Le père, Nicholas, les deux fils, Hooker et Gilbert, une belle-sœur, Rosetta, et la bonne noire, Iris, vivent suspendus aux bruits de sonnettes ou du loquet d'une chambre de l'étage occupée par la mère, Jessica. Après plusieurs crises sporadiques au fil des ans, et depuis son retour de l'hôpital où elle a accouché d'un enfant mort-né, la recluse a définitivement sombré dans la folie. Elle ne supporte pas de voir ses enfants qu'elle déteste, elle ne descend presque plus au rez-de-chaussée, ne s'intéresse qu'à ses prières et ses chapelets. Une intrusion ou un mot de trop et sa démence jette les témoins dans la terreur.
Peur, menaces, cris, silences, le dérèglement psychique de la mère instille le mal dans le quotidien de tous les habitants de la maison. La folie impose sa respiration, son rythme cardiaque, personne n'y échappe, elle semble se propager depuis le seuil de la chambre maternelle, hanter les esprits des voisins et de la ville. Le témoin principal de cette emprise délétère est Hooker, le plus jeune des garçons, il a bientôt onze ans. L'été, il s'occupe en enterrant, dans un petit cimetière personnel, les proies que ses nombreux chats lui rapportent, ou bien il grimpe sur les genoux d'Iris, écoute ses chansons et les histoires d'amours tragiques qu'elle raconte, essaye de discuter avec son poète de frère, part se promener avec Iris quand l'heure est venue (et elle est venue quand Jessica se met à hurler, que le père essaye de la calmer, que les murs tremblent).
Qui pourrait pulvériser cette prison de silences et de paroles manquées, qui a ce pouvoir de délivrer les fous de leur aliénation ? Le dernier d'entre eux, sans doute. Dès le prologue, comme il est évident qu'on assiste à l'amorce d'une tragédie, la conclusion n’est pas bien mystérieuse, on sait bien que la violence aura le dernier mot, on prend même assez vite connaissance de qui nouera le drame et comment. L'intérêt du roman n’est donc pas tant dans son dénouement que dans la minutieuse description de l'enfermement des êtres dans leur cage microscopique, protection trompeuse qui enferme le Verbe, retient les gestes et les réduit aux comportements élémentaires que la société veut bien autoriser : fumer une cigarette, rentrer du travail et accrocher un pardessus, manger, acheter, paresser, boire. Dès que l'un ou l'autre membre de la famille est au contact avec la raison des autres, avec la norme des autres, les saillies blessent, les boussoles s'affolent, des gestes incompréhensibles sont générés. La maison des Winslow est le refuge en même temps que le piège. Le jeune Hooker, comme les autres, qu'il soit innocent ou pas, qu'il soit naïf ou perspicace, est pris dans la toile remarquablement tissée par Timothy Findley, touche par touche, dialogue après dialogue, image après image. Engrenage implacable. Le lecteur attend l'explosion inévitable qui mettra un terme à cette terrible mécanique du mal.