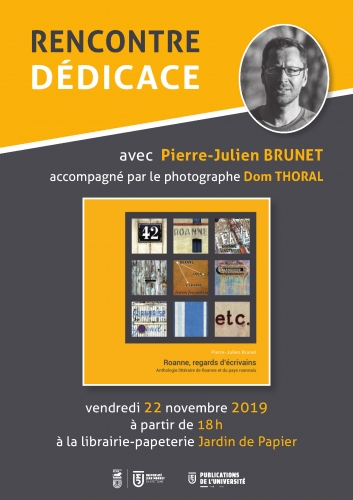J'écris ce billet sans avoir l'ouvrage sous la main, et je ne pourrai donc pas citer les nombreux passages que j'avais soulignés. Pourquoi ? Parce que, aussitôt refermé, je l'ai confié à un ami en lui promettant une belle séance de lecture. C'est que Les deux mariages de Lenka soulève l'enthousiasme et on n'a qu'une hâte : le faire partager illico.
J'écris ce billet sans avoir l'ouvrage sous la main, et je ne pourrai donc pas citer les nombreux passages que j'avais soulignés. Pourquoi ? Parce que, aussitôt refermé, je l'ai confié à un ami en lui promettant une belle séance de lecture. C'est que Les deux mariages de Lenka soulève l'enthousiasme et on n'a qu'une hâte : le faire partager illico.
Isabelle Flaten, c'est La Bruyère projeté au XXIe siècle, gourmande des Caractères qui s'y promènent, spectatrice aguerrie des petits et grands travers humains, elle en tire de savoureuses observations, en variant les thèmes : l'amour, l'argent, la parole… Dans Se taire ou pas, paru chez son fidèle éditeur Le Réalgar, Isabelle Flaten explorait le thème de la parole retenue, empêchée, tue ou délivrée, jetée, arrachée, les raisons qu'on a de ne rien dire, celles qui font qu'on se croit tenu de se confier. Dans son dernier roman, avec son personnage de Lenka, l'auteure ne se contente pas de creuser plus loin cette interrogation, de plus en plus prégnante dans la dernière partie, elle en dissèque les atermoiements avec une qualité de chirurgienne grand style.
Le cadre est idéal et choisi pour que l'effet soit maximum : Prague (que l'auteure connaît bien, elle y a vécu), au lendemain de la révolution de Velours. Parce qu'un tel bouleversement politique inverse les discours et rend la parole à ceux qui ont dû se taire longtemps, sous la coupe d'une dictature. Les deux mariages de Lenka peut d'abord évoquer une sorte de « Good Bye Lenine » inspiré, ravageur, cruel. Les 'valeurs' de l'occident capitaliste font irruption dans l'éternelle suspension communiste, viennent ringardiser le modèle soviétique, fragiliser les prudents, favoriser les coriaces et les audacieux et, plus surprenant, susciter les premières nostalgies. Les entrepreneurs étrangers débarquent, les rayons des magasins se remplissent. Le monde bascule, les maîtres d'hier font profil bas ou s'arrangent avec le nouveau système, les anciennes victimes remontent au jour, souvent dignes, indestructibles : l'Histoire leur a donné raison. Les turpitudes du passé ne sont pas exactement remisées : on les rumine en attendant de régler les comptes.
Lenka, le personnage principal, n'est pas une héroïne, pas une résistante, c'est une femme bien ordinaire. Veuve d'un type dont on apprend les médiocrités et la noirceur de collabo et de délateur, la jeune femme est loin d'être un modèle. Elle a pu se faire illusion, croire que son défunt mari et elle avaient atténué, pour leurs « amis » et voisins, les rigueurs du régime. Les « amis » vont lui faire connaître l'envers du tableau, démolir le vernis, mettre à nu et à cru les saloperies passées. Lenka sait bien, au fond, qu'ils ont raison, elle sait bien qu'elle a soutenu son mari, partagé ses idées, encouragé ses affreuses décisions. Lenka est contrainte de faire le bilan de ce qu'ont pu coûter, en souffrances pour les autres, son petit confort matériel et ses compromissions de sympathisante. Quand s'ouvre le roman, la Révolution est passée, et pour Lenka, c'est le désastre. Elle est seule. Ses voisins, qu'elle croyait ses amis, la méprisent, ses parents, qui avaient bien perçu la nature de leur gendre et le détestaient, respirent enfin, peuvent réaliser leurs rêves et leurs films, et sa fille lui en apprend de belles sur sa manière de survivre dans ce nouveau milieu. Lenka est tombée de haut. Bien obligée, elle est femme de ménage, se découvre manipulatrice et kleptomane. Pas reluisante, décidément, Lenka. Pourtant, dans ce tableau désespérant, une lueur se fait en la personne d'un homme, Paolo, rencontré en France (car on peut partir à l'étranger maintenant) et décidé à conquérir la Tchéquie, Prague pour commencer. Il est tellement beau, sensuel, délicat, prévenant, riche, que Lenka est tentée de s'interdire d'y croire et puis, décidément, non, c'est bien vrai, cet homme parfait l'aime, lui offre un travail, ainsi qu'à sa fille, et veut l'épouser. Le danger ne vient pas de lui, pas directement, mais de ce que Lenka a tu. La crapulerie de son premier mariage, cette atmosphère cafardeuse qu'elle respirait bien volontiers et avec laquelle elle avait fait alliance. Alors, se taire ou pas, révéler à son futur mari, qu'elle aime sincèrement, quelle minable elle a été ? La deuxième partie du livre met en scène avec une habileté diabolique ce débat intime. On tremble pour Lenka. Avec elle, on redoute l'irruption des vérités, on attend l'inévitable révélation avec fatalisme et peur. Aussi médiocre soit-elle, on côtoie Lenka au plus juste et on éprouve de la compassion pour elle. C'est une des réussites d'Isabelle Flaten : la pertinence de ses portraits, on retrouve là le regard affûté de ses ouvrages précédents, qu'ils soient romans ou collections de courts récits. La fin est un magnifique tableau en demi-teinte. J'ai lu par ailleurs une critique parler d'espoir au final. Entre nous, je n'y crois pas, et il me semble que l'auteure non plus. Isabelle Flaten connaît bien trop l'humanité pour se leurrer. La vie continue, simplement, et c'est au couple, à présent, d'éroder ses aspérités pour ne plus s'y écorcher, de supporter les compromis, comme toute une société coupable, qui ne fut pas faite que de héros, doit s'arranger avec son passé. On y parvient, c'est le pire, on vit très bien avec ses fautes. Qu'on les taise, ou pas.
Les deux mariages de Lenka. Isabelle Flaten. 15 euros. A paraître fin août au Réalgar.

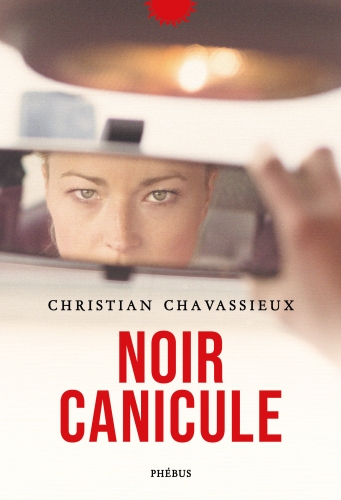
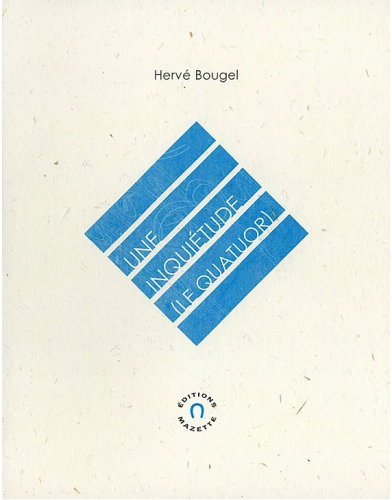 Est-ce qu'une forme littéraire, longuement élaborée au fil des ans, très aboutie, ne fait pas prendre à son auteur le risque de se trouver démuni face à certains enjeux ? Je m'explique : j'ai souvent dit ici mon admiration pour le travail d'Hervé Bougel, en tant qu'éditeur bien sûr (les éditions Pré#Carré, c'est lui), mais aussi en tant que poète (« Travails » ; « Les pommarins ») et auteur de textes en prose (« Tombeau pour Luis Ocana », par exemple). L'obsession de l'auteur, si l'on veut, est l'économie, et cette économie de moyens et de mots (« quand on veut dire quelque chose d'essentiel dans la vie, ça tient en peu de mots : Ta gueule, Je t'aime, etc. » dit souvent Hervé Bougel) conduit à une sorte de netteté, presque de sécheresse (non pas de stérilité, entendons-nous bien). L'ambition de son dernier ouvrage « Une inquiétude », parue aux éditions Mazette, l'oblige à définir les contours de ce sentiment aussi incertain et diffus par les moyens d'une écriture qui a eu pour exigence principale de se débarrasser des scories et des séductions, de tout lyrisme, pour mieux dire les choses avec simplicité et... netteté. La lecture de « Une inquiétude » me fait me poser la question qui ouvre ce billet, aussi naïve soit-elle (car pourquoi une écriture serrée et aiguisée serait-elle contraire, a priori, à l'exploration de sentiments confus ?). C’est pourtant cet écart (ce hiatus ?) que j'ai ressenti. C'est un beau texte, mais dont la rigueur m'a tenu à distance de ses enjeux.
Est-ce qu'une forme littéraire, longuement élaborée au fil des ans, très aboutie, ne fait pas prendre à son auteur le risque de se trouver démuni face à certains enjeux ? Je m'explique : j'ai souvent dit ici mon admiration pour le travail d'Hervé Bougel, en tant qu'éditeur bien sûr (les éditions Pré#Carré, c'est lui), mais aussi en tant que poète (« Travails » ; « Les pommarins ») et auteur de textes en prose (« Tombeau pour Luis Ocana », par exemple). L'obsession de l'auteur, si l'on veut, est l'économie, et cette économie de moyens et de mots (« quand on veut dire quelque chose d'essentiel dans la vie, ça tient en peu de mots : Ta gueule, Je t'aime, etc. » dit souvent Hervé Bougel) conduit à une sorte de netteté, presque de sécheresse (non pas de stérilité, entendons-nous bien). L'ambition de son dernier ouvrage « Une inquiétude », parue aux éditions Mazette, l'oblige à définir les contours de ce sentiment aussi incertain et diffus par les moyens d'une écriture qui a eu pour exigence principale de se débarrasser des scories et des séductions, de tout lyrisme, pour mieux dire les choses avec simplicité et... netteté. La lecture de « Une inquiétude » me fait me poser la question qui ouvre ce billet, aussi naïve soit-elle (car pourquoi une écriture serrée et aiguisée serait-elle contraire, a priori, à l'exploration de sentiments confus ?). C’est pourtant cet écart (ce hiatus ?) que j'ai ressenti. C'est un beau texte, mais dont la rigueur m'a tenu à distance de ses enjeux.