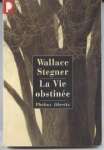Grand-père était cordonnier orthopédiste. Il imposa à la plante de mes pieds plats, que l’enfance aurait dû rendre malléable, des semelles de sa création, outrageusement cambrées. Il confectionnait avec amour ce cartonnage rigide de couches de cuir, assemblées à l’aide de rivets chromés. Une merveille technologique, un instrument de torture individualisé, comme j’en connus plus tard avec les appareils redresseurs de dents rebelles. Inéluctablement, je grandissais, mes pieds aussi, mais les voûtes plantaires ne se voûtaient pas ; grand-père accentuait la cambrure de ses semelles, qu’il glissait à l’intérieur de la nouvelle paire de chaussures que mon changement de pointures exigeait. Les premiers jours, c’était horrible. Tout mon corps se révoltait contre cette sensation de marcher sur des galets embarqués. Dès que possible, je cachais ces maudites formes de cuir et marchais, soulagé, dans l’espace réintégré de mes chaussures neuves. A l’approche d’un parent, je boitillais en plissant le front, mais la supercherie ne dura pas.
L’expression de souffrance que j’employai une fois sous le regard de ma mère, la fit s’insurger contre la trop forte contrainte que l’on imposait à mes jeunes membres. Elle demanda illico à son beau-père de remédier au problème : « Non, mais regardez comme il a mal ! ». Mon grand-père, s’excusant, contrit, me déchaussa pour assouplir les semelles immédiatement. De semelles, point. Sarcasmes du grand-père, confusion et colère de la mère, déconfiture du jeune comédien. Il me fut impossible ensuite d’échapper à la rééducation douloureuse de mes arcades plantaires. Je concevais désormais la vie comme un martyr interminable. Je compatissais au sort de la petite sirène, dont la lecture répétée m’offrait le frisson, incessamment renouvelé, de la description de sa marche sur ses pieds neufs : « A chaque pas, comme la sorcière l'en avait prévenue, il lui semblait marcher sur des aiguilles pointues et des couteaux aiguisés ». Mais cela n’atténuait pas la hantise de devoir déambuler sur les semelles maudites.
Il y eut pourtant une éclaircie. Il m’était conseillé de marcher pieds nus le plus souvent possible, et sur des terrains particulièrement irréguliers : chemins caillouteux, plages de galets, etc. Je découvris la volupté de marcher ou courir pieds nus dans l’herbe, sur les chemins empoussiérés ou les berges sablonneuses. Plus rien ne m’arrêtait : les sous-bois criblés de ronces, les gravières au relief blessant, les lits de rivière sournois… Je martyrisais mes pieds avec une frénésie masochiste. Au hasard des aventures, je me déboîtais les orteils, m’écorchais la plante des pieds, me tordais les chevilles si souvent qu’elles se fragilisèrent à l’excès. Je redoutais tellement le retour des semelles de grand-père, que je laissais mes parents dans l’ignorance de mes nombreux accidents. Mon obstination se solda par une sensibilité permanente de la cheville droite, un déhanchement discret, une position anormale du pied droit, plus tard des rhumatismes à cette articulation… et une espérance de vie abrégée de toutes mes chaussures droites.
Je repose mon soulier démoli. Pas peu fier d’avoir élucidé le mystère de la pompe droite qui se désagrège prématurément. Et je réajuste mon écharpe autour de mon cou endolori.
Pourquoi est-ce que je porte toujours une écharpe, même lorsqu’il fait chaud ?