Le petit oursin à la foire du trône, bien triste qu'on lui refuse un ballon (et tout empêtré dans la barbe à papa qu'on lui a achetée en compensation).
kronix - Page 17
-
3530
-
3529
La maison est ouverte largement sur la campagne environnante, qui s'invite par de franches coulées de lumière. À l'intérieur, pourtant, il fait assez sombre. Sur la table, couverte d'une toile cirée fuchsia, je commence un rituel d'exorcisme, car une présence sinistre hante les lieux. Tandis que je pose sur la toile cirée une racine de gingembre qui ressemble fichtrement à une mandragore, je profère des incantations que j'improvise. Et je sens bien que ce galimatias, ces litanies grotesques ne vont pas fonctionner. La présence hostile ne semble guère impressionnée par mon jeu. Il me semble d'ailleurs que plus je poursuis mon absurde logorrhée, plus je renforce la présence maléfique. Effaré par cet échec prévisible (et imminent), je suis projeté hors de mon cauchemar. Incapable de retrouver le sommeil, il me faut longtemps pour me débarrasser de la sensation affreuse d'avoir entraîné dans mon monde, et précisément à côté de moi dans le lit, l'odieuse présence que je combattais dans le monde des rêves.
-
3528
Extrait de la pièce "Courage", interprétée par la classe de 2de 4, du lycée Jean Puy.
Scène IV – Évaluer.
Un(e) enseignant(e) face à un(e) élève. Une copie est posée entre eux.
- L'élève, tapant du doigt sur la feuille : Comment ça, quatre ?
- Le prof : Oui, quatre... Cinq ? Tu préfères cinq ?
- Lélève : Quatre ou cinq, merci. Comment je peux avoir une note pareille ?
- Le prof regarde la feuille, semble l'examiner un temps : En effet, c'est mal payé.
- L'élève : Ah !
- Le prof : Je pourrais mettre… Dix. Ça te plairait dix ?
- L'élève : Ah bon ? Vous pouvez doubler ma note, comme ça (elle fait claquer ses doigts) ?
- Le prof : Si ça te fait plaisir.
- L'élève : Ben alors, ça, c’est la meilleure : si ça me fait plaisir !
- Le prof : Oui. Si ça te fait plaisir, je te mets dix, ou douze. Qu'est-ce que ça peut faire ?
- L'élève : Et bien, moi, ça me fait. Je veux savoir combien vaut mon devoir.
- Le prof : Il n'est pas terrible. C'est pour ça : quatre.
- L'élève : Quatre ?
- Le prof : Tu préfères six, ou sept ?
- L'élève : Râah mais arrêtez ! Je préfère… je veux seulement que vous révisiez ma note, parce que je trouve que vous avez noté sévère, mais je veux aussi une note… adaptée à mon devoir. Pas n'importe quoi.
- Le prof : D'accord. OK. Je saisis. Tu veux combien ?
- L'élève : Mais... c’est pas à moi de vous le dire, quand même !
- Le prof : Voyons si nous pouvons tomber d'accord. Tu l'estimes à combien, ton devoir ?
- L'élève : Et bien, je ne sais pas, moi. Je savais que je m'étais un peu planté(e) sur la deuxième question et j'avais pas franchement révisé, c’est vrai…
- Le prof : J'ai fait le même constat. Alors ?
- L'élève : Moi, franchement, je pensais avoir un neuf.
- Le prof : Un neuf ?
- L'élève : Oui.
- Le prof : Selon toi, ce devoir vaut neuf ?
- L'élève : Ben je sais pas. C’est vous qui me demandez. Tout à l'heure, vous étiez prêt(e) à mettre un treize ou un quatorze.
- Le prof : Douze. Douze maxi. Faut pas exagérer non plus.
- L'élève : Je ne comprends plus rien, excusez-moi. Qu'est-ce que vous me faites, là ?
- Le prof : Elle signifie quoi, ta note ?
- L'élève : Quoi, elle signifie quoi ?
- Le prof : Oui, elle signifie quoi ?
- L'élève : Je ne sais pas. Quelle note ? Votre quatre ou mon neuf ?
- Le prof : L'une ou l'autre. Elles signifient quoi ?
- L'élève : Ho là là, arrêtez, vous me prenez grave la tête, là. C'est un cauchemar...
- Le prof : Mon quatre sanctionne le fait que tu n'as pas assez travaillé. On est d'accord ?
- L'élève : D'accord. Mais...
- Le prof : Et ton neuf sanctionne le fait que je ne t'ai pas assez bien noté, c'est ça ?
- L'élève : Euh… Oui, on peut dire ça, oui.
- Le prof : Ton neuf est la note de mon quatre, en quelque sorte. Faisons la moyenne de nos deux appréciations et la question est résolue. Neuf et quatre : treize, divisé par deux : six et demi. Bravo, tu as gagné deux points et demi. Je te les accorde bien volontiers. (il ou elle approche la copie, sort un stylo rouge, biffe la première note et réévalue). Voilà ! Six et demi.
(Prendre un temps.)
- L'élève : C’est presque la moitié de douze...
- Le prof : C'est un devoir de Français, ce ne sont pas des mathématiques.
- L'élève : Je veux dire : j'aurais pu avoir douze tout à l'heure, quand vous m'avez demandé si ça me ferait plaisir d'avoir douze...
- Le prof : C'est vrai.
- L'élève : Enfin, vous voyez bien que quelque chose ne va pas ! Vous faites comme si les notes n'avaient aucune importance. C'est dingue, ce truc.
- Le prof : Pas dingue... Dingue si tu veux, oui. C'est absurde plutôt. Les notes sont absurdes.
- L'élève : Les notes sont absurdes ?
- Le prof : Le principe de la notation, en fait. Je n'aime pas ça.
- L'élève : Et c’est pour ça que vous me faites tout ce délire ?
- Le prof : Tu veux un D ? Tu préfères un D ?
- L'élève : Mais je veux juste une note !
- Le prof : Un la ? Un do ?
- L'élève : ...
- Le prof : Je plaisante.
- L'élève : Vous m'avez fait peur. Je me suis dit : il (elle) a craqué…
- Le prof : Tu n'es pas si loin de la vérité, tu sais. Je craque. Bon sang, mais cette obsession des notes...
- L'élève : Attendez, il faut bien savoir où on en est, si on fait des progrès, non ?
- Le prof : Si je m'en tiens à cette courte expérience, c'est discutable. En quelques minutes, tu voulais passer de mon quatre à ton neuf. Est-ce que tu aurais progressé d'autant, par l'effet de cette simple correction ?
- L'élève : C’est moi qui vais craquer, là. Vous êtes pas sympa avec moi.
- Le prof : Non, sérieusement. J'aimerais pouvoir ne pas noter, tu sais. Ou que la note ne soit pas vécue comme une sanction. Je voudrais davantage mettre en avant les qualités d'une copie, plutôt que d'être contraint d'en souligner les défauts, tu vois ? Je crois d'ailleurs que je le fais mais pas suffisamment parce que... je suis engagé vers l'objectif de ce fichu bac ! Cette épreuve ultime et vénérée avec ses critères d'évaluation qui ne sanctionnent qu'une chose : votre adéquation avec le moule qu'on a fabriqué pour vous.
- L'élève : (Madame, Monsieur) Vous allez bien ?
- Le prof : Hmmm ? Oui, ça va, ne t'en fais pas.
- L'élève : Du coup, j'ai combien ?
- Le prof : On a dit six et demi.
- L'élève : Vous m'avez eu avec votre histoire de moyenne de nos deux notes. Je veux une note appropriée.
- Le prof : Allez, on va dire que j'ai écrit le « six » à l'envers. (il gribouille la feuille). Voilà, neuf et demi. Mais je ne trouve pas ça juste.
- L'élève : Oh non, on va pas recommencer ?
- Le prof : De toute façon, je m'en fiche. Ta véritable évaluation, c'est... regarde-moi.
- L'élève : Hein ?
- Le prof : Regarde-moi.
- L'élève : Je vous regarde.
- Le prof : Là, dans les yeux. Ta véritable évaluation elle est là. Dans mon regard sur toi. Quand je suis content(e) de toi. Tes actes de la vie, hein ? quand tu fais quelque chose de bien, c'est dans le regard de tes copains, de tes copines, de tes parents, de tes proches, que tu les évalues. (Soudain comme éclairé(e) par une révélation :) Désormais, je vais noter en vous lançant des regards d'approbation et de contentement. Ou bien un coup d’œil furieux, un air mécontent. Voilà, je vais noter comme ça, maintenant.
- L'élève : Et ben… Quand je vais expliquer à mes parents… Combien t'as eu en Géo ? J'ai eu « Soulèvement de sourcils ». Et en Maths ? J'ai eu « Moue affligée avec une nuance de mépris ». C'est sûr, ils vont adorer.
- Le prof (salue l'élève qui se redresse et s'en va) : Salue-les de ma part.
- L'élève : Oh, je pense que vous n'allez pas tarder à avoir de leurs nouvelles...
Noir. -
3527
Elle avait été agressée sexuellement par trois hommes masqués qui avaient filmé la scène. En toute logique, elle avait porté plainte contre XXX.
(Kronix est donc de retour et vous prie de l'excuser pour cette si longue absence, motivée par une formidable flemme. Vous allez me dire que, si c'est pour écrire des trucs pareils, il pouvait aussi bien rester couché, ce qui fait qu'il y retourne, à sa paresse.)
-
3526
C'est en cherchant les œufs de Pâques que les enfants étaient tombés sur la réserve de grenades de Papy. Heureusement, comme elles n'étaient pas décorées, ils les avaient jetées dans le jardin du voisin. -
3525
Ils sont pourtant nombreux, les acteurs de la valorisation du Furan, signe aussi que cela concerne une large population, pas seulement quelques citadins entichés d'écologie, dont un caprice serait de flâner le long d'une rivière, en pleine ville. Collectivités, établissement publics, associations, industriels, agriculteurs... la liste est longue. Je lis, je vois, je retrouve partout cette antienne : redécouvrir le Furan. Un document de 2009 produit par la Ville de Saint-Etienne, parmi d'autres, s'en fait l'écho, en illustrant le devenir du Furan par des croquis de puits ou de noria, qui ponctueraient le tracé de la rivière. On peut y lire : « ville sans fleuve qui a aussi longtemps vécu dans la dénégation de sa rivière, l'entreprise [la valorisation des berges du Furan et des cours d'eau] relève à la fois du paradoxe et du défi. » Les difficultés sont posées, l'ambition est déclarée, autant de signes que les esprits sont prêts. L'idée lancée il y a trente ans comme une utopie a fait école ou bien, aussi sûrement, le sens de l'histoire est pour une sorte de rédemption du genre humain. Il suffirait de la lui permettre. De lui donner l'occasion de faire accord avec ce qu'il a tant méprisé jadis, par indifférence, négligence, nonchalance, obsession de la rentabilité, autant de raisons irrationnelles, au regard des enjeux de qualité de vie.
Extrait de "à propos de Saint-Etienne", écriture en cours.
-
3524
Le Furan emmuré, plus ou moins souillé, que faire de ce fantôme en voie de résurrection ? Tandis que les galeries de mines s'enfoncent inéluctablement dans l'oubli, engorgées d'eau sale, qu'elles seront de plus en plus des traces indifférentes et muettes, s'élèvent dans les pensées et se manifestent aux citoyens les moins inconséquents, l'urgence et la présence de la vie de la mère rivière. L'idée n'est pas neuve. Il y a plus de trente ans, Yves Perret avait entraîné ses élèves de l'Ecole d'architecture de Saint-Etienne, dans le projet fou d'une réconciliation de la Mère rivière avec son rejeton urbain. L'étude s'évertuait à prendre les choses dans l'ordre. Il s'agissait d'abord de s'interroger sur ce qui est le socle de la ville, sur ce qui se passe dessous. Préoccupation incongrue, déplacée, quasi délirante, lui fit-on savoir. L'époque voulait ce mépris goguenard pour ceux qui suggèrent tout simplement de cesser de croupir dans ses propres déjections. D'abord assainir, donc. Avant de bâtir, de projeter, de rêver : s'inquiéter de la terre, de l'eau, de l'air. Pourquoi cette évidence n'était-elle partagée que par une poignée ? Surtout, comment se fait-il que l'urgence n'apparaisse toujours pas, aujourd'hui, à son vrai degré d'exigence, ne soit pas à l'origine et au cœur de toute réflexion ? S'il y a des générations futures, elles seront abasourdies au constat de notre inertie. Cependant, une prise de conscience, venue à la présentation de preuves incontestables un peu partout dans le monde, a lentement imprégné les esprits, au plus haut niveau. Grâce à de nouvelles réglementations, trente ans après l'initiative de l'école d'architecture, l'état du Furan s'est amélioré. Nous sommes loin du compte, comme on l'a vu (et senti), mais au moins, un espoir est permis. Maintenant, suivons la logique de notre architecte et rêvons avec ses étudiants d'une rivière rendue au jour, sur l'essentiel de sa traversée. « Oui, l'eau coule gaillarde et irisée en plein centre ville. Depuis les ponts, certains jours, les Stéphanois viennent voir moucher les truites. Les enfants jouent partout. Des prises d'eau alimentent les biefs qui courent dans les rues et arrosent jardins publics et jardins ouvriers. » Je cite ici un extrait d'un texte d'Yves Perret intitulé « Rêve » Et pourquoi pas ? Ce sera long, coûteux ? « Il a fallu cent ans pour recouvrir le Furan, ça a bien été fait, rappelle-t-il, on pourrait mettre cent ans pour le découvrir. » Les efforts techniques et économiques à consentir ne sont pas plus extravagants que ceux qui, il y a un siècle, ont conduit à l'enfouissement du cours d'eau (au passage, ça coûte combien, un stade, un centre commercial ?) Est-on obligés de s'interdire d'y réfléchir ? Tant d'exemples, dans l'histoire des entreprises humaines, nous rappellent qu'un projet insensé ne paraît tel qu'à cause d'une sorte de paresse. Une tour de fer de trois-cent mètres ? Mais pour faire quoi, grands dieux !
extrait de "à propos de Saint-Etienne", écriture en cours.
-
3523
Sur son radier, imperceptible désormais, le Furan parcourt des kilomètres, sa pente naturelle reprise par la grande rue qui, si on la laissait sur son élan, rejoindrait la Loire, à quoi est le ruisseau destiné. Il ne réapparaît qu'au flanc de la rue des Trois Glorieuses, vers La Terrasse, à l'autre extrémité de la ville. M'y voici en ce mois de mai. J'ai espéré plusieurs jours un moment de soleil avant d'aller, résigné, à ce rendez-vous, sous un ciel de gris massif et bas, un air sans mouvement. Triste atmosphère qui me prépare à un triste spectacle. Depuis la rue, son surplomb plus important qu'à Valbenoîte, la rivière est loin. Le Furan est pissé par la ville dans un bouillonnement dont la source est volée au regard par une épaisse végétation, broussailles inamicales qui envahissent chantiers et talus dans les zones que l'homme abandonne. Peu de courant, ce jour, le niveau est bas, l'eau est noire, quelques oiseaux, noirs, sautillent de roches grises en roches grises sous le jour gris. Sur la rive droite, une paroi minérale naturelle dont la base est travaillée par la sape du Furan, quand il abonde ; sur la rive gauche, des murs de béton séparent cette nature navrée d'un parking accolé à des bâtiments commerciaux. Avant d'achever sa course urbaine dans cette sentine, le Furan a accueilli les eaux de ses affluents devenus des collecteurs, et son odeur n'en fait pas mystère, même à distance. Je la définirai comme un mélange de vase et de vidange de machine à laver. On se console, si l'on veut, par la perspective du traitement de cette lie, enfin, à la station d'épuration du Porchon, imaginée dès 1938 mais lancée en 1972 (pourquoi les aménagements qui concernent santé et bien-être sont-ils toujours relégués ou retardés ?)
Extrait de "à propos de Saint-Etienne", écriture en cours.
-
3522
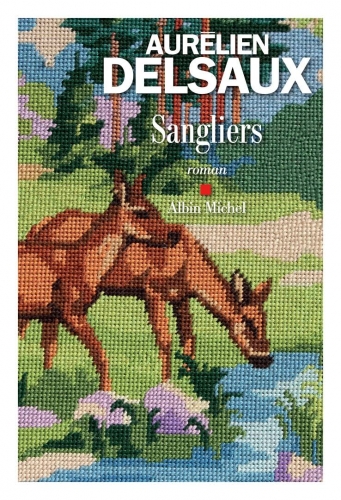 C'est ce soir, à 19 heures, à la librairie Lune et l'autre de Saint-Etienne, 19 rue Bérard, que j'aurai le plaisir de vous faire partager mon enthousiasme pour le formidable roman d'Aurélien Delsaux, "Sangliers", en présence de l'auteur.
C'est ce soir, à 19 heures, à la librairie Lune et l'autre de Saint-Etienne, 19 rue Bérard, que j'aurai le plaisir de vous faire partager mon enthousiasme pour le formidable roman d'Aurélien Delsaux, "Sangliers", en présence de l'auteur.Enfin, un roman ample, ambitieux, riche tant du point de vue de la forme, du style, que du contenu. Enfin, enfin, un monument dans ce paysage littéraire de nains, une épopée nécessaire au milieu de cette théorie de récits timides, prudents, égotiques, souvent cyniques parce qu'incapables de grandeur.
Enfin, enfin, de la littérature, bordel ! (je m'excuse).
-
3521
Mais avant cela, pour le regard averti, l'urbanisme témoigne en plusieurs endroits de la présence de la rivière sous la ville. Remontons notre parcours, rebroussons chemin vers le sud. Le cours Victor Hugo dans cette direction, soudain se tord. Sa perspective, partie d'un élan net depuis les Ursules, s'arc-boute et vire dans le tracé curviligne de la rue du Général Leclerc. Docile, la ligne de tramway, superposée au cours de la rivière, arrondit également ses voies, rejoint l'avenue Gambetta. De l'autre côté, la rue Voltaire reprend en l'inversant, l'effet de courbe amorcé par la rue Leclerc. Un « S » géant vu du ciel, avec les bâtiments rangés le long de cette sinuosité, comme des berges verticales. Le dessin de souple balancement de ces deux rues, c'est un tribut à notre Furan, calqué sur ses méandres, le S majuscule final du Furens. De même, cours Victor Hugo, en face des halles, le promeneur remarque dans l'alignement des façades, un bâtiment nettement moindre que les autres. Le signe d'une prudence induite par le passage de la rivière : à l'époque de travaux d'urbanisme de ce quartier, on ne pouvait faire subir au recouvrement du Furan, aux fragiles voûtes qui portent la chaussée, le poids d'un bâtiment haut et fier, comme sont les autres immeubles de la même rue.
Extrait de "à propos de Saint-Etienne", écriture en cours.
Lien permanent Catégories : actu, Au fil de l'Histoire, choses vues, Ecrire, Travaux en cours 0 commentaire -
3520
La ville le dérobe aux sens, après cela : le Furan canalisé et le bief des usines qui est, en quelque sorte, jumeau de son chemin, passent en silence sous la ville, le long de la rue Gérentet, le long de la place Jean-Jaurès, non loin d'un autre entrelacs souterrain dont on parle peu : les abris contre les bombardements établis dans ce secteur — « vestiges d'une guerre finie », une du genre mondial, la seconde sans doute. Que sont devenus ces vastes couloirs de béton armé ? L'auteur de « Le Beau navire », Claude Gros, les situe du côté de l'église Saint-Charles. Dans ma ville natale, ils étaient enterrés sous la place de l'Hôtel-de-Ville, une configuration proche de celle de Saint-Etienne. Lors d'importants travaux dans les années 95, on pouvait y accéder par de lourdes trappes cachées sous le bitume depuis des décennies. J'avais eu le privilège de les parcourir, en tout cas déambuler dans les portions encore accessibles, jusqu'à des obstacles de maçonneries, empêchant que des squatteurs héroïques ne s'y installent durablement ou, plus probablement, que des intrépides ne s'y aventurent trop loin, jusqu'à des confins fragilisés et dangereux. Le complexe défensif s'étendait sous la place en des prolongements non-cartographiés, à un coup de pelle ou de pioche, à moins de cinquante centimètres sous la surface. C'est l'épaisseur de béton, plus que la profondeur d'enfouissement des galeries, qui assurait la protection des réfugiés. L'ouvrage stéphanois n'était probablement pas éloigné de l'ouvrage roannais et j'en déduis que le parking souterrain actuel, dépassant et englobant la profondeur des abris, les a phagocytés. C'est donc, contrairement aux galeries de mines, un réseau bel et bien disparu, comme la petite Daphné de l'ex place Marengo, bronze élégant avec son pas de course suspendu, nymphe emportée par la guerre qui avait fait naître les abris, pas tondue mais fondue, à la grande joie des canonniers (destin que n'a pas connu la délicieuse muse de Massenet, sculptée par Lamberton, enlevée clandestinement une nuit de 1940 et qui retrouva son square, la paix revenue).
Extrait de "à propos de Saint-Etienne", écriture en cours.
Lien permanent Catégories : actu, Au fil de l'Histoire, choses vues, Ecrire, Travaux en cours 0 commentaire -
3519
Je voulais noter de quelle façon, au vu de tous, se manifestent les effets de ce qui travaille secrètement les entrailles de la cité. Une certaine archéologie des caractères enfouis, c'est-à-dire tus. Et comment cela, inéluctablement, bouleverse la surface. En l'occurrence, j'ai digressé : la relation est mince entre la puissante forteresse commerciale sur laquelle je me suis attardé et le discret torrent qui palpite sous ses murs. Sans doute, un enquêteur autorisé à descendre sous le complexe voulu par Michel Durafour dans les années 78-80, percevrait entre les piles de béton solidement ancrées, l'eau confinée de la rivière, je l'imagine entre les puissantes fondations, miroitement nocturne dans l'ombre qu'elle ne quittera plus jusqu'à sa sortie de la ville. Des souvenirs du Fantôme de l'Opéra (le film, la version muette, avec Lon Chaney), plaquent leur imagerie sur la réalité certainement plus terne du souterrain. Rien à la surface ne manifeste plus le cours caché. Et puis, soudain, on retrouve le Furan un peu plus loin vers le nord. Non pas le cours et son chant ; sa trace, seulement. Je ne sais qui, sur le site de l'Université, à Trèfilerie, a veillé à rappeler que l'eau continue son train sous la ville immobile et minérale, mais c'est une idée cohérente : inscrire un signe mémoriel dans un lieu de savoir. Un trait bleu et droit, quelque peu râpé aujourd'hui, dessine une géométrie de rivière fantôme au piéton funambule qui l'arpente. Sur le campus, on peut s'accouder à une barrière qui protège une descente bétonnée au fond de laquelle des portes métalliques verrouillent l'accès au cours souterrain. Il suffit de tendre l'oreille pour constater que le Furan là derrière gronde et vit. Il se manifestera de la même manière, voix brouillée par la rumeur urbaine, sous les pas du promeneur à quelques kilomètres de là, place Dorian. Le sang rejoint le cœur premier qui bat. De grosses tôles séparent nos deux mondes. Vibrations de cascade là dedans, là dessous. Sur un affaiblissement des roulements de la ville, c'est plus net, c'est proche. La créature selon les saisons, rue ou somnole dans sa caverne. On guette, immobile là haut, attentif, comme on est attentif à soi, à l'écoute de ce que le corps au secret murmure de nous. Passant, il est utile de t'arrêter ici si tu veux apprendre ce que tu es et ce qu'est ton rapport au monde. C'est beaucoup, c'est trop ? Je suis sérieux : la méditation en présence de ce qui est enfoui n'est pas un exercice vain, il s'y produit un engouffrement en soi des embarras quotidiens, et cette opération laisse subsister en surface, sous la clarté de la conscience, ce qui mérite enfin d'être examiné. Le mystère d'une vie dont on ne perçoit que les efforts de fauve incessants à cogner contre sa cage, rince et ressuie la lie du trop-plein, et mène à l'essentiel. Ne haussez pas les épaules, essayez. Plantez-vous dans ce vertige et sentez la pulsion tellurique remuer en vous les vérités.
Extrait de "à propos de Saint-Etienne", écriture en cours.
Lien permanent Catégories : Au fil de l'Histoire, choses vues, Ecrire, Travaux en cours 0 commentaire -
3518
Non loin de ce double salut du Furan (un bonjour suivi d'un immédiat au revoir), en marchant vers le nord, on dépasse le monumental Centre Deux, qui a englouti sous son poids notre peu de rivière. Centre Deux… centre commercial dont le nom laisse supposer que ses concepteurs l'ont un temps rêvé comme un deuxième point nodal de la ville, un Centre Ville bis. Hypothèse confirmée par mon guide : on a bien imaginé ici, à la hauteur de la place Jules Ferry, offrir un deuxième cœur à la ville. Ce qui s'entend : je songe à la girafe, curieusement (ne riez pas), le petit miracle de l'évolution dont elle a hérité, deux cœurs pour pulser le sang jusqu'au cerveau, un muscle intermédiaire reprend le jet du premier, pousse le flux plus loin, lui fait franchir la distance aberrante de l'immense cou. La grande rue, démesurément étirée, impose cette comparaison à mon cerveau toujours prompt à susciter des relations d'images. Un Centre urbain 'Deux', ou quel que soit son nom, qui rejouerait la partie, distribuerait autrement les cartes, s'affirmant avec le temps comme un nouveau point de gravité, faisant oublier les contours incertains d'un premier, pourquoi pas, mais devait-il mettre en avant un tropisme de grande surface que les perspectives du commerce futur condamnent déjà et, par dessus tout, prendre l'allure d'un ouvrage défensif de la seconde guerre mondiale ? Je vois à présent un projet de surface commerciale plus gigantesque encore, arrimé comme un navire de guerre futuriste à l'est de la ville, et je m'interroge... Pardon de laisser déblatérer l'urbaniste qui réside — avec le capitaine d'équipe de football, le macro-économiste et le stratège militaire — au fond de tout naïf appuyé au comptoir du commerce, je dépasse mon rôle de visiteur, je juge. On ne dégoise pas à la table de ses hôtes. D'autant que, dans les années 90, un auteur stéphanois se félicitait de l'architecture de Centre deux qui lui paraissait « moderne, réussie… solide sans être majestueuse. (…) élégante, aux dimensions de l'homme ». Nous n'avons donc pas vu les choses sous le même angle. Revenons à notre sujet...
Extrait de "à propos de Saint-Etienne", écriture en cours.
-
3517
Dans la presse, je m'arrête sur une photo des manifestations, à Gaza. On y voit un très jeune garçon, armé d'une fronde. Un jeune garçon et sa fronde, face à un adversaire puissant et lourdement armé, ça ne vous rappelle rien ? Quel retournement !
-
3516
En quelques mois, j'ai prétendu saisir quelque chose de la ville, et dessiné les contours de ses enjeux pour le passé et le présent (et l'avenir, pour faire bonne mesure, n'ayons peur de rien). « A propos de Saint-Etienne » entre dans sa phase la plus angoissante, le moment où je vérifie quelques données, j'affine des constats, je rencontre les ultimes référents qu'on m'a conseillés, sur tel ou tel sujet que j'ai abordé. Et le problème est là : j'ai déjà écrit, produit des hypothèses, traduit mes impressions et mes constats, dans l'élan donné par l'écriture, l'observation, les échanges et les lectures. Et soudain, à dix jours de rendre ma copie, un scientifique adorable et serviable répond à mes questions et démolit une à une mes petites inventions avec tranquillité, méthode, me renvoyant sans méchanceté à ma prétention d'auteur qui a cru pouvoir comprendre certains phénomènes en si peu de temps et avec si peu de culture. Je vous laisse, j'ai du boulot.
-
3515
un passage que j'ai supprimé de mon futur texte sur Saint-Etienne :
"Où bat le puissant cœur initial ? Où est donc ce premier centre de Saint-Etienne ? Et d'ailleurs, c'est quoi, un centre ville, en quoi est-ce que ça consiste ? On peut le définir comme un point de rencontre, assez restreint, convergent, historiquement ancien en général, géographiquement situé au cœur du tissu urbain, un centre de gravité où se concentrent toutes les raisons de se rendre : commerces, administrations, animations, loisirs culturels ou autres, espaces ouverts où se croiser est possible, où se donner rendez-vous, où flâner a aussi une fonction de mixité des classes sociales. Ici, quel serait-il ? La place du peuple, l'ancien pré de foire ? C'est une place minérale, incommode en hiver, traversée, traversante, frangée de terrasses en été, mais dépourvue d'administrations. Le noyau d'origine, la cité des débuts, le germe historique ? Celui-ci se résume à une place face à la plus ancienne église de la cité, une statue de Jeanne d'Arc, quelques petits commerces et une maison double de ses XVe et XVIe additionnés, dont on prévoit la restauration et l'utilisation à des fins culturelles ; plus de théâtre par contre (la Comédie, toute proche, est encore prêtée pour des performances artistiques, mais la maison-mère est allée s'exporter hors de tout centre, tendre les bras aux Lyonnais), la vie s'est déplacée (pour preuve : mairie et médiathèque, tout près, sont des établissements « de quartier », des annexes), déjà, ce « centre » est sorti du cadre, en quelque sorte. La place de l'Hôtel-de-Ville est le candidat le plus évident : espace, commerces, administrations… augmentée de l'ensemble Hôtel-de-Ville — Préfecture, et places les séparant, le long de la grande rue. Alignement qui dilue l'effet nodal, excite, invite à la mobilité, difficile de se tenir là sans qu'un fourmillement de jambes ne vous entraîne d'un côté ou de l'autre, plus haut, plus bas, dans les rues piétonnes, ailleurs. On ne se pose pas longtemps dans ce centre étiré, tellement étiré qu'il ne peut sans réserve être investi de ce titre. Ou bien, j'élargis la notion de centre ville, par souci de proportion avec une cité de plus de 200 000 âmes et c'est un centre qui englobe alors une zone très étendue, de la place du Peuple à la place Jean-Jaurès. Dilution, vous dis-je. "
-
3514
Si les frères Lumière ne s'étaient pas mariés avec les sœurs Satourne, le cinéma n'aurait jamais vu le jour.
-
3513
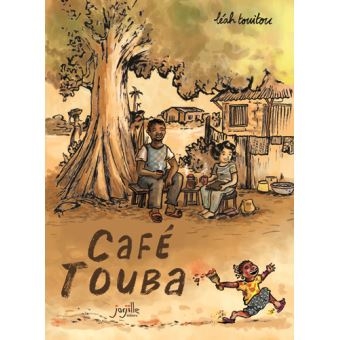 Beaucoup la découvriront avec cet album, mais Léah Touitou ne débarque pas de nulle part. A 30 ans juste passés, elle a suivi un parcours personnel, exigeant, exemplaire, une traversée en solitaire avec pour seules armes son talent et son infatigable attention aux autres. Entrée dans le milieu professionnel avec des illustrations, des albums pour enfants, des films d'animation, le mode d'expression qui lui permet le mieux de faire connaître son univers, reste la BD qui lui avait valu d'être publiée dès l'âge de 16 ans. Aujourd'hui la « petite pousse » des éditions Ikon & Imago est devenue une auteure reconnue, éditée par Jarjille, excellente maison aux racines stéphanoises, ce qui n'est pas pour nous déplaire. Le premier album de ce qui pourrait être un diptyque, voire un triptyque, s'intitule Café Touba. En 2011, Léah imagine et conçoit un parcours artistique en Afrique, dont elle connaît déjà le Cameroun. Cette fois, de nombreux pays de l'ouest du continent seront traversés, chaque escale donnant lieu à des ateliers de dessin, de BD, de fresques, de films d'animation, etc. Pour Léah, tout d'abord, l'odyssée est affaire collective, impensable en solo. Elle se démène, contacte associations, institutions, particuliers et professionnels... Un vif enthousiasme accompagne d'abord « Caravane d'images », le nom de son projet. Beaucoup d'encouragements, de soutiens inconditionnels, d'accolades à la vie à la mort (enfin, j'imagine ce genre de chaleur très superficielle) sauf que, de dizaines d'aventuriers prêts à s'envoler pour l'Afrique, la veille du départ, Léah se retrouve bel et bien seule. Elle ne renonce pas (ce serait mal la connaître) et, la peur au ventre de se lancer dans une telle 'performance', elle atterrit à Dakar, au Sénégal, sa première étape. Son travail sur place, les trajets, les rencontres dans les villages, les écoles, chez l'habitant, loin du Sénégal touristique (et des « mamans cadeaux » européennes qui viennent chercher sur ses plages la chair athlétique des garçons pauvres du pays), est le sujet de ces 110 planches en noir et niveaux de gris. Et c'est un régal, une jubilation, une déambulation étonnée, drôle et tendre, au contact d'inconnus dont on se ferait facilement de grands amis. Léah Touitou restitue la langue, les attitudes, les expressions au plus juste. Elle n'est pas la « toubab », la blanche qui observe et juge, elle est de son temps, notre toubab, elle ne croit pas détenir la vérité occidentale. Pétrie d'auto-dérision, toujours en retrait, simple invitée au service d'un projet, (collectif cette fois : tout le monde, y compris une vieille femme du village, participe à la réalisation d'une fresque élaborée avec les enfants d'une école), elle ne sort de sa réserve que si on la pousse à participer à un jeu ou à une fête. Femme accueillie dans un monde différent, ses hôtes la guident et lui expliquent l'histoire ignorée des Européens, la grande histoire africaine, les puissants et vastes empires d'antan, « Est-ce que, parce que ce n'est pas écrit dans vos livres de blancs, c'est faux ? » Le lecteur partagera quelques leçons de vie aussi, dont chaque vrai voyage intime est prodigue, quand un homme dit, parce que notre voyageuse s'impatiente d'attendre une voiture : « Hé, en Europe vous avez la montre, nous on a le temps » ou quand elle remarque une élève métisse et que le professeur de l'école prononce : « Les enfants métis sont toujours beaux. La preuve que Dieu aime les mélanges ». Les carnets de l'auteure, croquis pris sur le vif, détails annotés à la façon des cahiers d'explorateurs, ponctuent et enrichissent la narration, ne sont jamais gratuits. Vous saisit aussi, au détour d'une anecdote qui trouve sa conclusion à la toute fin de l'album, l'émotion, celle qui étreint, vous noue la gorge soudain, et vous réconcilie avec l'humanité. La BD de Léah Touitou, comme le café Touba du titre, aux grains de café grillés, c'est fort et ça donne de l'énergie pour la journée (au moins).
Beaucoup la découvriront avec cet album, mais Léah Touitou ne débarque pas de nulle part. A 30 ans juste passés, elle a suivi un parcours personnel, exigeant, exemplaire, une traversée en solitaire avec pour seules armes son talent et son infatigable attention aux autres. Entrée dans le milieu professionnel avec des illustrations, des albums pour enfants, des films d'animation, le mode d'expression qui lui permet le mieux de faire connaître son univers, reste la BD qui lui avait valu d'être publiée dès l'âge de 16 ans. Aujourd'hui la « petite pousse » des éditions Ikon & Imago est devenue une auteure reconnue, éditée par Jarjille, excellente maison aux racines stéphanoises, ce qui n'est pas pour nous déplaire. Le premier album de ce qui pourrait être un diptyque, voire un triptyque, s'intitule Café Touba. En 2011, Léah imagine et conçoit un parcours artistique en Afrique, dont elle connaît déjà le Cameroun. Cette fois, de nombreux pays de l'ouest du continent seront traversés, chaque escale donnant lieu à des ateliers de dessin, de BD, de fresques, de films d'animation, etc. Pour Léah, tout d'abord, l'odyssée est affaire collective, impensable en solo. Elle se démène, contacte associations, institutions, particuliers et professionnels... Un vif enthousiasme accompagne d'abord « Caravane d'images », le nom de son projet. Beaucoup d'encouragements, de soutiens inconditionnels, d'accolades à la vie à la mort (enfin, j'imagine ce genre de chaleur très superficielle) sauf que, de dizaines d'aventuriers prêts à s'envoler pour l'Afrique, la veille du départ, Léah se retrouve bel et bien seule. Elle ne renonce pas (ce serait mal la connaître) et, la peur au ventre de se lancer dans une telle 'performance', elle atterrit à Dakar, au Sénégal, sa première étape. Son travail sur place, les trajets, les rencontres dans les villages, les écoles, chez l'habitant, loin du Sénégal touristique (et des « mamans cadeaux » européennes qui viennent chercher sur ses plages la chair athlétique des garçons pauvres du pays), est le sujet de ces 110 planches en noir et niveaux de gris. Et c'est un régal, une jubilation, une déambulation étonnée, drôle et tendre, au contact d'inconnus dont on se ferait facilement de grands amis. Léah Touitou restitue la langue, les attitudes, les expressions au plus juste. Elle n'est pas la « toubab », la blanche qui observe et juge, elle est de son temps, notre toubab, elle ne croit pas détenir la vérité occidentale. Pétrie d'auto-dérision, toujours en retrait, simple invitée au service d'un projet, (collectif cette fois : tout le monde, y compris une vieille femme du village, participe à la réalisation d'une fresque élaborée avec les enfants d'une école), elle ne sort de sa réserve que si on la pousse à participer à un jeu ou à une fête. Femme accueillie dans un monde différent, ses hôtes la guident et lui expliquent l'histoire ignorée des Européens, la grande histoire africaine, les puissants et vastes empires d'antan, « Est-ce que, parce que ce n'est pas écrit dans vos livres de blancs, c'est faux ? » Le lecteur partagera quelques leçons de vie aussi, dont chaque vrai voyage intime est prodigue, quand un homme dit, parce que notre voyageuse s'impatiente d'attendre une voiture : « Hé, en Europe vous avez la montre, nous on a le temps » ou quand elle remarque une élève métisse et que le professeur de l'école prononce : « Les enfants métis sont toujours beaux. La preuve que Dieu aime les mélanges ». Les carnets de l'auteure, croquis pris sur le vif, détails annotés à la façon des cahiers d'explorateurs, ponctuent et enrichissent la narration, ne sont jamais gratuits. Vous saisit aussi, au détour d'une anecdote qui trouve sa conclusion à la toute fin de l'album, l'émotion, celle qui étreint, vous noue la gorge soudain, et vous réconcilie avec l'humanité. La BD de Léah Touitou, comme le café Touba du titre, aux grains de café grillés, c'est fort et ça donne de l'énergie pour la journée (au moins).N.B. : Léah Touitou sera à la médiathèque Tarentaize de Saint-Etienne le 2 juin pour un atelier autour de la BD.
-
3512
Une présentation de rentrée littéraire, à Lyon. Avec un autre écrivain (du genre excellent et qui ne la ramène pas) et l'organisateur de la journée, nous nous retrouvons à la gare et attendons une jeune auteure d'origine locale mais venant de Paris où la promotion de son premier livre a commencé. Notre ami organisateur tremble : c'est que la primo-romancière est précédée (déjà) d'une bonne réputation de caprice et d'autorité. Le Figaro l'a surnommée « la Houellebecquienne », ce qui en impose. L'auteur du genre excellent et qui ne la ramène pas et moi, nous amusons de l'angoisse de notre guide et tentons de le calmer avec force plaisanteries. Ah, la voilà. Bon, petit bout de femme énergique, comme on le supposait, elle sourit suffisamment pour que notre ami organisateur se détende. Dans la voiture, elle commente sa rencontre de la veille, dans une librairie où la responsable du rayon littérature lui a avoué d'emblée qu'elle n'avait pas aimé son livre. L'auteure grince et vitupère. Je fais alors le portrait possible d'une libraire qui, bien qu'elle n'ait pas aimé, a compris l'intérêt d'un texte et décidé de le proposer à ses lecteurs, ce qui me semble noble et professionnel. La jeune auteure veut bien croire à cette hypothèse, et se tourne vers sa vitre pour ne pas m'imposer sa moue dubitative. Cent mètres plus loin, elle émet des nuances sur la façon dont elle est traitée, chez son éditeur, Gallimard. L'auteur excellent et modeste soupire que, souvent, on est mieux traité chez des éditeurs moindres. Elle réfute l'argument : attendez, dès son premier roman, publiée dans la collection Blanche (autrement dit : d'où tu me parles, toi ?), « c'est quand même le Graal des écrivains ». L'excellent auteur et moi ne pouvons échanger un regard (je suis à l'arrière, à côté de la jeune houellebecquienne, lui est devant, côté passager, tandis que notre organisateur, revenu à son stress, tremble au volant). Tiens, dis-je, c'est vrai, le côté Graal m'avait échappé. L'auteur excellent, et d'expérience, avec une vingtaine de romans derrière lui, échappe : On s'en fout un peu, non ? La jeune auteure géniale serre les lèvres. Son éditeur ne lui aura rien épargné. S'abaisser à fréquenter des écrivains qui se fichent du Graal, ben merde...
-
3511
Tarzan et Panoramix, élevant le regard sur la respiration muette des arbres, saisis du même sentiment ineffable. Et un peu surpris de se retrouver côte à côte, il faut l'avouer.