Ubino croyait aux fantômes. Il percevait des souffles aux murs des vieilles demeures, sentait le regard des portraits hiératiques et, de la même façon, il attribuait aux choses anciennes des traces de mémoire.
Ainsi, un de ces soirs où l’ennui l’emportait sur sa paresse naturelle, il exhaussa de la poussière du grenier une vieille boîte à biscuits métallique pour l’ouvrir devant lui, dans la tiédeur du salon. Sa main plongea dans un fouillis de strates irrégulières et dont les teintes, qui allaient du blanc opalescent au jaune paille, en révélaient l’ancienneté variable.
Depuis des années, il entassait là des paroles anonymes, mots griffonnés par des mains inconnues sur des feuilles de carnet déchirées, bouts d’enveloppes rayées de sentences vengeresses, vestiges de lettres jetées au caniveau. Une collection de mots avortés, de velléités évanouies, de messages incomplets dont il était l'archiviste providentiel. Il les connaissait tous, en savait la variété des encres, l’acidité singulière, le parfum de poussière que chaque billet exhalait comme une signature. Mais il ne se lassait pas d’en retrouver les nuances, et le poids de souvenirs qui s’en dégageait. Il en retira un au hasard et le lut à haute voix :
“ Passe demain. Ne me réveille pas”
Etait-il passé ? Avait-il glissé ses doigts entre les mèches de cheveux blonds, déroulés légers sur le drap de lin ?
Sur un billet quadrillé de bleu, il y avait aussi :
“Ton bonheur m'est inutile”.
Sous la pulpe des doigts, il trouva la sensation d’un papier rêche, âpre comme la sentence. Mais Ubino avait d’emblée aimé l’auteur de ces mots, il en discernait le fantôme cynique et pitoyable, vindicatif et amer, mais aussi tellement désespéré. “Je crois que tu as tort” dit Ubino avec un sourire de compassion.
Il choisit ensuite un bout de papier kraft, une adresse déchirée à laquelle l’expéditeur avait ajoutée :
“presse-toi de répondre, je vis en attendant”
Sans doute, l’expéditeur était une femme, elle n’était plus jeune, elle aimait encore, il lui était difficile d’attendre et la vie lui était insupportable tant que la réponse ne lui parviendrait pas.
Enfin, il y avait ce beau papier ocre pailleté d’impuretés végétales qu’une main négligente avait froissé. Une écriture soignée, destinée à la lecture des autres, disait :
“ L’arbre me parle, moi qui suis tout argile
l’éléphant me parle et je parle aux rivières
la femme me parle et je parle à son ventre.
Les grands bergers debout glissent vers la nuit bleue
comme des madrépores enveloppées d’étoiles.
Les princes de la terre lèchent le vent du soir
et le ciel immense irisé d’agonies
sèche la sueur scintillant à leur front”
Ubino tenait le papier entre ses mains lorsque le vent se leva dans un déchirement de savane balayée par la tourmente. Une vapeur jaune et sèche, chaude comme le soufre, emporta les fantômes dans un tourbillon de feuilles.
Ubino vit sa collection de mémoires s’évanouir dans l’espace ouvert à l’infini. Le vent s’abattit, un morceau de papier revint seul, comme un papillon obstiné, se poser sur la table du salon réapparue.
Ubino s’en saisit, il lut : “Ecris-moi encore”
FIN

 Jean-Marc a parcouru la planète entière pendant des années. Il a vu des choses terribles, n'en doutons pas. Mais impossible à cet humain généreux de se morfondre. Il cherche et trouve toute la gamme des visages du monde, qui adressent un sourire, et imposent le respect, dénient l’apitoiement, invitent à l’amitié universelle. La font même toucher du doigt.
Jean-Marc a parcouru la planète entière pendant des années. Il a vu des choses terribles, n'en doutons pas. Mais impossible à cet humain généreux de se morfondre. Il cherche et trouve toute la gamme des visages du monde, qui adressent un sourire, et imposent le respect, dénient l’apitoiement, invitent à l’amitié universelle. La font même toucher du doigt.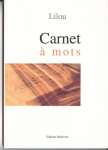 Désolé pour cette image terriblement médiocre, mais je n'ai plus certain logiciel... Enfin bref. L'essentiel est d'évoquer ce précieux recueil des premiers textes de LiLou, autrement auteur de BD chez Onabok éditions; La diffusion bien assurée de ce livre devrait vous permettre de le trouver près de chez vous, en FNAC ou autre.
Désolé pour cette image terriblement médiocre, mais je n'ai plus certain logiciel... Enfin bref. L'essentiel est d'évoquer ce précieux recueil des premiers textes de LiLou, autrement auteur de BD chez Onabok éditions; La diffusion bien assurée de ce livre devrait vous permettre de le trouver près de chez vous, en FNAC ou autre.