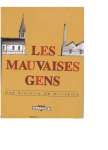Bureau : Etrange que l’origine du nom de ce meuble indispensable soit si confuse. Les latinistes, les gallicistes, les spécialistes s’y perdent et proposent l’hypothèse médiocre d’une étoffe de bure, couvrant une table et, par métonymie, d’un mot désignant « la table ainsi couverte », le bureau. L’extension métonymique ne s’arrêtera pas en si bon chemin, puisque c’est bientôt la pièce dans laquelle trône le meuble, qui sera baptisée du même nom vers le XVIè siècle. Et le sens s’élargit encore… Le bureau finit par désigner l’ensemble des personnes travaillant dans un même bureau (le bureau fête un anniversaire, choisit par hasard le Robert).
kronix - Page 191
-
BUREAU
-
Gash la rage

Sans s’éloigner de son inspiration manga et de ses thèmes de prédilection, Petelus esquisse une vision minimaliste de l’apocalypse.
Toutes les fins du monde connaissent un climax, un point de non-retour que tout bon sauveur se doit d’anticiper. Toutes les fins du monde sont interrompues dans leur processus. Et pour cause. Mais Gash est un sauveur-en-retard.
Car l'humanité s’est consciencieusement suicidée au long d'un immémorial combat fratricide. La boue engloutit lentement cet interminable amoncellement de cadavres, et la brume achève d’effacer le souvenir des hommes. Les immenses Maurks, des ogres descendus des montagnes, n’ont eu qu’à finir le boulot. Tout est accompli. Le monde est perdu. C’est l’heure que Gash a choisi pour apparaître, lui et sa redoutable épée. A quoi pense Gash ? Est-ce qu’il culpabilise, est-il happé par la folie d’un dernier espoir, la volonté d’en découdre ou par un désir de vengeance ? Personne ne le sait, pas même l’auteur. Tout ce que Petelus connaît de sa créature, c’est qu’elle est née pour se battre contre les Maurks. C’est son seul talent, c’est sa seule fonction, c’est son unique pensée. Alors, Gash se bat. Minimaliste, vous disais-je.
Gash la rage, par Petelus. Onabok éditions. Sur souscription.
Voir aussi chez Hector
-
TROIS VOYAGEURS - Fin
Allez, courage, on arrive au bout...
Ricardo fixa Mazetto de ses immenses yeux bleus : “C’est étrange. Avez-vous remarqué ?” Les deux convives se dévisageaient sans comprendre. Ricardo poursuivit : “Vos deux récits n’ont pas seulement des points communs ; ils pourraient se compléter. C’est-à-dire, être les deux actes d’une même pièce, deux chapîtres d’une même histoire. Dîtes-moi Theruel, après avoir enterré le comte Salina, qu’avez-vous fait ?”
Theruel haussa les épaules : “J’ai repris mon chemin en direction de la frontière”
-”Vous n’avez pas essayé de retrouver la personne qui vous avait lancés tous les deux dans cette folle équipée ?”
-”Ma foi, il n’y avait pas de nom sur le billet. Je n’avais aucune description. Comment la retrouver?”
-”Allons, dit Ricardo, une femme très belle, d’une certaine condition sans doute, dans un petit village comme Toffoli ! Ne pensez-vous pas qu’avec un peu de persévérance vous n’auriez pas fini par la retrouver ?”
Theruel semblait soudain convaincu :”Oui, peut-être...c’est facile à dire maintenant, mais à l’époque je n’ai même pas trouvé cela envisageable.”
Le vieil homme posa sa large main sur l’épaule du voyageur. “Rassurez vous Theruel, je ne vous blâme pas. Les actes, les choix que l’on fait ont une logique que seul le moment explique. Il est en effet facile, des années plus tard, de remettre en cause, de réécrire les heures de nos vies. A quoi bon ? Encore une fois, vous avez agi comme il fallait et pas un mot ne sortira de ma bouche pour vous condamner, mais, pardonnez-moi d’insister, j’ai envie d’approfondir vos récits dans cette perspective d’une même histoire que vous auriez partagée sans vous connaître encore, et qui met en relief toute la perverse puissance des ressorts de la destinée. Imaginons, cher Theruel, qu’après avoir enterré le cadavre du comte Salina, vous soyiez à Toffoli et que vous y trouviez, après disons un ou deux jours de recherches intensives, la jeune signorina dont nous a parlé Mazetto. Car je veux croire qu’il s’agit de la même beauté qui causa sans le savoir la mort du comte. Imaginez donc que vous lui expliquiez les raisons -on ne peut plus acceptables- du retard de son amant. Voilà une jeune femme qui ne vivrait plus dans le remords d’avoir trahi la mort de son frère pour un amoureux ingrat et oublieux. Le destin est d’autant plus malicieux d’ailleurs que, grâce à vous, cher Mazetto, la jeune femme est arrivée en retard à son rendez-vous...” Theruel coupa Ricardo : “...Et que, par conséquent, le comte n’avait pas de raison de se précipiter de la sorte.” -”Il se croyait en retard et serait arrivé en avance” ajouta Mazetto. -”C’est tragique” dit simplement Ricardo avec un terrible sourire. Puis il ajouta, alors que la plupart des voyageurs s’étaient retirés des tables autour d’eux, pour reprendre la route :” Mais après tout, ce n’est qu’une vue de l’esprit. Les similitudes de vos récits ne sont peut-être que des coïncidences, comme notre rencontre, et l’influence que chacun de nous vient d’apporter à chacune de nos vies. Nos routes vont se séparer, et notre destin n’est plus celui qui nous était tracé, ce matin encore. Tout cela parce que nous avions faim et que nous souhaitions un peu de compagnie. Je crois qu’il est temps de se quitter.”
Et Ricardo se leva pour disparaître dans la lumière aveuglante de l’extérieur. Sans un mot, Mazetto et Theruel l’imitèrent. Dehors, ils se regardèrent un moment puis, étreignant leur bâton de marche et ajustant leur sac sur l’épaule, ils prirent ensemble la direction de Torino.
FIN
-
TROIS VOYAGEURS - 8/9
Cinq jours s’écoulèrent. Je ne passais plus régulièrement chez les Grandini. Aussi, un jour, arrivai-je nonchalamment en fin de journée, prendre des nouvelles auprès de Nathanael. Ce fut la jeune servante qui m’ouvrit, toute surprise de me trouver là. Elle me précéda jusqu’au salon où je m’installai en habitué et alla chercher sa maîtresse.
Dès qu’elle entra dans la pièce, je remarquai à quel point elle avait changé en si peu de temps. Ses adorables joues s’étaient creusées et l’arc de ses épaules n’avait plus la belle assurance que je lui avais -quoique brièvement- connue. Je m’enquis de sa santé, elle me rassura sans conviction et vint s’assoir en face de moi. Je lui dis que maintenant qu’elle était entrée, je pouvais partir de Torino ; mais sa visible faiblesse, sa mélancolie navrante me serraient le coeur. Je lui demandai de me parler de ses tourments, comme à un ami véritable. Elle se leva, visiblement troublée, esquissant un pas puis renonçant, elle se mit à marcher très vite, de long en large devant moi, en se tordant les mains.
-”Qu’allez-vous penser de moi ?”
Qu’étais-je pour la juger ? Elle ne me laissa pas le temps de protester et vint se rassoir à mes côtés. La signorina conta ce qui suit sans me regarder à aucun moment.
“Je suis allée retrouver l’homme que j’aime. Je suis partie sans hésiter alors que je venais d’apprendre la mort de mon frère. Mon adorable grand frère qui me protégeait quand nous allions au marché en cachette, mon gentil Masino qui savait me chanter inocenta tortorella... Je n’ai pas hésité à trahir son souvenir, à piétiner mon chagrin pour courir plus vite dans les bras de mon amant. Un homme que mes parents m’avaient défendu de voir. Et savez-vous le plus triste de l’histoire ? Je suis arrivée trop tard. Ô, si vous saviez combien j’ai maudit la précieuse soirée que nous avions passé ensemble.
Après tout, que savais-je de lui ? Si peu de choses. Je l’ai attendu, je suis partie pour le dernier village où on l’avait vu... Rien. J’ai laissé des messages partout et envoyé une lettre pour vous, qui m’a fait souvenir d’un autre chagrin, d’un devoir plus impérieux que mes peines de coeur. Je suis donc revenue. Mais mon coeur est toujours là-bas, plus angoissé et impatient de le revoir que pendant ces quelques jours passés à l’attendre dans notre douillet petit nid d’amour.
A présent, je vous prie de m’excuser et d’oublier à jamais la mauvaise personne que je suis. J’aurais aimé vous connaître en d’autres circonstances. Adieu”.
Sur ces mots, elle se précipita dans la pièce voisine et verrouilla la porte derrière elle. Je ne sais trop ce que je ressentais à ce moment précis ; mais il y avait, je crois, autant de compassion que de colère. J’ai tourné les talons et suis resté le moins longtemps possible à Torino.”
-
TROIS VOYAGEURS - 7/9
Pourtant, au plein coeur de la nuit, un vacarme confus me réveilla brutalement. Je tendis l’oreille et reconnus le piaffement des chevaux dans la rue et le remue-ménage caractéristique d’un départ précipité. Profondément marqué par mon expérience de la guerre, j’envisageai immédiatement le pire : une réquisition ou une chasse aux déserteurs. Je risquai un oeil par la porte de ma chambre. La domestique qui m’avait accueilli s’encadra dans l’entrebâillement : “La signorina a finalement décidé de partir” souffla-t-elle. Elle était déjà toute habillée et portait un gros sac de voyage. J’enfilai prestement mon pantalon et sortis sur le pallier, qui donnait par une coursive, sur le vestibule. En bas, la jeune maîtresse dirigeait le départ. Levant la tête, elle me vit. “Je suis désolée, je ne peux pas retarder mon départ comme j’ai cru pouvoir le faire. Je vous laisse l’usage de la maison. Nathanael reste avec vous. Je serai de retour dans une semaine au plus. Me ferez-vous la grâce d’attendre mon retour ?”. Sans attendre ma réponse, elle sortit et grimpa lestement dans une calèche dont je ne voyais que l’ombre, depuis ma place. Le cocher fit claquer son fouet comme au départ d’une course et l’attelage disparut dans la nuit. Le domestique, resté seul en bas, ferma la porte et retourna se coucher après m’avoir gratifié d’un regard las et désabusé. J’hésitai encore un instant, debout devant ma chambre ; la soudaineté des événements m’avait laissé désarmé. Je résolus de suivre l’exemple de Nathanael.
Une semaine passa où je profitai sans grand remords de l’hospitalité de la maison Grandini, mais la signorina ne revint pas. J’attendis encore un jour ou deux puis décidai d’aller coucher au couvent des capucins car il me pesait d’abuser ainsi d’une gentillesse vite acquise. Je revenais chaque jour, régulièrement, frapper à la maison pour obtenir des nouvelles. Au terme d’une nouvelle semaine, Nathanael me tendit une lettre, à mon attention. C’était la soeur de Tomasino. Elle s’excusait de son retard mais des affaires importantes la retenait et elle ne pourrait sans doute pas rentrer avant encore une dizaine de jours. Elle me remerciait encore pour la délicate mission dont j’avais su m’acquitter et me priait de bien vouloir rester le temps qu’il me plairait dans sa maison. La lettre n’avait pas été affranchie et aucune provenance n’y était inscrite. Malgré mon insistance, Nathanael ne voulut pas me donner la moindre indication sur l’endroit où était sa maîtresse. Je pus seulement savoir, à force de ruses, que c’était un courrier militaire qui avait apporté la lettre. Je rentrai au couvent, intrigué. “Secret militaire ?” Je décidai de trouver un travail et un logement à Torino jusqu’à ce que l’étrange jeune femme soit de retour. Par ailleurs, ma situation de prisonnier évadé était régularisée.
-
Les mauvaises gens - Etienne Davodeau
Les Mauges, entre Cholet et Angers, une région vallonnée du Maine-et-Loire, rurale, catholique et ouvrière de l’ouest. Le récit débute dans les années 50.
Racontée par leur fils, par la grâce d’une BD exemplaire, voici l’histoire de Maurice et Marie-Jo, ouvriers qui s’éveillent à la conscience politique et au combat syndicaliste. Dans un pays extrêmement conservateur et catholique, cela demande du courage, beaucoup de courage.
Dans ce double portrait tendre et respectueux, drôle et souvent émouvant, c’est l’histoire de toute une région, et au-delà, celle d’une France en pleine mutation que l’auteur, Etienne Davodeau, raconte.
Souvenons-nous qu’il y a eu et qu’il existe encore une classe ouvrière, qu’elle est oubliée de la parole politique et récupérée par les plus cyniques. Il y a encore un combat à mener, des conditions de travail à faire évoluer, malgré la marche du monde. Et ce combat, des gens de peu l’ont mené. Ils avaient pourtant beaucoup à perdre. Une leçon.
« Les mauvaises gens » a reçu le prix du public, le prix du scénario, le Grand Prix de la Critique en 2006 à Angoulême, un palmarès rêvé auquel est venu encore s’ajouter le prix France Info 2006.
Je sors de cette lecture avec une pensée en marche, et de l’espoir. C’est assez rare pour que j’aie envie de vous faire partager immédiatement cette impression.
-
TROIS VOYAGEURS - 6/9
Torino était passé sous contrôle de l’armée française, dans le calme. J’avisai un jeune paysan qui se rendait en ville et lui transmis un message écrit, en piémontais, à l’intention d’un frère du couvent des capucins que je connaissais bien, afin qu’il me rejoigne en marge du petit village où je m’étais réfugié. Dans la journée, je reçus la visite de Fra Angelico, un ami de mes parents, un brave homme, porteur d’habits civils propres, de nouvelles et d’une bonne collation. Je lui contai mon aventure et lui révélai donc ma mission.
Le frère connaissait bien la ville et se proposait de me guider jusqu’à la soeur de Tomasino. Je dois dire qu’après un bon repas, une toilette soignée et des habits frais, on est un autre homme. Le sens de ma mission et son poids véritable se faisaient à présent plus cruellement sentir. Après une courte halte au couvent, mon ami me fit traverser le Pô et nous entrâmes dans Torino. En d’autres circonstances j’aurais apprécié de flâner un peu, de m’enivrer du bruit des rues commerçantes, des conversations qui trainaient sur la via dell’Academia, les rires des enfants... Les bruits de la paix, que je n’avais pas entendus depuis si longtemps. Nous fûmes bientôt dans l’ombre de Santa Christina et l’une des maisons était celle de mon ami, et donc celle de sa soeur. Fra Angelico eut la gentillesse de me proposer encore son aide, j’eus le courage de la refuser et, comme il s’éloignait, je goûtai la douceur de l’air avant de frapper, résolument.
Une jeune femme m’ouvrit, c’était une domestique, je lui expliquai que j’étais un ami du frère de la signorina Grandini et que j’avais une nouvelle importante à lui communiquer. Le ton de ma voix devait exprimer assez de quelle “nouvelle” il pouvait bien s’agir. La jeune femme s’effaça pour me laisser entrer et se précipita dans une salle contiguë, me laissant un peu penaud dans le vestibule. La signorina apparut. Elle était très belle. Si belle. Ô, la plus belle femme que j’aie jamais vu. Le teint pâle, des yeux violet, un visage de madone aux lèvres sensuellement dessinées, le cou et les épaules finement déliés. Elle portait ce jour-là une robe pâle, couverte de dentelle. J’avais côtoyé Tomasino pendant des semaines sans me douter un instant de sa condition bourgeoise. Enfin, devant mon air grave, elle me pria de parler en s’excusant de ne pouvoir m’accorder que quelques instants, parce qu’elle devait partir. En effet, je remarquai à ce moment là une malle de voyage toute prête. Je dus donc m’exécuter, debout dans le vestibule, face à cette créature superbe. Quelle épreuve ! Je finis tout de même par lui annoncer la mort de son frère et lui assurer que ses dernières pensées avaient été pour elle. Elle trouva appui sur la malle et secoua la tête en répétant : “Masino, Zino, mon Masaccio. je ne comprends pas...”
Je fréquente peu la compagnie des femmes et ne savais trop que dire pour la réconforter mais, fort heureusement, elle sembla prendre le dessus et se donner assez de contenance pour paraître surmonter son chagrin. Après de nombreux atermoiements, elle me pria de souper avec elle pour me parler de son frère et prévint sa maisonnée que le départ était finalement remis au lendemain.
Malgré les circonstances, je dois dire que je fus reçu magnifiquement. Le souper, passé en tête-à-tête avec la plus belle femme de ma vie, fut agréable, malgré l’ombre de Tomasino qui planait au-dessus de nous. La chambre qu’on mit à ma disposition me récompensa de mes douloureuses nuits de fugitif.
-
TROIS VOYAGEURS - 5/9
Dans l'auberge, les deux auditeurs de Theruel s'étaient approchés pour mieux écouter la fin de son récit, raconté sur le ton de la confidence. Mazetto était songeur et Ricardo s'abîmait dans la contemplation de son assiette vide. “C’est curieux, dit Mazetto, ton aventure m’en rappelle une autre où il est question de lettre, de femme, de guerre et de mort”. Et Mazetto, ayant ainsi appâté son auditoire, entama son récit :
“J’étais engagé contre les Français, avec les Autrichiens, par idéal, et je me liai d’amitié avec deux compagnons de combat. L’un déserta dès le premier feu ; l’autre, Tomasino, mourut dans mes bras le soir de la bataille de Rivoli pendant laquelle la cavalerie française nous tailla en pièces. J’étais parmi les milliers de prisonniers, tous plus ou moins mal-en-point, rassemblés en colonnes compactes par nos vainqueurs. Je soutenais tant bien que mal Tomasino, mais le pauvre se vidait de son sang et j’avais beau réclamer des soins pour mon ami (dans un français approximatif, il est vrai), les soldats passaient, indifférents, ou me hurlaient d’avancer. Il y eut un moment où Tomasino ne tint plus sur ses jambes et où je n’eus plus la force de l’épauler. Je m’effondrai avec lui sur le talus du chemin. Il essaya de me dire quelque chose, refusant vivement l’eau que je lui proposai. Un soldat s’arrêta près de nous. Il vit mon camarade murmurer à mon oreille et, à ma grande surprise, nous laissa en paix pendant tout ce temps. Il jetait même un coup d’oeil autour de nous, au cas sans doute où surviendrait un officier. Masino eut donc le temps de me demander d’aller chez sa soeur à Turin et de la prévenir de sa mort ; il la suppliait aussi de dire une prière pour lui. Il mourut. Ma misérable situation et l’importance de ma mission m’obligèrent à taire mon chagrin. Plusieurs jours s’écoulèrent pendant lesquels notre colonne s’éclaircit considérablement. Nous avions faim, nos gardiens et nous-mêmes, aussi il n’était pas rare que les français nous utilisent pour aller réquisitionner de la nourriture dans la campagne. Nous étions encadrés évidemment, mais tout cela se faisait avec assez de bonhomie et l’on voyait, sur les places de village, des français, des autrichiens et des italiens se partager en riant des quartiers de boeuf. Guerre étrange. Donc, au cours de ces excursions, je me retrouvai avec quatre hommes de ma compagnie qui avaient commis de nombreuses rapines et s’étaient faits une réputation de pourvoyeurs de nourriture de part et d’autre de notre étrange convoi.
On nous avait laissés à la garde de deux soldats -seulement- parce qu’on connaissait le zèle que mettrait mes camarades à s’acquitter de leur glorieuse tâche. Comme vous pensez bien, je faussai compagnie à ce petit monde solidaire à la première occasion et pris par la montagne le chemin pour Torino. Je marchai seul pendant des jours, en toute quiétude dans ces contrées désolées et me retrouvai enfin, sale et déprimé, en vue de la plaine. Encore une journée de marche, et je verrais les tours de la grande ville.
-
TROIS VOYAGEURS - 4/9
Durant les deux jours de marche pénible que nous fîmes ensemble, je fus frappé par l'énergie et le courage inépuisables de mon compagnon. Rien ne l'arrêtait, ni les passages escarpés, ni les villes en flammes, ni la peur de la mort et, chaque fois qu'il extirpait de ses vêtements déchirés et sales la carte froissée qui lui servait de guide, l'impatience et la rage le défiguraient. "Nous n'allons pas assez vite" disait-il en repliant la carte ; puis nous nous lancions à nouveau dans notre folle équipée. La nuit du premier jour, je l'obligeai à nous reposer un peu. Je ne pouvais plus avancer et j'avais horriblement faim. Lui voulait continuer coûte que coûte. Il m'insulta, me bouscula, mais j'en avais vraiment assez. Finalement, il parvint à se calmer et se résolut à faire un feu pendant que je cherchais de quoi manger dans une ferme abandonnée que j'avais repérée.
Les lits de la ferme étaient accueillants mais nous ne voulions pas risquer d'y être surpris. La forêt semblait un refuge plus sûr. Je m'endormis profondément après un consistant repas. Je me surprenais à recouvrer un peu le moral après toutes les difficultés de ces dernières heures. J'avais une gibecière pleine de vivres, du pain et du vin, un bon feu, une douce nuit... et notre marche forcée nous éloignait des combats. Lorsque le comte me réveilla il faisait nuit noire et les braises rougeoyaient encore entre les pierres.
"Allons, dépêchons, en route soldat !"
"Je ne suis pas soldat !".
Le comte ne releva pas ma remarque et m'expliqua que, attiré par un bruit d'équipage, il s'était approché discrètement de la ferme et y avait surpris deux cavaliers, deux mercenaires dont l'un était blessé, se réfugiant dans la bâtisse. Selon lui, ils avaient fait l'erreur que nous n'avions pas commise. C'était l'occasion de se procurer deux montures pour filer au plus vite vers Toffoli : toujours cette obsession d'arriver à l'heure à son rendez-vous. Nous pourrions ainsi y être au petit matin et rattraper le retard "causé par (ma) fatigue".
Je suis un voyageur, un peu aventurier certes, mais voler un cheval à des mercenaires ne me disait rien. Je lui signifiai que notre collaboration ne pourrait se prolonger. Il m'injuria, bien sûr, me traîta de lâche et d'ingrat, tout prêt à en découdre avec moi pour me faire entendre raison. Enfin, plus pressé que résigné, il m'abandonna pour courir vers la ferme. "Si vous la connaissiez..." me lança-t-il en disparaissant. Un peu plus tard, alors que, trop énervé, je tentais de retrouver le sommeil, j'entendis des hennissements, une cavalcade, puis le silence. Je pensai avec un brin d'attendrissement à cet amoureux fou et m'endormis. Le lendemain matin, tout cela me semblait un rêve vague. Je me glissai furtivement jusqu'à la bâtisse pour découvrir les deux mercenaires enfourchant leur monture, laissant derrière eux, au milieu de la cour, le cadavre de mon comte trop pressé.
Je fouillai ses habits pour savoir s'il avait un proche, un parent à prévenir, et trouvai la carte, de l'argent et une lettre pliée. C'était un billet d'amour signé "Ta douce", un rendez-vous galant, donné à Toffoli, pour le jour même, à midi. A midi, je posai une croix improvisée sur la tombe de fortune du comte Salina, mort par impatience."
-
TROIS VOYAGEURS - 3/9
Je me demandais ce que je faisais là et ce qu'il allait advenir de nous lorsqu'une main se pose sur mon épaule. C'était un homme de quarante ans, un italien. Il m'adresse le premier sourire de cette terrible journée et m'attire dans un coin.
"Tout-à-l'heure, je vous ai vu traverser les lignes pour nous rejoindre. J'attends une lettre de la plus haute importance. Je suis le comte Salina. Peut-être êtes-vous mon messager ?"
Je le détrompai, et lui expliquai les péripéties qui m'avaient conduit ici. Le comte hocha la tête. Il avait l'air furieux.
"Alors, il faut que j'aille à Toffoli, il le faut. J'ai assez attendu." Il jeta un regard circulaire à la foule blottie sous la dérisoire protection des balcons.
"Si vous êtes aussi peu concerné que moi par ces combats, et si vous voulez être en vie demain, aidez-moi à fuir la ville."
Sur l'instant je n'ai pas trouvé curieux qu'un homme, apparemment impliqué dans la défense de la ville, et attendant un message de l'armée, puisse se dire "peu concerné" par les combats qui avaient massacré bon nombre de ses concitoyens ; alors j'ai acquiescé.
Et nous voilà tous les deux, abandonnant les pauvres gens à leur sort, zigzaguant à travers la mitraille qui se rapprochait, à la recherche d'un attelage abandonné. Le trouver était facile, mais maîtriser les chevaux affolés... Bref, j'y parviens et le comte s'empare des rênes au moment où, comme par magie, le bombardement cesse, laissant place à un silence terrible. "Ils vont charger" dit-il et il lance la carriole à travers les rues de la ville.
Comment sommes-nous sortis de là, je ne sais pas, mais je me souviens de la fureur et de la hargne du comte, aux commandes de l'attelage. Il hurlait, rageait, insultait les bêtes, tirait avec tant de force sur les guides qu'il semblait lui-même faire tourner la voiture. J'observais mon compagnon de fortune, fasciné : son visage était un masque de haine et de colère formidables, ses yeux avaient un éclat magnétique qui m'ôtait toute énergie. Notre carriole se trouva bientôt au milieu d'une large rivière. Les chevaux épuisés par notre course démente se laissèrent mourir en touchant la rive opposée. Derrière nous, une clameur lointaine s'éleva de la ville en flammes.
"Le sac a commencé" dit le comte, sans exprimer la moindre émotion.
Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à le détester. J'avais une dette envers lui : il m'avait sauvé la vie certainement, mais je lui demandai de m'en acquitter immédiatement. Le comte retrouva son sourire aimable et posa sa main sur mon épaule. "Je dois me rendre à Toffoli, rejoindre celle que j'aime. Pour moi, rien n'est plus important que cela. Je vous demande seulement de m'accompagner, mon rendez-vous se trouve à moins de vingt lieues d'ici. Je vous laisserai ensuite, avec de bonnes pièces d'or pour continuer votre voyage. Qu'en dites-vous?”
Evidemment, rien ne me retenait, et pourquoi ne pas aller dans cette ville que je ne connaissais pas ? J'acceptai.
-
TROIS VOYAGEURS - 2/9
"C'était au plus fort de la guerre. En tant que ressortissant espagnol, je pouvais traverser l'Italie sans être inquiété, mais cette fichue pagaille ! Partout des cavaliers piémontais fringants et fiers mais fuyant devant les va-nu-pieds français. Et les soldats de Napoléon, hargneux et meurtriers... ils vous fusillaient la populace comme on remonte une pendule : avec autant de conscience ! J'essayais d'éviter les combats tout en poursuivant mon voyage vers le nord. Belle gageure : c'est là où ça canardait.
Un jour donc, au coeur d'une forêt que je traversai pour contourner une modeste ville copieusement bombardée, je me trouve face à une grosse compagnie française qui venait au secours de leurs positions autour de la cité. Ils avançaient à travers le bois, baïonnettes au canon. Je ne me sentais pas le courage de discuter avec ces têtes de bois que j'avais vues, la veille encore, embrocher une malheureuse femme et deux de ses enfants. Je fuis donc devant cette troupe fatale et me retrouve au beau milieu des lignes de canons français qui pilonnent la ville. Je ne sais pas trop pourquoi, parce que cette pauvre bourgade n'était déjà plus que son fantôme, avec ses remparts rongés par la mitraille.
On me voit, on m'interpelle au milieu des coups de canon et de la fumée. Je poursuis mon chemin. Il y avait encore quantité de vergers à peu près en état entre les lignes françaises et celles de défense de la ville. Je me cache, vais d'arbre en arbre, échappe à une sévère escarmouche provoquée par quelques gaillards en civil tentant une sortie... Bref, je parviens à la porte la plus proche, défendue par quelques soldats exténués. La canonnade reprend de plus belle ! Les boulets fusent de partout, un enfer ! Je vois, sous mes yeux, disparaître la vaste porte de la ville, et la muraille, et les soldats... volatilisés en quelques secondes ! Je me précipite et entre dans les faubourgs. C'est la confusion la plus complète, une maison s'effondre à quelques pas de l'endroit où je viens de passer. Tout en maudissant le destin qui m'a poussé là, je me retrouve au milieu d'une cohue indescriptible. Je vois des attelages fous qui traversent des volutes de fumée noire, des barricades de fortune. Je heurte quelque chose et tombe. En me relevant, je réalise que ma chute a été amortie par un véritable matelas de cadavres. Partout autour de moi on hurle, on geint, on pleure, les murs explosent, les flammes crèvent les toits qui s'effondrent... Je ne sais plus où je suis ni où je dois aller. Tout-à-coup, le voile noir d'un incendie se déchire et devant moi, le soleil vient juste frapper une énorme batisse qui semble miraculeusement épargnée par les bombes. D'ailleurs, deux ou trois personnes s'y engouffrent et je me précipite à leur suite. A l'intérieur, une véritable foule s'est rassemblée et observe notre petit groupe, sans la moindre expression de curiosité. Tous ces gens sont atterrés, perdus, terrorrisés. Je découvre alors que nous sommes entrés dans un vieux théâtre, qui fut somptueux, avec des quantités de chérubins et de guirlandes dorées qui s'accrochent aux balcons. La fresque de la voûte s'était détachée par plaques entières et les décors bouleversés d'un opéra interrompu dessinaient une sorte d'architecture de cauchemar depuis la scène jusqu'aux premiers rangs.
-
TROIS VOYAGEURS - 1/9
Les dolomites. 1834. L'auberge de Vigo di Fassa, au pied de Tondi di Faloria était une bénédiction des hommes du pays faite aux voyageurs inconséquents. La route qui avait commencé à prendre une pente sérieuse depuis Canazei, devenait, après quelques kilomètres, éprouvante puis tout-à-fait inhumaine : la pente était telle et le sentier si mauvais qu'on avait renoncé depuis longtemps à y faire passer les chevaux. Seuls les ânes, les mules et les hommes parvenaient à Vigo encore assez frais pour avoir le courage d'en repartir au cours de la même journée. De là, en effet, le chemin glissait en pente aimable et entraînait le voyageur jusqu'à Santo Stefano, dans les meilleures conditions. Ce qui, invariablement, inspirait les discussions plaisantes des clients de l'auberge, attablés ensemble.
Ceux qui venaient de Canazei, épuisés, raillaient gentiment ceux qui avaient fait le chemin depuis Santo Stefano. Ils leur prédisaient l'enfer, détaillaient les ruisseaux impétueux à traverser, le sol irrégulier, les pierres qui roulent sous la chaussure, les chemins éboulés par endroits ; quant aux autres, incrédules, peu préparés par la douce pente opposée qu'ils venaient de gravir, ils haussaient les épaules. Certains s'attardaient même déraisonnablement, et il n'était pas rare de rester sans nouvelles d'un voyageur nonchalant, surpris par la nuit au plus dur du chemin. On disait que les gouffres d'ici expédiaient plus d'âmes au diable que les guerres.
Mazetto était de ceux, encore tout frais, qui venaient de Santo Stefano ; Theruel avait, quant à lui, affronté la terrible pente opposée, mais son expérience datait de la veille. Il avait dormi à l'auberge et attendait la mi-journée pour descendre doucement sur Santo Stefano.
Les deux hommes étaient de solides gaillards à l'esprit nomade jamais rassasié de visions.
Il existe entre les personnages singuliers une reconnaissance tacite, une complicité du premier regard.
Theruel et Mazetto s'étaient donc immédiatement reconnus comme des êtres semblables et leur amitié toute neuve s'affirmait davantage à chaque rasade de vin.
Ils échangeaient des considérations sur les spiritueux des divers pays qu'ils avaient parcourus lorsqu'un troisième personnage, qu'ils avaient déjà vu à l'auberge, vint les rejoindre pour prendre son repas. Il s'excusa poliment de son irruption, se présenta comme le propriétaire des plus grands troupeaux de moutons de la région et seul éleveur de la race des Gimmons dont les béliers sont, dit-on, sournois et meurtriers. Il leur proposa, pour dédommagement de son impolitesse, de partager son repas.
Devant les protestations de principe des deux voyageurs, l'homme leur assura que la dernière vente de ses Gimmons lui permettait cette petite générosité dont le Très-haut, sans doute, lui saurait gré.
Ils acceptèrent finalement et le repas fut promptement commandé. L'intrus disait s'appeler Ricardo, c'était un homme solide, vieilli par le travail et la dureté du climat. Il parlait bien, s'exprimait avec douceur. Mazetto et Theruel voyaient un peu en lui ce qu'ils seraient quand l'âge leur interdirait de repartir sur les routes.
Un sauté de lièvre bien arrosé réchauffa les esprits et la conversation allait bon train. Mazetto venait d'expliquer comment il avait pu échapper à une fusillade au temps de l'invasion française, ce qui fit dire à Ricardo que la guerre était une bien terrible chose.
Un silence vint brièvement ponctuer la conversation. Theruel reprit la parole, après avoir longuement observé son gobelet. Il raconta l'étrange histoire qui suit, sans que ces compagnons ne l'interrompent.
-
Les stats
Marrant. L'an dernier, quand j'avais repris Kronix, après une longue aphasie (comme celle qu'il a connu encore récemment, d'ailleurs), les statistiques avaient immédiatement repris des couleurs, et le nombre s'accroissait chaque jour, doublait parfois. Pour atteindre 3000 visteurs/jour (et les limites de la bande passante pour cette version) au moment où je l'ai à nouveau saborder (je fais ça chaque année : cette version de Kronix arrêtera normalement vers le 15 décembre). A l'époque, il s'agissait de petits textes d'humeur, des récits de petits moments de la vie drôles ou émouvants. Pas de fiction. Et ça marchait. Cette année, je tente la diffusion de mes fonds de tiroirs littéraires. Personne, ou quelques fidèles, et la tendance de fréquentation est à la baisse.
Rien de grave, je ne vis pas pour ça, mais ça donne une idée de ce que les internautes viennent chercher sur les blogs. L'an prochain, si tout se passe bien, Kronix décrira l'évolution de plusieurs projets de bande dessinées, qui ont déjà bien avancés et qui sont en passe de trouver leur éditeur. On verra ce que la blogosphère en pense. Je suppose que ça devrait marcher.
Voilà, c'était pour nourrir un peu le billet d'aujourd'hui, qui était un peu maigre.
A bientôt.
-
Sous mes pas
Selon ce rythme je marche Les pas sont innombrables
Et chaque est multiple
C’est l’univers et le chaos rassemblés sous ma semelle
-
HOTE
Hôte : L’étude étymologique concilie des principes aussi éloignés en apparence qu’une hostie, une armée et un otage. Il a suffi que le latin dise hostire signifiant alors « compenser », « égaliser », pour que les premiers chrétiens, doloristes, s’emparant de l’hostia (victime), aboutissent à l’hostie. Qu’est ce qu’un otage, sinon un hôte, qu’on incite fermement à goûter une hospitalité forcée ? Et l’hôte (hostis), considéré bien sûr comme un étranger (hostes) forcément suspect, devient bientôt l’ennemi (hostes également). De là à résumer cette hostilité par le mot hostis (armée ennemie), il n’y a qu’un pas, que l’ost ou host, chère aux cruciverbistes, s’est chargée de franchir.
-
Ce jour-là...
Il y aura sur l'horizon une barre de brume mauve, immobile et pâle. Votre rire, frais et brisé, jouera entre les cailloux des collines. Vos mains, salies au contact des roches, exhaleront un parfum de fougère et de mousse. Vous aurez des gestes d'enfant, et la vie des humains, lointaine, se sera tue.
Depuis le sommet où vous serez assise, vous contemplerez la terre qui s'ensommeille sous le jour déclinant. Le monde s'emplira du seul bruit de votre respiration.
Du seul bruit de votre respiration.
Vous serez seule. Là, vous reviendront d'anciens échos. Murmures éteints, images fanées.
Des visages oubliés, des sourires disparus se mêleront aux voix passées et voudront dire j'existe encore. Ils n'auront pas de noms, mais la douceur grise des choses qui ne sont plus. Vous balaierez d'un geste ces fantômes, et plongerez votre regard une dernière fois ; là où le ciel s'étend sur la terre. Alors, vous reprendrez le chemin vers le monde des humains, laissant sur les genêts, autour de vous, les âmes aveuglées qui firent votre passé. Sans regret. Sans que j'y paraisse.
-
Une vérité qui dérange - Al Gore
L'autre jour, notre maire a pris l'excellente initiative d'imposer à tous ses agents la vision du film "Une vérité qui dérange". Sans doute parce que, découvrant le phénomène lors de la fameuse séance à l'assemblée (il est aussi député), il s'est soudain senti un devoir (sincère, je crois), de montrer le film pour encourager les citoyens que nous sommes à changer d’attitude.
Je ne veux pas exagérément ratiociner sur tout ce qui va dans le bon sens. Et le documentaire inspiré de conférences menées par Al Gore depuis quelques années à travers le monde a permis à bon nombre de gens dans la salle de prendre conscience de l'urgence (j'ai écrit à notre élu à ce sujet en lui proposant un certain nombre de questions concrètes sur ses choix en matière d'environnement).
Une série d’illustrations spectaculaires et efficaces démontre la vérité et l’urgence de la réaction, car nous sommes vraiment montés dans une locomotive lancée plein pot contre la falaise. Et l’échéance est de l’ordre de la dizaine d’années. C’est un cri d’alarme terrifiant. Mais « l’ex-futur président » rassure tout le monde à la fin : il est possible d’enrayer le phénomène si tout le monde se montre raisonnable, comme on l’a fait pour la couche d’ozone.
Scientifiquement, les problèmes se situent dans sa conclusion, très rapidement évoquée. Revenir à un taux d'avant 1970 est une bonne chose, mais loin d'être suffisante. Et dans son calcul, il fait entrer la technique de "capture de carbone" qui n'est encore que théorique et, selon le type choisi, peut se révéler très dangereuse. En fait, ce n'est pas une solution. La solution est dans le changement d'attitude de tous. Ce qui m'inquiète, et dont on va voir apparaître les données dans les années qui viennent, c'est ce que nous préparent les puissances occidentales pour le futur, scientifiques à l'appui : des solutions d'urgence totalement artificielles pour réduire le CO2. Enfouissement dans les fosses marines, grandes voiles synthétiques dans l’espace pour créer des taches solaires artificielles ( !)... des solutions potentiellement plus dangereuses que le problème. Mais qui permettront de faire croire aux consommateurs que nous sommes qu'on peut poursuivre allègrement le gaspillage des ressources et acheter, acheter, acheter tranquillement, puisque, au dessus de nous, les scientifiques veillent et ont trouvé la solution. D'autre part, il me semble impossible de convaincre les pays émergeant comme la Chine de ne pas faire les conneries que nous avons faites, nous. Il suffit de projeter le concept un peu plus loin pour dessiner la perspective de la première guerre d'intervention pour raisons écologiques : il n'est pas interdit de penser que les grandes puissances occidentales mettent au pas la Chine militairement, pour l'empêcher de nuire à l'environnement. On a encore des tas de trucs à tester avant de disparaître.
Malheureusement, je crains qu'il ne soit trop tard. Oui, il faut faire les efforts demandés, on n'a pas le choix. Mais me reviennent toujours dans ces cas-là les images de l'île de Pâques, où des types, isolés sur leur petite planète au milieu du pacifique, ont poursuivi consciencieusement la désintégration de leur environnement jusqu'à ce que mort s'en suive. C'étaient des humains comme nous. Nous ne sommes pas plus subtils qu'eux.
-
Ma thébaïde
Mon ermitage solitaire, ma thébaïde, mon antre, mon refuge, mon bureau… Je travaille à présent au fond d’une réserve de musée de province, entre deux étagères de momies (je suis sûr que vous croyez que je plaisante, là), avec pour seule perspective une bâtisse art déco de l’autre côté de la rue. Je passe parfois des journées entières sans que personne ne descende l’escalier qui mène à ma retraite.
Le silence, les heures qui passent dans l’étude des œuvres et l’effeuillage des registres… Je me prends à rêver d’une vie d’ermite oublié, dont on évoquerait l’existence légendaire sous la forme du conte : « Oh, je me souviens, oui. Il y avait bien un type, là, qui est un jour descendu dans les souterrains… On ne l’a jamais revu. Parfois, les gardiens de nuit disent qu’on entend des soupirs, mais il n’y a personne ». Oui.
L’idéal serait une administration un rien kafkaïenne, qui négligerait de me savoir rentable, utile, ou vivant (si quand même vivant, faut bien que la paye tombe). Là, vieillissant à la limite du vieillissement, la peau diaphane à force de pénombre, la barbe longue et les yeux translucides des prophètes, je me rapetisserais jusqu’au minuscule, courbé plié froissé, on m’oublierait et j’écrirais. J’écrirais les heures du jour qui obliquent par la fenêtre, caressent le ventre des momies, j’écrirais le silence des gravures percé par les bruits de la rue. Le doux démembrement du temps sous les voûtes séculaires et l’apocalypse raisonnable de la ville. Je serais visionnaire, inspiré, illuminé et tremblant, parce que sorti du monde, rentré dans le ventre obscur des enfers du musée, rien ne m’atteindrait que le souffle d’agonie du dehors qui se croit en vie. Sur leur toile, les faux visages qui miment l’existence et la chair poursuivraient leur sourire inquiet, chanteraient pour moi, vieux compagnon, de murmurants refrains. Je serais bien.
-
L'absent - 2/2
Il n’y avait plus que la chambre de maman. J’ai tout de même viré le matelas du lit pour coucher dans le salon. Dormir dans le lit où elle était morte, entourée de photos de Seb, ça me foutait les jetons.
J’ai eu du mal à dormir le premier soir, le mausolée à la gloire de mon frère dans la chambre, ces dizaines de photos de toutes les tailles, ça me hantait. Je me suis endormie dès que j’ai pris la résolution de tout ranger le lendemain matin. Après le petit déjeuner (je vous passe les détails : l’eau n’était pas rétablie, il a fallu que j’aille acheter des bouteilles à la supérette, à un kilomètre de là), j’ai ouvert en grand les fenêtres partout. J’ai aéré la chambre à la grande surprise des acariens qui n’avaient pas dû voir le jour depuis des années, et j’ai commencé à ranger. Les fringues sentaient le moisi, de la crasse noire s’était développée sur les vitres, j’avais envie de foutre le feu tellement c’était crade. J’ai remisé les photos du vénéré Seb dans des cartons trouvés à la cave. La cave, là c’était le sommet (enfin, en bas, mais un sommet tout de même), un bric-à-brac monstrueux, commencé du temps de papa qui ne jetait jamais rien, prolongé et multiplié par maman, d’une façon maladive. Vingt ans de récupération de roues de vélos, de paniers crevés, de chaises cassées et de moteur de frigos. Là, je me suis décidée à foutre le feu. J’ai entassé dans le jardin tous les trucs susceptibles de brûler sans trop de fumée. C’était crevant, mais magnifiquement exutoire ! Je me suis juste arrêtée un moment pour manger, en contemplant ce feu de la Saint-Jean que j’avais organisé pour moi seule. Je n’avais rien de mieux à faire, le chômage assurait le minimum, vivre ici m’économisait un loyer… Je me suis concentrée sur le nettoyage de la maison. La cave se vidait, les pièces du haut reprenaient un peu de couleurs, j’avais arraché les vieilles tapisseries… Enfin, il y a eu cette grosse armoire découverte derrière le capharnaüm de la cave.
C’est là que j’ai trouvé les lettres de maman. Des lettres adressées à Seb, où elle lui disait de lui pardonner. Des lettres jamais envoyées, puisque le destinataire n’avait pas donné d’adresse. Il y avait peu de dates, sauf une : quelques mois après la disparition de mon frère. Peut-être la première de la série. Mais aucune indication sur ce qu’elle voulait se faire pardonner. C’était très vague, un peu délirant même. « Tu t’obstines à ne pas me répondre… », « Tu refuses de me regarder, ça me met en colère », « tu devrais manger mieux… » ; comme si Seb était resté avec elle. D’un coup, la solitude de maman, dans cette maison abandonnée, cernée par les photos d’un fils fantomatique, m’est apparue dans toute son horreur. Elle était devenue folle. Et je n’en savais rien. J’essayais de me remémorer nos conversations. Elle semblait normale, triste mais saine d’esprit. Elle faisait ses courses comme tout le monde, payait ses impôts, était suivie médicalement… Pas vraiment sociable, mais pas non plus marginale. Juste une femme mûre qui fume trop et se méfie des étrangers. Si j’allais la voir, elle ne me parlait pas de Seb, moi j’évitais le sujet, et elle restait muette à boire son thé face à moi, jusqu’à ce que je me décide à partir. Elle ne me jetait pas, mais elle ne me retenait pas.
L’autre jour, François est passé me voir, mine de rien. Je ne suis pas prête du tout à envisager l’avenir avec lui, mais il essaie de me la jouer « soyons amis tout de même ». Il y a tellement de boulot dans cette baraque, que pour la première fois de ma vie je me vois franchement cynique. Je lui ai suavement demandé de venir me donner un coup de main pour, au moins, débarrasser l’armoire monumentale dans la cave. Tout content, il était. On a décollé l’armoire du mur. « Tu savais qu’il y avait une pièce, là derrière ? ». En effet, c’était muré grossièrement avec du ciment mal lissé, mais on voyait bien une porte condamnée. J’ai serré le bras de François, j’avais peur soudain. Il m’a regardé, d’un regard qui voulait dire : « Tu veux vraiment savoir ? » J’ai acquiescé sans réaliser. Il est allé chercher une masse et a commencé à défoncer les moellons. Quand le trou a été assez grand, François a braqué un faisceau de lampe torche de l’autre côté. Mon cœur s’est arrêté. Il y avait une masse grise par terre ; j’ai su tout de suite ce que c’était. Qui c’était. Seb. Ma mère l’avait enfermé là, des années auparavant, et l’avait laissé mourir. Pour qu’il ne la quitte jamais je suppose. Et moi, j’ai réalisé soudain que ce n’était pas ma mère qui cognait sa tête contre la cloison de ma chambre, autrefois. C’était Seb qui appelait sa sœur au secours.
Fin
-
L'absent - 1/2
A la mort de maman, j’avais des tas d’emmerdes. Je venais de quitter mon boulot et François (puisque le deuxième me fournissait le premier) ; pareil pour l’appart’ où nous vivions ensemble, vu que c’était le sien. La mort soudaine de ma mère est venue en point d’orgue sur cette cascade de problèmes.
D’ailleurs, j’ai la poisse, de façon générale. Mon père est mort quand j’avais seize ans ; mon frère adoré, qui avait vingt ans à l’époque, s’est barré de la maison deux mois plus tard, après une ultime dispute avec maman. Faut dire qu’elle était devenue insupportable. Depuis, plus jamais de nouvelles. C’était il y a longtemps, mais la blessure est toujours vive au fond de moi. Maman aussi a eu du mal. En fait, plus rien n’a jamais été comme avant. Elle s’est enfermée dans le silence, ne voyait plus personne. Je n’ai pas attendu la majorité pour aller respirer ailleurs. Dès que j’ai trouvé un type assez cool pour me prendre avec lui, je me suis barrée. Maman avait l’air aussi soulagée que moi de me voir partir. Ça aussi, ça m’a fait du mal : je me suis rendue compte qu’en dehors de Seb -mon frère- personne ne comptait pour elle. Après sa disparition, plus rien n’avait d’intérêt à ses yeux. On se voyait peu, je lui téléphonais de temps en temps. Jamais elle ne m’appelait.
Et voilà, j’ai hérité de cette maison où elle a vécu seule pendant vingt ans.
J’avais essayé de la vendre, mais beaucoup de gens reculaient devant le mauvais état de la villa. Et puis dedans, il y avait tout ce bordel que je n’avais eu ni le temps, ni le courage de débarrasser. Je suis comme ça, faut pas se mentir : une feignante. Finalement, la maison me servirait de dortoir en attendant de retrouver un boulot, de prendre un nouvel appart’. Deux-trois mois à vivre au milieu du passé, je pense que c’est jouable. La chambre de Seb était restée inviolée comme une tombe, tout était en place, du poster défraîchi aux bouquins poussiéreux. Pas envie de dormir dans son ombre. Ma mère avait réquisitionné ma chambre pour entasser des vieux meubles, des bouteilles de gaz, tout et n’importe quoi. Je n’y étais pas rentrée depuis mon départ.
Je me souvins de l’ambiance terrible des derniers temps, quand j’entendais ma mère cogner sa tête contre la cloison, longuement, comme une folle. Je gueulais, elle s’excusait, mais elle disait que ça la calmait.