 Dix-sept mètres sous les voûtes, l'architecture d'une abbaye livre des secrets inaccessibles à ceux qui se croient grands. Quand on n'a que cinq millimètres de taille, tout est différend. La fourmi de Laurent Cachard déambule au ras du sol et s'éleve malgré cela au dessus des prétentions humaines, en tout cas à hauteur du sacré que l'humain investit de ses angoisses. L'insecte est crypto-sagace. Elle échappe à sa colonie et traverse tout le paysage, le long d'une trajectoire suggérée par Jean Frémiot. Autre paradoxe : la courte profondeur de champ n'empêche pas la profondeur des réflexions, en plus de la hauteur de vue. L'insecte et le Sacré est une jolie promenade où s'égrènent les pensées d'un promeneur qui a délégué sa parole à la modestie de l'infime, au niveau de l'interstice, une agréable mélodie au rythme des pattes et au hasard des sensilles. On y trouvera les rives d'un noir lac, des psychopompes, des entomologistes lancés sous les arcades géminées dans une partie de cache-cache, un souvenir d'apostasie, la nostalgie d'une pureté cistercienne, la menace de la blastogénétique et un peu de Hugo, sorte de "Père immédiat", qui clame l'évidence de l'existence en fin de parcours. Si vous n'avez pas tout compris des lignes qui précèdent, et bien, lisez ce petit bijou. C'est, mine de rien, un condensé érudit et plein de tendresse pour l'humanité et ses dérisoires élans spirituels.
Dix-sept mètres sous les voûtes, l'architecture d'une abbaye livre des secrets inaccessibles à ceux qui se croient grands. Quand on n'a que cinq millimètres de taille, tout est différend. La fourmi de Laurent Cachard déambule au ras du sol et s'éleve malgré cela au dessus des prétentions humaines, en tout cas à hauteur du sacré que l'humain investit de ses angoisses. L'insecte est crypto-sagace. Elle échappe à sa colonie et traverse tout le paysage, le long d'une trajectoire suggérée par Jean Frémiot. Autre paradoxe : la courte profondeur de champ n'empêche pas la profondeur des réflexions, en plus de la hauteur de vue. L'insecte et le Sacré est une jolie promenade où s'égrènent les pensées d'un promeneur qui a délégué sa parole à la modestie de l'infime, au niveau de l'interstice, une agréable mélodie au rythme des pattes et au hasard des sensilles. On y trouvera les rives d'un noir lac, des psychopompes, des entomologistes lancés sous les arcades géminées dans une partie de cache-cache, un souvenir d'apostasie, la nostalgie d'une pureté cistercienne, la menace de la blastogénétique et un peu de Hugo, sorte de "Père immédiat", qui clame l'évidence de l'existence en fin de parcours. Si vous n'avez pas tout compris des lignes qui précèdent, et bien, lisez ce petit bijou. C'est, mine de rien, un condensé érudit et plein de tendresse pour l'humanité et ses dérisoires élans spirituels.
L'Insecte et le Sacré, Photos de Jean Frémiot, texte de Laurent Cachard, éditions Le Réalgar.
Livres - Page 10
-
2814
-
Les Nefs de Pangée - Nouvelle critique
C'est toujours un plaisir d'être repéré par une jeune librairie. Les Nefs, coup de cœur de la Librairie Fantastique. Tant mieux !
-
2806
Louison : Un des surnoms de la Guillotine, du nom du chirurgien Louis qui mit au point la fameuse machine avec l'aide d'un délicat fabricant de harpes Allemand. Rappelons que la décapitation était sous l'ancien régime l'apanage des nobles. Les roturiers, eux, allaient se faire pendre, ce qui est moins net, sinon plus disgracieux. Le docteur Guillotin fit adopter par la Constituante une égalité de traitement pour « les délits du même genre » et il chargea Louis d'imaginer un appareil efficace, capable d'éviter les maladresses toujours pénibles de l'exécution à la hache.
Extrait des Notes sur le vocabulaire de La Grande Sauvage.
-
2805
La première sélection du Prix Rosny-Aîné résulte d'un vote de lecteurs. C'est assez rare pour être souligné. Les Nefs de Pangée est dans la liste des romans éligibles. Tous les détails ici.
-
2803
Je l'annonçais il y a peu, c'est confirmé : mon prochain roman à paraître chez Mnémos permettra de mieux connaître ce qui a amené à la situation géopolitique décrite dans Mausolées et, en même temps, m'offrira l'occasion de clamer haut et fort, malgré les nuages qui s'accumulent sur nos têtes en ce moment, que nous allons nous en sortir. L'humanité relèvera les défis qui lui sont posés. Mausolées était situé dans une période intermédiaire, disons une sorte de Moyen-Âge du futur ; Cénotaphes (nom de code pour cet opus, le titre ne sera pas celui-là), racontera une période de Renaissance. Par contre, en arriver à ce regain prendra un peu de temps, n'est-ce pas, le lecteur ne devra donc pas s'étonner de se voir projeté quatre siècles après la fin de Mausolées.
-
Les Nefs de Pangée - chronique vidéo
Grâce à un ami internaute, je découvre ce Youtubeur : KILKE (La brigade du livre), et sa chaîne consacrée à la littérature. Dans son numéro 9, le blogueur évoque la piraterie, histoire, mythe, prolongements actuels, et conclut pas une sélection de coups de cœur sur le thème. Les Nefs de Pangée sont, de son propre aveu, un peu hors-catégorie, mais il a trouvé dans la poursuite épique de l'Odalim, des échos suffisants pour raccrocher mon roman à son sujet. C'est le dernier titre proposé en fin de vidéo, vers 8 minutes. C'est très bien fait, et je vous conseille de tout regarder, évidemment.
-
Les Nefs de Pangée - Nouvelle critique
Un auteur est évidemment particulièrement sensible à l'attention d'un libraire qui défend son travail. Ici, Le Carnet à Spirales (Charlieu, dans la Loire), a lu et aimé Les Nefs de Pangée, et en parle avec des mots qui me comblent. Merci à lui.
-
2795
Reprise de l'écriture depuis quelques jours. Ce qui explique l'absence de chroniques littéraires aujourd'hui et dans le futur proche, sauf exception. Non pas que je cesse de lire, mais le temps requis pour disséquer, citer, raconter et penser un roman ou un essai est trop conséquent. Je ne peux plus m'y adonner dès lors que je suis sur un chantier d'écriture. Or, j'en ai ouvert trois simultanément. Deux romans et un essai. Aucune boulimie ou dispersion dans cette apparente frénésie. Cette triple ouverture est la conséquence de mon incapacité à choisir lequel de ces thèmes me donnera assez d'élan pour y travailler un an ou plus. Je vais donc les mener de front, allant de l'un à l'autre selon mes envies, mode très agréable, jusqu'à ce que l'un des trois livres m'oblige, m'arrime, exige de moi un intérêt constant. Là, je saurai. En attendant, je pense que Kronix va garder son rythme quotidien, contrairement à ce que je craignais, et fournir régulièrement de ces petites phrases qui amusent ou enjolivent une minute, sans plus de prétention.
Lecture du moment : Otages intimes, de Jeanne Bennameur. -
2794
Teuk Shadow (2 volumes)
Petelus
Ed. Chabert united
Citons d'abord les accroches qui résument la ligne éditoriale de cette série épatante : « Moustache, ninja et philosophie expéditive. » « Teuk Shadow, les baffes qui font réfléchir. » Tout est dit, mais tentons tout de même de vous situer argument et univers.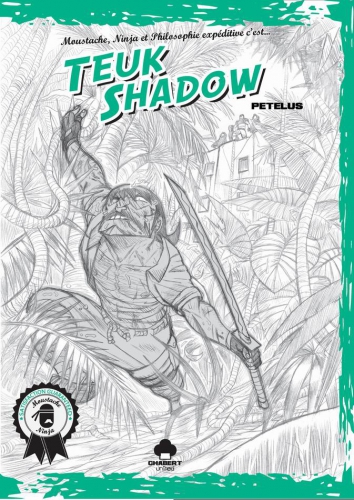 En prison, Teuk Shadow, « un vieux ninja un peu foutraque », lit Épicure, et s'il veut bien admettre que « La mort ne nous concerne pas. Quand on est là elle n'y est pas ; quand elle est là on n'y est plus », son expérience l'amène cependant à compléter le raisonnement par la notion du seuil entre ces deux pôles ; la BD de Petelus lui donne l'occasion de l'illustrer par l'exemple.
En prison, Teuk Shadow, « un vieux ninja un peu foutraque », lit Épicure, et s'il veut bien admettre que « La mort ne nous concerne pas. Quand on est là elle n'y est pas ; quand elle est là on n'y est plus », son expérience l'amène cependant à compléter le raisonnement par la notion du seuil entre ces deux pôles ; la BD de Petelus lui donne l'occasion de l'illustrer par l'exemple.
On ne saurait reprocher à un ninja de s'attendrir sur son passé et sur les temps perdus de la douceur. Il connaît la violence mieux que beaucoup et, pratiquant de haut-vol, sait la nécessité du répit, du contraste, de la douceur pour mieux affronter le temps du combat. La douceur comme but, la douceur pour élargir le seuil qui subsiste, quoi qu'en dise Épicure, entre la vie et la mort, dont il est très douteux qu'elle ne nous concerne pas. Elle concerne en tout cas les victimes de ses anciens compagnons d'armes, elle concerne aussi les traîtres à la nation ninja qui, comme lui, se fondent dans une forêt tropicale du futur qui a englouti des villes entières, pour se venger ou se sauver. Deux autres pôles essentiels qui sont toute la posture et le projet de vie d'un vieux ninja. La mort concerne enfin ses bourreaux et ses adversaires, quand Teuk Shadow referme ses livres (Épicure ou le rappeur Rocé) et s'anime soudain, sabre et poings fulgurants. On retrouve alors le talent de Petelus pour la représentation de la vitesse, de l'énergie, de la violence. N'oublions pas que l'auteur a pratiqué l'animation, et sa science du mouvement en fait un maître des scènes de combat.
Le ninja est la figure emblématique du Nanar. Petelus connaît du film du ninja tous les procédés et les poncifs, et s'amuse à de rares citations (le pastiche n'est pas sa tasse de thé, il a l'intelligence de ménager ses clins d'œil, ce qui les rend plus savoureux quand on les croise). Seconds couteaux du Bis, héros du Z, les ninjas à moustache, occidentaux égarés parmi une population de guerriers asiatiques (souvent dénigrés mais épices incontournables des productions de Godfrey Ho), sont réhabilités par le savoir-faire unique de Petelus. L'auteur a choisi un élégant gris-crayon (technique qu'on avait déjà vue chez lui, dans Gash la Rage), pour plonger le lecteur dans une jungle pluvieuse et fantomatique qui rappelle celle de Prédator.
La merde « désigne » tout l'univers du ninja, selon Petelus. Elle est aussi, par les multiples métaphores qu'elle autorise, le mode de l'explication du monde par le vieux ninja. Las de tous les discours (sauf des siens, qu'il aime prononcer pour ses victimes après leur mort, c’est plus prudent), Teuk Shadow hausse les épaules et ferme la porte des toilettes. Il va chier. Les ninjas ne sont pas si différents du commun des mortels.
Tournesol, le ninja pousse bien mieux, s'élève à partir de la lie des bourreaux pour se tourner vers le soleil. Mais enfin, le soleil, sous la grisaille battante des pages, tarde à venir, on sent que la quête de Teuk Shadow peut se poursuivre longtemps ; pour le plus grand plaisir de ses lecteurs.
Un mot sur la politique des éditions Chabert united : Petelus a tiré la conclusion de son observation des mœurs de l'édition bédéesque française. Son univers est trop singulier pour qu'il s'y exprime librement (ou même que ses projets soient validés, déjà). Il a donc décidé de pratiquer le circuit court, à l'imitation de l'agriculture bio, directe du producteur au consommateur, et s'en trouve fort bien ainsi. Au bon endroit et avec un peu de chance, vous pouvez le trouver sur un marché. Sinon, le contact est sur le net, ici. -
2792
Une chronique de Fabienne, une auteure membre de l'AEPF (l'Académie des Ecrivains Publics de France), à propos de L'Affaire des Vivants, intérêt relance par le prix Lettres-Frontière.
-
2791
Les prochains rendez-vous autour de L'Affaire des Vivants, des Nefs de Pangée et de La Grande Sauvage :
Tout d'abord, une interview sur Radio Cité Genève, le mardi 16 février à 18 heures dans le cadre de l'émission "Le Radioliteractif" au micro de Sita Pottacheruva, qui anima le soir du jour de l'enregistrement (vous suivez ?) la première rencontre Lettres-Frontière de l'année. Ce fut un moment très sympathique et j'espère que ça se sentira dans le ton des questions et des réponses.
Le samedi 27 février, je serai à la librairie Decitre à Saint-Geni-Laval, une rencontre et une séance de signature organisée par ActuSF. Pas moins de 9 auteurs des Indés de l'Imaginaire (ActuSF, Les moutons électriques et Mnémos) seront présents.
Le jeudi 3 mars, je serai à la librairie Les Danaïdes, à Aix-les-Bains, avec Jean-Laurent Del Socorro (auteur de Royaume de vent et de colères).
Le samedi 12 mars, c'est la librairie Decitre Confluence, à Lyon, qui nous invite, Dominique Douay, Stéphane Beauverger, Stéphane Przybylski et moi, à partir de 17h30.
Le vendredi 18 mars à 19h, je serai à Arenthon, invité par l'équipe de la bibliothèque municipale, pour poursuivre le périple amical du circuit Lettres-Frontière.
Le dimanche 20 mars, je serai au Salon du Livre à Paris (sous réserve).
Et enfin, le jeudi 24 mars à 18h30, à la Bibliothèque de La Part-Dieu (à Lyon, évidemment), n'oubliez pas la deuxième rencontre organisée par l'ARALD sur le thème "La Fabrique de l'écrivain", avec Aurélien Delsaux et ma pomme, dialogue sur les coulisses de l'écriture, animé par Danielle Maurel.
-
2789
Notre Château
Emmanuel Régniez
Éditions Le Tripode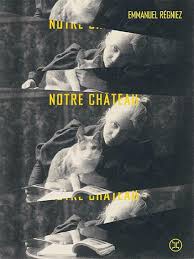 Octave et Véra sont frère et sœur, ils vivent dans une grande et belle maison dont ils ont héritée à la mort de leurs parents, si belle et vaste qu'ils l'appellent Notre Château. Octave et Véra y ont organisé une vie solitaire depuis vingt ans. Ils ne reçoivent personne, ne sortent jamais, sauf Octave, chaque jeudi, pour se rendre notamment chez un libraire qui semble devancer ses désirs et lui fournir immanquablement les livres voulus. Des livres pour lui et pour sa sœur. Leur moisson hebdomadaire de lectures.
Octave et Véra sont frère et sœur, ils vivent dans une grande et belle maison dont ils ont héritée à la mort de leurs parents, si belle et vaste qu'ils l'appellent Notre Château. Octave et Véra y ont organisé une vie solitaire depuis vingt ans. Ils ne reçoivent personne, ne sortent jamais, sauf Octave, chaque jeudi, pour se rendre notamment chez un libraire qui semble devancer ses désirs et lui fournir immanquablement les livres voulus. Des livres pour lui et pour sa sœur. Leur moisson hebdomadaire de lectures.
Le quotidien éternel du couple est ressassé sans incident notable jusqu'à ce fatidique jeudi 31 mars à 14h32, lorsqu'Octave voit sa sœur, en ville, dans le bus N°39. Véra qui ne sort jamais, déteste la ville et déteste le bus. Comment est-ce possible ? Octave rentre au Château, déboussolé, interroge sa sœur, qui nie l'évidence. Une fêlure dans l'impeccable confiance qui les tenait solidaires et solitaires, tous les deux, « seuls contre le monde. »
Du 31 mars au 2 avril d'une époque dont on ne saura rien, du 31 mars au 2 avril, des jours de confusion s'enchaînent pour Octave. Qui ment ? Devient-il fou ? Et ce mégot fumant dans un cendrier de la bibliothèque, alors que ni lui ni sa sœur ne fument et que personne, jamais, n'entre dans leur « Château » ?
Une telle amorce d'argument pourrait laisser craindre une resucée de roman fantastique. Pourtant, et bien que la quatrième de couverture convoque des références auxquelles ont pense inévitablement : The Shining de King ou le film Los Otros d'Amenabar, Notre Château explore un registre purement poétique. Un phrasé obsédant, des situations détachées de la réalité (en tout cas, celle que connaît le lecteur, sans pour autant basculer dans le surréalisme), une lumière immobile posée sur les jours et les rituels de la sœur et du frère : on devine d'emblée qu'un retournement final surviendra, qui n'apportera pas grand-chose au récit, puisque tout son intérêt est dans l'ambiance morbide et grise qu'il distille. J'ai pensé à Kafka et à Borgés davantage qu'aux auspices fantastiques cités plus haut. Kafka pour le quotidien englué, l'absurdité, les affres humaines traitées comme l'agitation d'insectes fantômes ; et Borgés pour l'importance du livre et les titres improbables de la bibliothèque de la maison et les douteuses partitions musicales évoquées sporadiquement. Je n'ai d'ailleurs pas cherché à vérifier l'authenticité des uns et des autres, la magie opère mieux, selon moi, dans la possibilité d'une réalité marginale. Je suppose que dans quelque temps, je ne pourrais me retenir de savoir si Couperin a bien écrit un morceau intitulé Les Barricades mystérieuses ou si Machiavel est l'auteur d'un Belphégor, mais pour l'heure, non, je veux bien conserver la précieuse incertitude qui donne prise aux personnages du roman.
Ce titre fait partie d'une sélection de premiers romans choisis par Jean-Baptiste Hamelin de la librairie Le Carnet à Spirales, à Charlieu, que je remercie pour cette intéressante découverte. On attend le deuxième roman d'Emmanuel Régniez pour voir s'il tiendra ce que promet ce premier texte singulier. -
2788
Dernières paroles de Perceval
Emmanuel Merle
Éditions L'escampette / Poésie Le grand drame de Perceval, fameux chevalier de la Table ronde, hors de « savoir la sauvagerie de ce qui vit », est de n'avoir pas su parler, un jour crucial, lors d'une escale où l'a mené son périple. « Tout m'avait conduit là, au pied de la pierre, (…) pour que je demande l'hospitalité à cette porte d'oubli ». Tandis qu'autour de lui « Tout vibrait, tout brillait, flamme sans ailes / Quelque chose se produisait, lent défilé, offrande inconnue qui interrompait le temps / En moi ça demandait, mais je me taisais. / Je me taisais. »
Le grand drame de Perceval, fameux chevalier de la Table ronde, hors de « savoir la sauvagerie de ce qui vit », est de n'avoir pas su parler, un jour crucial, lors d'une escale où l'a mené son périple. « Tout m'avait conduit là, au pied de la pierre, (…) pour que je demande l'hospitalité à cette porte d'oubli ». Tandis qu'autour de lui « Tout vibrait, tout brillait, flamme sans ailes / Quelque chose se produisait, lent défilé, offrande inconnue qui interrompait le temps / En moi ça demandait, mais je me taisais. / Je me taisais. »
Car Perceval est muet, mutique en tout cas, il a préféré le bruit de l'épée, « ruine de phonolites », à la parole. Et l'infortuné qui lui demande de parler, « qui réclame que je dise » selon Perceval, « comprend que c'est sa mort qu'il appelle ». Celui qu'on nomme le « Chevalier d'Effroi », poursuit sa quête depuis trop longtemps ; il ne sait que se battre : « Je frappe comme pour trancher un tronc / d'arbre. Je n'avais pourtant qu'à parler. » S'il se tait, Perceval voit tout cependant et saisit, par ce tout, l'essentiel du monde, terre veuve ou terre foraine qu'il parcourt en armure, sur son cheval. Dans ces temps légendaires, il est dit que Perceval, « l'homme percé de cris », percevait. Depuis longtemps, il ressent plus qu'il n'exprime. Depuis qu'il sait son nom il se tait « Avant que je le découvre, qu'il sorte malgré moi de ma bouche, j'étais celui à qui tout s'adressait. » Désert pour le monde, il ne se départit pas de son silence. Il est celui qui, au seul spectacle de deux flocons qui se poursuivent, sent en lui une pierre se détacher.Pour porter vers nous ce récit, il faut que quelqu'un parle pourtant. Pour transmettre les dernières paroles de Perceval, il ne faut pas moins qu'un poète à la mesure de cette épopée du retour.
Emmanuel Merle offre son Verbe au guerrier solitaire, dit pour lui et à la première personne, les paysages, « la débâcle d'une eau que le gravier et le bois mort encombrent », les chants, les souvenirs de sa « terre d'enfant disparu », et la mémoire des combats, quand « à l'instant de frapper / je me souviens qu'un voile (…) rouge, descendait sur mes yeux (…) gonflant ma poitrine, faisant de ma main une mâchoire. » Les mots, les sensations et les souvenirs se fondent en une errance mélancolique et tragique.
Il a tant combattu, il a tant vu sans dire (« Qu'ai-je fait d'autre, qu'ai-je fait à l'autre, / si longtemps, que lui donner la mort ? ») « La mort chevauche à mes côtés, / sans cordes vocales, et souriante / d'un désir atroce. » Par les terres, dans l'entrelacs des collines enneigées et des eaux torrentueuses, au pied des gibets d'où s'échappent des vols noirs, le pas de son cheval le ramène au delà de « la barrière de [s]on père », celui qu'il n'a pas connu, désarmé et desquamé, laissé là. Il revient aux racines de sa légende et de celui qu'il fut. « Quand on est enfant, tous les mots ont des majuscules, toutes les choses sont des êtres, et de façon magique rien n'est oublié, puisque tout a lieu. »
Autour du chevalier tout est mots, le froid, les flocons, la nuit, les rois, tout ne cesse de quémander la parole dont il est avare. Le constat est amer « Je reviens à moi mais la langue est perdue. »
Perceval sait que ce sont ses dernières paroles, son testament : « Le temps je ne l'ai plus. Il y a un point rouge sur mon armure étincelante ».
Le long poème d'Emmanuel Merle convoque la figure émouvante du chevalier qui n'osa pas parler quand c'était nécessaire et en conclut qu'il valait mieux désormais se taire. On peut le lire comme un récit, comme une errance déprimée au milieu de la neige et des morts, c'est un texte qui ne cesse de verser sa puissance, comme certaines sources abondent, intarissables.
« Tout est séparé parce que je n'ai rien dit.
Mais séparer et dire, c’est un semblable coup d'épée.
Je croyais que l'accueil du monde
se faisait sans les mots, à présent je sais
que je me trompais.
Dire, oui, c'est diviser, mais quelques paroles,
ici, célèbrent encore la vie :
les prononcer comme des prénoms. »Emmanuel Merle sera mon invité, avec Christian Degoutte, à Gilly-sur-Isère, le 3 juin, dans le cadre de la carte blanche annuelle que l'équipe de la Médiathèque m'a confiée.
-
2787
Madame Diogène
Aurélien Delsaux
Albin Michel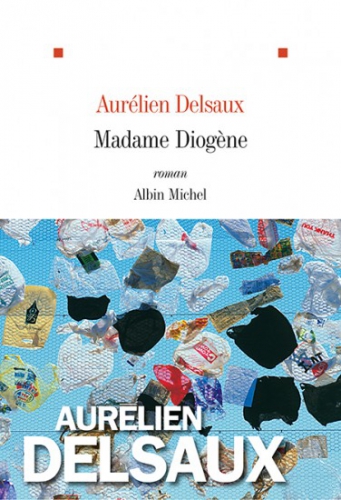 Madame Diogène vit au milieu de ses ordures, elle circule dans son appartement grâce à des tranchées aménagées entre les strates d'immondices accumulées depuis des années et qui ont dévoré l'espace. Les voisins frappent à la porte, menacent, n'en peuvent plus de l'odeur, des cafards et des mouches qui empoisonnent tout l'immeuble à partir de son cloaque. Madame Diogène ne reçoit aucune visite, retient les importuns sur le seuil, son seul contact est une parente qui lui apporte des sacs de provisions, et l'intrusion de voix mauvaises, perçues depuis la nuit, ou une autre, solitaire, étrange, qui « comme une mère la calme, comme un enfant la réjouit, qui la brûle comme une voix d'amant ». Sa solitude est cependant relative, elle est entourée d'une foule de visages, des beaux gosses même, des élégances putassières sur le papier glacé des magazines, émergeant de la décharge au hasard de sa déambulation. Parfois, une ombre se dessine parmi les ombres, une silhouette du passé approche d'elle, le charme opère, elle devine les choses, ressuscite un temps évanoui, prononce deux syllabes, pa-pa, pour accueillir le revenant. Alors, « dans sa grotte, le temps n'a plus cours (…) elle sait ce qu'elle fut : bébé, petite fille, adolescente, femme ; un instant, le mode est là. » Dans l'appartement, toute une vie s'est organisée, insectes ou souris sur quoi elle ne règne pas, qu'elle observe, comme, penchée sur une évacuation, elle « appelle par l'épais tuyau les bêtes des égouts, où tout se rejoint, s'agglomère », comme elle scrute son plafond, comme elle assiste par la fenêtre à la vie de la ville, dehors. Les frontières sont diluées, son regard et sa mémoire font fusionner les territoires, « N'est-elle pas elle-même tout l'immeuble, murs et voix, l'avenue et la ville » ? Dehors, c’est l'amorce du chaos, ça regimbe, ça manifeste, ça rit, ça défile, ça cogne, ça meurt. Madame Diogène éprouve un reste d'émotion, un « filet d'amour » pour ces créatures qui s'affairent, dans la rue, mais très vite, l'ermite les rejette dans l'anathème, avec leur allure « de misérables, de débiles, de possédés ». Elle est clairvoyante, a peut-être connu de pareils enthousiasmes, en sait depuis long tout le dérisoire. L'organisation de sa décharge confinée entre ses murs vaut bien le chaos extérieur, l'apocalypse annoncée. Tous les espoirs sont englués, la révolte d'une jeunesse est réprimée, les enfances ont connu des fleurs, des champs, des herbes, du ciel, et puis tout retombe et se fond, tout s'endeuille. Ce n’est pas plus triste que n'importe quel autre crépuscule. C'est seulement inéluctable.
Madame Diogène vit au milieu de ses ordures, elle circule dans son appartement grâce à des tranchées aménagées entre les strates d'immondices accumulées depuis des années et qui ont dévoré l'espace. Les voisins frappent à la porte, menacent, n'en peuvent plus de l'odeur, des cafards et des mouches qui empoisonnent tout l'immeuble à partir de son cloaque. Madame Diogène ne reçoit aucune visite, retient les importuns sur le seuil, son seul contact est une parente qui lui apporte des sacs de provisions, et l'intrusion de voix mauvaises, perçues depuis la nuit, ou une autre, solitaire, étrange, qui « comme une mère la calme, comme un enfant la réjouit, qui la brûle comme une voix d'amant ». Sa solitude est cependant relative, elle est entourée d'une foule de visages, des beaux gosses même, des élégances putassières sur le papier glacé des magazines, émergeant de la décharge au hasard de sa déambulation. Parfois, une ombre se dessine parmi les ombres, une silhouette du passé approche d'elle, le charme opère, elle devine les choses, ressuscite un temps évanoui, prononce deux syllabes, pa-pa, pour accueillir le revenant. Alors, « dans sa grotte, le temps n'a plus cours (…) elle sait ce qu'elle fut : bébé, petite fille, adolescente, femme ; un instant, le mode est là. » Dans l'appartement, toute une vie s'est organisée, insectes ou souris sur quoi elle ne règne pas, qu'elle observe, comme, penchée sur une évacuation, elle « appelle par l'épais tuyau les bêtes des égouts, où tout se rejoint, s'agglomère », comme elle scrute son plafond, comme elle assiste par la fenêtre à la vie de la ville, dehors. Les frontières sont diluées, son regard et sa mémoire font fusionner les territoires, « N'est-elle pas elle-même tout l'immeuble, murs et voix, l'avenue et la ville » ? Dehors, c’est l'amorce du chaos, ça regimbe, ça manifeste, ça rit, ça défile, ça cogne, ça meurt. Madame Diogène éprouve un reste d'émotion, un « filet d'amour » pour ces créatures qui s'affairent, dans la rue, mais très vite, l'ermite les rejette dans l'anathème, avec leur allure « de misérables, de débiles, de possédés ». Elle est clairvoyante, a peut-être connu de pareils enthousiasmes, en sait depuis long tout le dérisoire. L'organisation de sa décharge confinée entre ses murs vaut bien le chaos extérieur, l'apocalypse annoncée. Tous les espoirs sont englués, la révolte d'une jeunesse est réprimée, les enfances ont connu des fleurs, des champs, des herbes, du ciel, et puis tout retombe et se fond, tout s'endeuille. Ce n’est pas plus triste que n'importe quel autre crépuscule. C'est seulement inéluctable.
L'espace d'une journée, Aurélien Delsaux nous décrit une fin du monde en vase clos. C'est froid, c'est brûlant, c'est juste. On assiste à l'écroulement des heures (je dis bien l'écroulement) au milieu des moisissures et des rêves, des poubelles fossilisées, des fantômes de chats ; on écoute les menaces de l'autre côté de la porte, des amours sèches et brutales, là-haut, des invectives et des foules avides, dans la rue. Tout se resserre et se confine autour d'elle, tandis que, dans la mémoire de madame Diogène, subsiste celle qui avait un « amour effréné pour le vent et l'herbe », celle qui avait un « grand désir d'aimer l'univers entier ». Le portrait de madame Diogène s'exhausse parmi les ordures, avec une heureuse subtilité, sa vérité se révèle comme les photos naguère, vous vous souvenez ? Dans le balancement du révélateur. L'auteur, qui signait là, en 2014, son premier roman, donnait à son personnage la stature d'une résistante, franc-tireur exilée volontaire dans sa forteresse de crasse et dont l'assaut final ne viendra pas à bout.
J'aurais le plaisir de partager une table ronde avec Aurélien Delsaux, jeudi 24 mars, à la bibliothèque de La Part-Dieu, à Lyon. Bénéficiaires d'une bourse de la DRAC l'an dernier, nous viendrons tous deux évoquer les projets de romans qui nous ont valu cette bourse. Le débat sera animé par l'excellente Danielle Maurel. -
2786
Timothy Findley
Le Dernier des fous (The Last of the Crazy People)
traduit de l'anglais (Canada) par Nadia Akrouf
Préface de Daniel Arsand
chez Libretto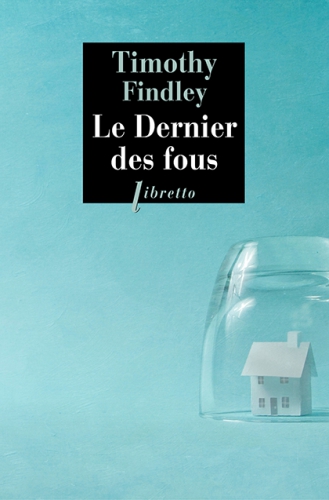 Il s'agit de la réédition du premier roman de cet écrivain disparu en 2002. Le Dernier des fous parut en France en 1967. La présente édition poche, est accompagnée d'une préface de Daniel Arsand qui prévient : « l'essai n'est pas qu'un coup de maître, mais la pierre angulaire d'une œuvre complexe, à la fois fluide et labyrinthique, chatoyante et violente ». Ce qui définit ainsi toute l'œuvre convient aussi pour ce seul roman. Fluidité du récit, labyrinthe des atermoiements dans l'esprit des personnages, chatoiement des des scènes, c'est-à-dire variété des rythmes, des genres (dialogues, descriptions des paysages), et violence enfin, sidérante (et presque apaisante).
Il s'agit de la réédition du premier roman de cet écrivain disparu en 2002. Le Dernier des fous parut en France en 1967. La présente édition poche, est accompagnée d'une préface de Daniel Arsand qui prévient : « l'essai n'est pas qu'un coup de maître, mais la pierre angulaire d'une œuvre complexe, à la fois fluide et labyrinthique, chatoyante et violente ». Ce qui définit ainsi toute l'œuvre convient aussi pour ce seul roman. Fluidité du récit, labyrinthe des atermoiements dans l'esprit des personnages, chatoiement des des scènes, c'est-à-dire variété des rythmes, des genres (dialogues, descriptions des paysages), et violence enfin, sidérante (et presque apaisante).
Nous sommes dans les années 60, non loin de Toronto, dans une belle maison de la classe aisée. La famille Winslow est en apnée. Le père, Nicholas, les deux fils, Hooker et Gilbert, une belle-sœur, Rosetta, et la bonne noire, Iris, vivent suspendus aux bruits de sonnettes ou du loquet d'une chambre de l'étage occupée par la mère, Jessica. Après plusieurs crises sporadiques au fil des ans, et depuis son retour de l'hôpital où elle a accouché d'un enfant mort-né, la recluse a définitivement sombré dans la folie. Elle ne supporte pas de voir ses enfants qu'elle déteste, elle ne descend presque plus au rez-de-chaussée, ne s'intéresse qu'à ses prières et ses chapelets. Une intrusion ou un mot de trop et sa démence jette les témoins dans la terreur.
Peur, menaces, cris, silences, le dérèglement psychique de la mère instille le mal dans le quotidien de tous les habitants de la maison. La folie impose sa respiration, son rythme cardiaque, personne n'y échappe, elle semble se propager depuis le seuil de la chambre maternelle, hanter les esprits des voisins et de la ville. Le témoin principal de cette emprise délétère est Hooker, le plus jeune des garçons, il a bientôt onze ans. L'été, il s'occupe en enterrant, dans un petit cimetière personnel, les proies que ses nombreux chats lui rapportent, ou bien il grimpe sur les genoux d'Iris, écoute ses chansons et les histoires d'amours tragiques qu'elle raconte, essaye de discuter avec son poète de frère, part se promener avec Iris quand l'heure est venue (et elle est venue quand Jessica se met à hurler, que le père essaye de la calmer, que les murs tremblent).
Qui pourrait pulvériser cette prison de silences et de paroles manquées, qui a ce pouvoir de délivrer les fous de leur aliénation ? Le dernier d'entre eux, sans doute. Dès le prologue, comme il est évident qu'on assiste à l'amorce d'une tragédie, la conclusion n’est pas bien mystérieuse, on sait bien que la violence aura le dernier mot, on prend même assez vite connaissance de qui nouera le drame et comment. L'intérêt du roman n’est donc pas tant dans son dénouement que dans la minutieuse description de l'enfermement des êtres dans leur cage microscopique, protection trompeuse qui enferme le Verbe, retient les gestes et les réduit aux comportements élémentaires que la société veut bien autoriser : fumer une cigarette, rentrer du travail et accrocher un pardessus, manger, acheter, paresser, boire. Dès que l'un ou l'autre membre de la famille est au contact avec la raison des autres, avec la norme des autres, les saillies blessent, les boussoles s'affolent, des gestes incompréhensibles sont générés. La maison des Winslow est le refuge en même temps que le piège. Le jeune Hooker, comme les autres, qu'il soit innocent ou pas, qu'il soit naïf ou perspicace, est pris dans la toile remarquablement tissée par Timothy Findley, touche par touche, dialogue après dialogue, image après image. Engrenage implacable. Le lecteur attend l'explosion inévitable qui mettra un terme à cette terrible mécanique du mal. -
2785
Ce soir, j'ai le plaisir d'être accueilli par la bibliothèque Pierre Goy d'Annemasse. C'est à 18h30, c'est dans le cadre du Prix Lettres-Frontière. Entrée libre, bonne humeur et lectures au programme. Venez nombreux.
-
2784
Quand le diable sortit de la salle de bain
Sophie Divry
chez Notablia Sophie Divry est une auteure qui pense à ses lecteurs. Elle se confronte à l'écrit, s'adonne en virtuose aux exercices de style mais elle ne le fait pas dans le vain espoir de paraître intelligente (elle l'est, très) ou cultivée (idem) ou pertinente (itou), elle festoie avec l'écrit en songeant à la jubilation de son lecteur. Elle lui veut du bien. Et le lecteur, reconnaissant, attend le prochain livre. A première vue, le projet de Quand le diable sortit de la salle de bain paraîtra d'une moindre portée que son précédent, La Condition pavillonnaire, ambitieux portrait de femme médiocre, sorte de somme sur la beauté des trajectoires quelconques. Pour Le Diable... l'auteure pêche par humilité en revendiquant cette modestie. Dès la page de garde, on lit sous le titre : « Roman intempestif, interruptif et pas sérieux ». Il est tout cela, mais « pas sérieux » ne signifie pas sans gravité. Le lecteur de méchante humeur (ça, c'est moi, ça) se dit, le temps de quelques pages, qu'il va parcourir ça en diagonale, les petites fantaisies pour se reposer d'un ouvrage trop sérieux, on sait ce que c’est, oui, bon, allons allons, et puis... Il réalise qu'il a entre les mains un sacré portrait de société. Quelque chose d'une extrême élégance, parce que profond sans en avoir l'air.
Sophie Divry est une auteure qui pense à ses lecteurs. Elle se confronte à l'écrit, s'adonne en virtuose aux exercices de style mais elle ne le fait pas dans le vain espoir de paraître intelligente (elle l'est, très) ou cultivée (idem) ou pertinente (itou), elle festoie avec l'écrit en songeant à la jubilation de son lecteur. Elle lui veut du bien. Et le lecteur, reconnaissant, attend le prochain livre. A première vue, le projet de Quand le diable sortit de la salle de bain paraîtra d'une moindre portée que son précédent, La Condition pavillonnaire, ambitieux portrait de femme médiocre, sorte de somme sur la beauté des trajectoires quelconques. Pour Le Diable... l'auteure pêche par humilité en revendiquant cette modestie. Dès la page de garde, on lit sous le titre : « Roman intempestif, interruptif et pas sérieux ». Il est tout cela, mais « pas sérieux » ne signifie pas sans gravité. Le lecteur de méchante humeur (ça, c'est moi, ça) se dit, le temps de quelques pages, qu'il va parcourir ça en diagonale, les petites fantaisies pour se reposer d'un ouvrage trop sérieux, on sait ce que c’est, oui, bon, allons allons, et puis... Il réalise qu'il a entre les mains un sacré portrait de société. Quelque chose d'une extrême élégance, parce que profond sans en avoir l'air.
Jeune chômeuse vivant à la Croix-Rousse, la narratrice (qui se prénomme Sophie, et le nombre d'occasions de recouper l'histoire de l'héroïne avec celle de l'auteure, sont assez nombreuses pour interroger) connaît la précarité, la fin de mois qui commence le 20 et les calculs incessants pour faire rentrer les frais de nourriture entre les limites d'un budget minuscule, voire bientôt inexistant. C'est la galère, la galère, la galère, et ce ne sont pas les administrations vétilleuses, un bon copain érotomane et son diable personnel Lorchus qui vont la sortir de la panade. A tout le moins ces derniers profiteront-ils de la faiblesse de l'auteure pour s'introduire dans le récit (et aussi dans pas mal d'autres choses, mais passons). Tout cela est décrit avec beaucoup d'humour, mais vraiment beaucoup, pendant les trois-quart du livre en tout cas. Sophie Divry joue non seulement sur les mots, mais s'amuse avec la typographie, la tortille et l’arque-boute, l'arrondit et la disperse. A la faveur d'un conte pour enfants, les consonnes s'évadent dans la marge, une frénésie priapique prend sur deux pages la forme d'un pénis érigé, ailleurs une silhouette de femme, des dialogues allogènes s'immiscent entre les lignes d'une méditation, un tchat avec une plateforme porno est parasitée de poésie classique, etc. On soupçonne la gratuité, on sourit, on s'agace éventuellement, mais au bout du compte on voit énoncée une réalité de la faim, de la solitude, de l'angoisse modernes, et on remercie Divry de ne pas chercher la posture. Les mêmes affres donnent trop souvent chez d'autres écrivains les manifestes les plus éplorés ou les plus vindicatifs et même, hélas, une navrante poésie de la dèche, héritière des talentueuses vociférations de Jehan-Rictus, en guère plus sincères.
La Sophie de Quand le Diable, pourrait être la fille de l'M.-A. de la Condition pavillonnaire. Elle se serait trompée de chemin, se serait fourvoyée dans un rêve d'écriture après son divorce et elle trouverait un peu de baume au cœur et de répit lors d'un séjour dans la maison familiale, près d'une mère solide, éternelle, avec qui elle aurait fait la paix.
C'est un roman bancal, libre, « intempestif » donc, quasiment inabouti, à la lisière ; de la littérature pourtant, jouissive, un rire fêlé de demoiselle en détresse, trop bien élevée, qui n'ose pas crier Au secours.Une très chère amie, et excellente lectrice, m'a trouvé indulgent pour ce livre. Sa critique vaut bien la mienne, je vous la confie avec son accord, de façon à nourrir la réflexion (on se croirait chez Télérama) :
"Sophie Divry : Quand le diable sortit de la salle de bain, Notablia, 2015
L'auteur de La condition pavillonnaire a changé de style ! C'est comme si tout à coup elle lâchait la bride à une frénétique envie d'écrire. L'histoire pourrait être triste puisque la narratrice, sans emploi ni argent, se demande comment trouver de quoi manger. Mais si la narratrice a faim, l'auteur, elle, s'amuse beaucoup. J'ai voulu, écrit-elle, laisser libre cours à mon imagination, sans rien m'interdire. Les objets se sont mis à parler, le diable à apparaître, les listes à s'allonger dangereusement, la typographie à s'agiter... Il en résulte un grand fourre-tout sans véritable unité, où les scènes porno succédant à des délires littéraires permettent de ne pas trop s'attrister sur le sort d'une jeune chômeuse qui tire le diable par la queue ! Vous l'avez compris, ce roman présenté par son éditeur comme « interruptif, rigolo, digressif, foutraque » ne m'a pas captivée !"
Fr. -
2783
Enfin lire, pour autre chose que de trouver chez un témoin le tarif des toilettes publiques en 1789 ou sur un plan la maison de tel personnage. Enfin, lire pour le plaisir. Dans le même temps, débarrasser le bureau, sans hâte, jour après jour, ranger l'un après l'autre les dizaines de livres collectés, les carnets de notes, les revues et les brochures. Laisser les bouts de papier entre les pages, petite vanité pour conserver le souvenir du travail entrepris. Le grand meuble, soulagé, libéré, se rengorge, exhibe sa longue belle cuirasse de bois patiné. Prêt à reprendre du service, à supporter le poids d'une nouvelle enquête. Je m'accoude et lis, ne sais comment lui dire que non, c'est fini, j'en ai marre, plus question de thésauriser soixante bouquins, d'éplucher des milliers de docs sur Gallica, de passer des années à comprendre un monde défunt qui est, par nature, incompréhensible. Rumine un livre de liberté, d'émancipation, de verbes délivrés, de personnages dérivés dans un milieu sans contexte. Enfin, écrire comme je faisais, enfant, des romans désamarrés, pas sans souffrance ou sans inquiétude, mais sans travail.
-
2782
L'Alphabet des Anges
Xochitl Borel
L'aire. Collection Alcantara. L'Alphabet des Anges a reçu successivement deux prix : le prix Lettres-Frontière et celui du Roman des Romands, en Suisse, bien sûr. C'est grâce au premier que j'ai pu faire la connaissance et de l'auteur, et de son livre. J'aime bien l'auteur, mais je parlerai du livre. Que j'aime bien aussi.
L'Alphabet des Anges a reçu successivement deux prix : le prix Lettres-Frontière et celui du Roman des Romands, en Suisse, bien sûr. C'est grâce au premier que j'ai pu faire la connaissance et de l'auteur, et de son livre. J'aime bien l'auteur, mais je parlerai du livre. Que j'aime bien aussi.
L'Alphabet des Anges est un premier roman. Xochitl Borel y croise des vies de femmes, surtout Soledad, sa belle-mère, sa fille Aneth... sans oublier quelques hommes qui passent, pas anodins pour autant, entre menaces ou appuis providentiels. Soledad, la narratrice, est une jeune femme brillante, nous sommes dans une période d'après-guerre, située grâce à quelques informations fugaces, en fond de décor, ce qui importe, c’est que la période n'est pas très bienveillante pour les femmes. Soledad se trouve enceinte, son père ne reproche rien, dit seulement « Je ferai le nécessaire ». Soledad aimerait garder l'enfant, sûrement un garçon qu'elle aurait appelé Micha, ne résiste pas malgré tout à la décision paternelle, et va avorter. Mais l'opération artisanale, à l'aiguille à tricoter, chez une faiseuse d'ange et sous la surveillance de sa jolie belle-mère, Anne, ne se passe pas comme prévu. L'enfant ne disparaît pas, rejette son destin d'ange, vient au monde. Elle s'appellera Aneth, comme cette plante qui, par miracle, a poussé dans un pot de terre stérile sur le bord d'une fenêtre. Aneth est là, sa vive intelligence transforme le monde à coups de mots d'enfants d'une poésie quasi invraisemblable (mais de l'aveu de l'auteure, inspirés de son expérience de travail auprès des enfants et de souvenirs familiaux). Aneth est drôle, alerte, optimiste... et borgne, cruel stigmate de l'avortement raté. Au royaume des malentendus, les borgnes sont reines. Aneth a de la ressource. Son infirmité est un leurre pour les autres, elle se débrouille très bien, dessine avec une inventivité rare ce qui est invisible, jusqu'à l'abstraction des mouvements de la danse, veut bien jouer d'un instrument, mais ce sera de la trompette, d'aucuns voient ses dons comme une chance à saisir « C'est stupéfiant » ! dit un professionnel, qui la verrait bien dans un centre spécialisé pour des enfants à haut potentiel. Soledad ne partage pas cette analyse, l'intelligence peut être méchante, elle le sait, elle fut brillante aussi, « gavée d'école », bien élevée, « affligée d'une auréole d'intellectuelle », cheveux courts et liberté rognée. Elle s'est jurée de permettre à sa fille de rester libre. Penchée sur les lettres de l'alphabet qu'Emile, le compagnon de Soledad, lui apprend, Aneth enregistre un savoir qui pourrait soudain paraître inutile : elle va devenir aveugle entièrement. Que l'obscurité se referme sur elle, que son seul œil valide se brouille et s'éteigne, elle a en elle tant de lumière, elle a déjà tellement perçu de couleurs et d'invisible, que cet ultime coup du sort ne pourra pas dépouiller Aneth de ses ailes. Par sa maladresse, la faiseuse d'ange a bien produit un ange, resté sur terre, celui-là.
Dans une langue poétique, le court roman de Xochitl Borel égrène le temps, parcourt une galerie de portraits de personnes uniques, voire solitaires comme l'œil d'Aneth (père veuf, belle-mère abusée, Soledad, Aneth, Margot l'avorteuse, Emile...), figures entrelacées et appariées par la volupté et la force des plantes et des fleurs, omniprésentes, fondues enfin par l'ultime unification que produit la cécité d'Aneth. -
Les Nefs de Pangée - Nouvelle critique
"Parfois contemplatif, voire mystique, Christian Chavassieux s’interroge sur son univers, et le nôtre, dans cette chasse à la baleine blanche à l’échelle d’un monde. Complexe, étendu, chaque parcelle du récit s’enchâsse parfaitement dans l’histoire de Pangée pour dévoiler un monde d’une richesse infinie décrit avec poésie et violence.
Une grande œuvre pour une grande histoire, exigeante et sublime."Excellent résumé, belle critique. Mine de rien, vous savez, on écrit aussi pour rencontrer la sympathie des lecteurs. Ce n'est pas rien, la reconnaissance du plaisir qu'on a pu donner. C'est tout récent, et c'est sur le blog un dernier livre. sous la plume d'une certaine Marcelline, que je remercie vivement.