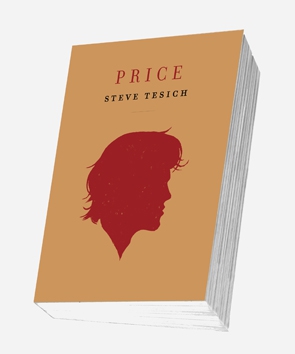 Price. Steve Tesich. Monsieur Toussaint Louverture.
Price. Steve Tesich. Monsieur Toussaint Louverture.
Je peux dire aujourd'hui qu'avec les 540 pages de Price, j'ai lu l'intégralité de l’œuvre romanesque de Steve Tesich. C'est moins remarquable qu'il y apparaît puisque l'auteur de Karoo n'a écrit que deux romans. Je viens de les citer. Le reste de son travail se répartit entre théâtre et scénarios pour le cinéma, et quelques essais. Karoo m'avait proprement subjugué. J'avais alors parlé de chef-d’œuvre, ce qui ne m'est arrivé que deux fois, je crois, sur Kronix. Karoo était le dernier roman et même la dernière œuvre de l'écrivain américain, et je suppose qu'une part de sa force vient de là. Tesich aurait mis une dizaine d'années à écrire Price (du nom du narrateur, comme pour Karoo), et ce livre porté longtemps est une œuvre magnifique, mais il serait vain de la comparer à son dernier opus, sinon pour les opposer.
Les personnages y sont jeunes, sans cynisme, mobilisés par les passions adolescentes. Leur destin est celui d'une jeunesse des années 50-60 dans une petite ville moche des Etats-Unis, dominée par une raffinerie où ils iront presque inévitablement travailler, comme leurs pères, jusqu'à la fin de leurs jours. Daniel Price est l'un d'eux. Lutteur amateur, il vient de perdre un combat. Il l'a perdu parce qu'il a renoncé à gagner, à la dernière seconde. Peut-on imaginer meilleure illustration de la médiocrité volontairement endossée par le héros à l'exemple de ses pairs, dans cette ville fade et insouciante ? L'année scolaire s'achève. Avec ses deux meilleurs amis, le furieux et révolté Larry et le débonnaire Freund, tous deux lutteurs comme lui, ils considèrent la vie morne qui les attend, celle de tous les autres, les anciennes gloires, les petites célébrités locales, de ce champion de foot qui balaye les couloirs d'hôpital, de la gentille Lavonne, femme battue qui accepte les aléas de la vie de couple et travaille comme caissière de supermarché ou de la plus belle fille de la ville qui, forcément, se mariera avec un quelconque beau gosse du coin. Il faudrait être fou pour échapper à la norme provinciale de ce bout de terre. Fou comme l'un de leurs profs, qui se met à manger ses nœuds de cravate en cours et achève son délire dans l'ambulance qui l'embarque. Les trois amis eux, doivent composer avec la normalité qui menace de les engloutir. Ils n'ont pas la chance d'être dingues. Freund espère qu'ils ne se sépareront jamais mais la petite Patty fait d'habiles manœuvres d'approche (et que pèsera l'amitié quand la fille aura refermé ses bras sur lui ?) ; Larry veut en découdre avec le monde, déteste la veulerie de ses parents, leur admiration révoltante pour sa « réussite » dans les études ; Daniel Price doit composer avec la tristesse et les disputes de ses parents. Le père à la raffinerie, la mère qui fait des ménages à Chicago et économise sou à sou dans l'espoir, un jour, d'être propriétaire. Des vies minuscules, mais comment faire autrement dans ce cadre tellement réducteur ? Le cancer du père, ou plus précisément le moment où la maladie ne se laisse plus ignorer, intervient au moment où le garçon tombe amoureux d'une jeune femme au caractère imprévisible : Rachel. Il paraît que les hommes aiment les emmerdeuses. Là, comme dirait Audiard, Price a à faire à une emmerderesse. Le genre de filles que tu dois décider de fuir après une heure de promenade. Price ne fuit pas. Il est jeune, c'est son premier amour. Tesich n'en fait pas pour autant un benêt transi, un pantin ; le garçon se défend, connaît aussi ses moments de manipulation, ses espionnages minables, ses stratégies mesquines. Le talent de Tesich (qui est celui de nombreux grands auteurs américains), est de nourrir la trame de ce récit par des réflexions pertinentes sur la filiation, la jalousie, le destin, les leurres de l'empathie, la solitude, le besoin désespéré d'être aimé et d'être aimé de la façon qu'on voudrait, d'élever tout cela au carré, d'en faire une mythologie puissante et de conférer à chaque personnage, même secondaire, l'attention la plus précise dans la connaissance de l'âme humaine. Les chiens même se voient offrir une partition dans cette vaste chorale. Il n'y a pas de destin médiocre. On pense à Faulkner, à Tennessee Williams, à Nabokov. On est surtout emporté dans un roman intelligent, humain, riche. Pas aussi stupéfiant que Karoo, mais tout de même, largement au dessus du lot de nombre de romans contemporains. Je ne reprendrai pas l'antienne désolée de la comparaison entre les auteurs nord-américains et nos petites prétentions hexagonales (si, tiens, je viens de le faire), mais encore une fois, on est bien forcé de constater que nos fabliaux moraux végètent dans les douces praires de la paresse tandis que des Tesich, des Roth ou des Ellis, se coltinent la roche, se confrontent aux éléments et vous aident à escalader les sommets. Bref. Ils ne craignent pas de s'esquinter les mains au passage.
Ça vaut pour moi aussi, entendons-nous bien.
Un dernier mot pour saluer la beauté des livres édités par Monsieur Toussaint-Louverture. Qualité du papier, de la typo, des reliures et de la couverture, qualité de la traduction, souci de la relecture (pas une faute ni une coquille en vue, ce qui devient exceptionnel).
Livres - Page 9
-
2881
-
Les Nefs de Pangée - Nouvelle critique
Dernière chronique en date, ici, sur le blog "La Grande bibliothèque" :
"Les Nefs de Pangée, c'est de la SF, et c'est un grand livre, de cette espèce qui donne le vertige. Il est remarquable que ce vertige soit acquis au terme d'un seul volume, et que la conclusion de ce livre n'appelle aucune suite : j'ai envie de parier que Christian Chavassieux a fait sien le dicton fremen Arrakis enseigne l'attitude du couteau : couper ce qui est incomplet et dire: "Maintenant c'est complet"... Pour une première rencontre, c'en est une belle, et qui restera longtemps dans ma mémoire : bravo, et merci."
Ben c'est moi qui vous remercie, cher Anudar, qui m'apprenez du même coup que mes Nefs sont en lice pour le prix des Blogueurs Planète SF.
-
2877
C'est aujourd'hui, à 17 heures, que j'ai le plaisir d'être accueilli à la Médiathèque de Thonon-les-Bains. La rencontre sera animée par Charles Sigel. Elle est organisée dans le cadre du Prix Lettres-Frontière. Il sera d'abord question de L'Affaire des vivants et aussi, qui sait, des Nefs de Pangée, ou encore de mon prochain ? (Tiens, si je leur faisais une surprise ?)
Ce moment revêt un aspect particulier pour moi. C'est en effet dans cette même médiathèque que j'avais été reçu pour la première fois en tant qu'écrivain pour Le Baiser de la Nourrice.
-
2875
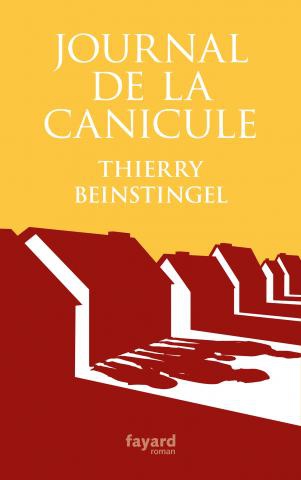 Journal de la canicule. Thierry Beinstingel. Fayard.
Journal de la canicule. Thierry Beinstingel. Fayard.Ce roman de la rentrée 2015 est une très fine analyse de la manière dont l'écriture s'impose à un quidam et lui permet de dépasser ses questionnements, pour finir par lui permettre de s'améliorer, en quelque sorte. En tout cas, de lui apporter un peu de bonheur. Le roman est construit sur le mode du journal, rédigé sur un cahier d'écolier pendant la canicule de 2003. Le narrateur est un célibataire (séparé plutôt, mais depuis assez longtemps pour avoir assimilé la condition du vieux garçon qui rend visite à sa mère dans sa maison de retraite), modeste fonctionnaire, sûrement assez transparent, resté pendant l'essentiel de l'été pour superviser un chantier de voirie assez délicat.
Intrigué par l'absence prolongée de ses voisins, il s'enhardit à entrer dans leur jardin, trouver un accès et pénètre un jour dans leur maison déserte. Là, il observe cette intimité étrange, offerte et silencieuse, ce monde arrêté, comme figé par la mort. Où sont-ils ? Où sont le couple, leur garçon et leur fille, deux enfants dont les chambres sont désagréablement dissymétriques ? Sans vouloir rien déranger, le narrateur s'habitue jour après jour à visiter la maison, de plus en plus fasciné par le drame qu'il devine derrière cette absence anormalement longue. Les semaines passent, un mois passe, un deuxième mois… les voisins ne sont toujours pas rentrés, la canicule impose sa respiration à la ville. Le narrateur consigne tout, avec une obsession du détail. C'est un technicien, un amoureux de la symétrie, de l'observation précise et mesurée. Cependant, ce terne personnage prend goût à coucher sur un cahier (seul vol qu'il s'autorise dans la maison abandonnée) ses faits et gestes, ses hypothèses, l'avancée de son enquête, puis ses réflexions intimes, l'émotion de ses rencontres, ses pensées. Un nouveau cahier est bientôt nécessaire. Écrire devient un palliatif à ses perquisitions, il se rend moins souvent dans la maison des voisins, écrire lui permet de comprendre des choses sur lui et sur les autres. Se dessine alors le véritable propos du livre. On croit être invité dans une enquête policière, haletante, angoissante (c'est l'effet produit, d'abord), et puis l'on prend conscience que le récit nous entraîne ailleurs. On voit alors chez ce fade petit fonctionnaire, s'affirmer l'humain bienveillant qu'il a toujours été, l'homme sans colère et sans amertume, celui que les femmes choisissent pour lui raconter leurs déboires, et qui aurait aimé avoir un enfant.
La difficulté étant pour l'auteur d'imiter une écriture pâle et factuelle, parfois alourdie de détails techniques (le narrateur réalise parfois que ce qu'il écrit n'a pas d'intérêt), d'être assez adroit pour produire avec cela de la littérature, mais une littérature qui serait à la portée d'un diariste seulement préoccupé de décrire les événements anodins qu'il traverse, cela sans la moindre ambition littéraire, justement. Et de réussir à faire progresser cette narration faussement médiocre vers la force de questionnement des grands textes. C'est virtuose, sans avoir l'air d'y toucher. Une belle surprise (je ne connaissais pas cet auteur), une belle réussite. -
2872
L'Epitaphe. Villon. 2 minutes et 19 secondes venues du XVe siècle. En ces temps, un poète fréquenta suffisamment les gibets où ses frères se balançaient au vent, pour pouvoir les décrire comme "plus becquetés d'oiseaux que dés à coudre", image inoubliable.
-
2871
Marc Lévy a écrit plusieurs livres, ce qui le fait considérer comme un écrivain par beaucoup de ses lecteurs. C'est un type plutôt sympa si j'en crois certaines anecdotes ou témoignages de mes connaissances, et ça c'est bien. Il est un peu plus jeune que moi et considérablement plus à l'aise financièrement. Plus beau même, mais ma douce affirme que non (elle trouve aussi que Brad Pitt n'est pas terrible. Je ne sais que penser.) Le père de Marc Lévy est écrivain et fut un résistant et sa sœur est scénariste et auteure de théâtre. Ces détails dévoilent un aspect de sa personnalité : il a fallu que ce garçon s'impose dans sa propre famille. Qu'il l'ait fait en choisissant l'écriture est le signe d'une démarche authentique, assez naïve pour être respectée, malgré les dommages collatéraux.
Beaucoup de femmes aiment lire Marc Lévy. C'est ainsi. J'ai lu un livre de Marc Lévy (Si c'était vrai, je crois). Je suis encore là, intègre, tel qu'auparavant. L'expérience est donc moins terrible qu'on le dit. D'autant plus qu'elle est oubliable.
Laissons vivre Marc Lévy, occupons-nous de littérature, il y a déjà fort à faire de ce côté-là.
Je vous remercie de votre attention. -
2870
 On lira Tocqueville à la plage de Xavier Gardette.
On lira Tocqueville à la plage de Xavier Gardette.C'est l'été. Un couple investit une maison au bord de l'océan, en Vendée. Lui, Olivier, est écrivain et doit boucler pour la fin de l'année un livre sur Marie Motley, femme d'Alexis de Tocqueville. Il n'a rien dit à Sylvie, sa riche épouse, de son intuition première qui devient certitude au fil du récit : il connaît ces lieux, il est venu enfant sur la plage qu'ils fréquentent aujourd'hui. Il s'est passé là quelque chose qui se refuse à sa conscience. Un souvenir important qui lui échappe. On se régalera, bercé par l'attente et l'insistance des souvenirs à ne pas se laisser saisir, amusé par les atermoiements d'un auteur incertain, lancé dans un chantier qui ne le passionne plus, vaguement attiré par une belle couturière vêtue de peu de tissu, on méditera sur la famille, les voisins, la mémoire, le couple, on sera encore joliment ému par une révélation finale, à la fois fondatrice et anodine. On cueillera au passage quelques belles assertions, des phrases d'auteurs glanés dans toute l'histoire de la littérature et données sans affectation, des leçons de pensée glissées mine de rien, entre deux grains de sable. C'est subtil, joli, élégant. On quitte le livre comme une rencontre délicieuse, à laquelle on repensera un jour en souriant.
Tocqueville à la plage, Xavier Gardette. Chez arléa. -
2857
 Naven, de Maryse Vuillermet, est une merveille. L'auteure de l'excellent Pars, travaille ! avait produit ce premier livre début 2015. Le naven est un récit à valeur initiatique de certaines sociétés de Nouvelle-Guinée, par lequel les femmes transmettent à la génération suivante une mythologie familiale, un récit des origines. Maryse Vuillermet entreprend l'élaboration d'une semblable genèse et l'ouvre ainsi à tous. Elle enquête à la source des témoignages familiaux, reconstitue de façon documentée, mais jamais de façon pesante, la vie de ces femmes, pas moins fortes et rebelles que les militantes dont elles furent les ancêtres, mais contraintes par les conditions économiques et sociales de leur temps. Leur temps, c'est le début du XXe siècle, quand on exilait les jeunes filles de la campagne à la ville, pour servir de bonnes dans la bourgeoisie lyonnaise. Le récit croise, (comme dans Pars, travaille ! mais il m'a semblé, je l'avoue, avec beaucoup plus de force), la modernité des choix féministes de la vie de l'auteure avec le passé restitué de ses grand-mère et grand-tante. C'est riche, instructif, stupéfiant, c'est parfois bouleversant, toujours passionnant. Si vous vous interrogez sur la manière dont une femme reçoit l'héritage inconscient de ses aïeules, si la permanence d'un combat féministe vous importe, je ne peux que vous encourager à découvrir ce document magistral - et je pèse mes mots. Naven est hélas paru chez L'Harmattan, ce qui le destine d'emblée à la confidentialité la plus dommageable. La couverture, que je trouve exagérément laide, n'invite pas non plus à franchir le pas. Je peux assurer que le contenu est d'une tout autre qualité. Je suis persuadé que d'autres éditeurs, plus armés pour faire connaître ce travail, pourraient l'arracher à cette fatalité. Il faut le souhaiter pour le bien de tous.
Naven, de Maryse Vuillermet, est une merveille. L'auteure de l'excellent Pars, travaille ! avait produit ce premier livre début 2015. Le naven est un récit à valeur initiatique de certaines sociétés de Nouvelle-Guinée, par lequel les femmes transmettent à la génération suivante une mythologie familiale, un récit des origines. Maryse Vuillermet entreprend l'élaboration d'une semblable genèse et l'ouvre ainsi à tous. Elle enquête à la source des témoignages familiaux, reconstitue de façon documentée, mais jamais de façon pesante, la vie de ces femmes, pas moins fortes et rebelles que les militantes dont elles furent les ancêtres, mais contraintes par les conditions économiques et sociales de leur temps. Leur temps, c'est le début du XXe siècle, quand on exilait les jeunes filles de la campagne à la ville, pour servir de bonnes dans la bourgeoisie lyonnaise. Le récit croise, (comme dans Pars, travaille ! mais il m'a semblé, je l'avoue, avec beaucoup plus de force), la modernité des choix féministes de la vie de l'auteure avec le passé restitué de ses grand-mère et grand-tante. C'est riche, instructif, stupéfiant, c'est parfois bouleversant, toujours passionnant. Si vous vous interrogez sur la manière dont une femme reçoit l'héritage inconscient de ses aïeules, si la permanence d'un combat féministe vous importe, je ne peux que vous encourager à découvrir ce document magistral - et je pèse mes mots. Naven est hélas paru chez L'Harmattan, ce qui le destine d'emblée à la confidentialité la plus dommageable. La couverture, que je trouve exagérément laide, n'invite pas non plus à franchir le pas. Je peux assurer que le contenu est d'une tout autre qualité. Je suis persuadé que d'autres éditeurs, plus armés pour faire connaître ce travail, pourraient l'arracher à cette fatalité. Il faut le souhaiter pour le bien de tous.On pourra lire avec profit un autre livre de transmission, masculin celui-ci: Ma vie, côté père, de Michel Contat, chez Christian Bourgois. Le hasard de mes lectures me fait faire ce rapprochement, mais les deux textes sont écrits selon des procédés très éloignés. Disons que je profite de ce billet pour évoquer cet autre beau récit. Le portrait d'un père absent et inoubliable, dessiné davantage par les blancs que par les traces laissées sur le papier. Livre émouvant et teinté d'humour d'un auteur qui peut enfin, à soixante-dix ans passés, remuer le passé familial et tenter une réconciliation attendrie avec son géniteur. Sentiment final d'injustice cruelle : ce grand immature de père, plus intéressant pour un écrivain que la consciencieuse et fidèle, et sacrifiée, et présente, figure de la mère.
-
2855
Ce soir, à partir de 18h30, c'est à la bibliothèque de Mégevette que je suis accueilli dans le cadre des rencontres organisées par Lettres-Frontière. On parlera surtout de l'Affaire des vivants, mais, si j'ai le bonheur de retrouver une certaine éditrice qui a prévu de passer me voir, il pourrait être question des Chants Plaintifs. L'entrée est libre, bien sûr. Je me réjouis d'avance.
-
2848
C'est aujourd'hui, à partir de 17 heures. C'est la troisième fois que cette délicieuse librairie pas comme les autres, me reçoit. Et la deuxième fois dans le cadre de son salon : les Dystopiales. J'y dédicacerai "Les Nefs de Pangée". Et on discutera, on se donnera des nouvelles, tout ça.
-
2847
En hommage, ce très bref rappel d'une lecture déjà ancienne, mais tenace en mémoire.
-
2844
 Isabelle Flaten publie dernièrement au Réalgar un roman assez jouissif autour de la question de l'argent, justement nommé "Chagrins d'argent". Elle a bien voulu se prêter à l'exercice de l'interview, ce dont nous la remercions vivement. Voici :
Isabelle Flaten publie dernièrement au Réalgar un roman assez jouissif autour de la question de l'argent, justement nommé "Chagrins d'argent". Elle a bien voulu se prêter à l'exercice de l'interview, ce dont nous la remercions vivement. Voici :« Chagrins d'argent » est un récit contemporain. Il s'architecture autour d'une série de portraits imbriqués (on dit « récit choral » pour aller vite) d'hommes et de femmes de tous âges et de toutes conditions, qui sont reliés entre eux (parfois sans qu'ils en aient conscience), par la vie, le travail, la famille, les passions ou les haines, mais aussi par la question de l'argent. Qu'ajouteriez-vous à ce bref résumé ? Comment avez-vous construit ce livre ?
Je préciserais que la question de l’argent est la question centrale. Quelles sont les incidences de notre rapport à l’argent dans notre relation à l’autre ? Il me semble que c’est un thème délicat à aborder pour la plupart d’entre nous - pour ne pas dire tabou à l’échelle de notre société- et sinon source de conflit, de culpabilité, dans bien des cercles intimes. Le contenu de notre portefeuille qu’il soit vide ou, à l’inverse, bien garni, interroge notre place dans la société, conditionne notre comportement, et c’est cela que j’ai voulu explorer.
Je ne construis pas mes livres par avance, ils se construisent au fil de l’écriture. Au départ je ne sais rien de leur forme, s’agira-t-il d’un texte court, d’un recueil de nouvelles, d’un long roman, je l’ignore. Peu à peu les choses se mettent en place, une idée surgit et je la suis, un personnage s’épuise et je l’abandonne, ou bien il se révèle être plus complexe que prévu et m’oblige à ne pas le lâcher. Dans Chagrins d’argent, il m’est très vite apparu qu’afin de corroborer mon propos, un « effet miroir » était nécessaire, c’est ainsi que chaque personnage s’est retrouvé avec son vis-à-vis. La façon dont une même situation est vécue par chacun, le décalage que cela induit, est un thème qui m’intéresse depuis longtemps.
En cours de lecture, on pense inévitablement à travestir le titre en « Chagrins d'amour » et le parallèle est troublant entre les effets produits sur les êtres par l'un ou l'autre phénomène. C'est éternel et souvent associé, l'argent, l'amour… Cela ne devrait pas se confondre et pourtant. « Chagrins d'argent » est-il un récit cynique, une observation désabusée de la nature humaine qui mettrait à égalité les affres matérielles et les passions amoureuses ? (écrivant cela, je me fais l'avocat du diable, parce que vos portraits sont tout sauf cyniques)
Oui Christian, vous avez raison, le parallèle, s’il est troublant, est bien évidemment volontaire mais en aucun cas, il s’agit de les associer. Autant, me semble-t-il, le chagrin d’amour est un chagrin noble, suscitant souvent la compassion, autant le chagrin d’argent est un chagrin honteux, souvent passé sous silence, l’insigne d’une forme de disgrâce.
Quant à la nature humaine, je ne sais pas ce que c’est. Il y a dans la nature de très gentils humains et je me targue d’en connaître quelques-uns, et d’autres il est vrai, un peu plus durs en affaires et dont on se passerait volontiers. Toutefois ils existent, certains sont prêts à tout pour faire toujours plus d’argent, mais pourquoi ? Mon récit n’est, je l’espère, pas une observation désabusée de mes semblables mais plutôt une manière d’engager la conversation autour de ces abîmes de plus en plus vertigineux qui scindent les classes sociales. Je me garderai de vous faire une leçon d’économie mais je vous confierai que ma démarche procède d’une vieille utopie - ou d’un certain bon sens, c’est selon- qui consiste à penser que si l’on n’achète pas l’amour, on peut, en partageant les richesses, acheter la paix sociale.
Pour n'évoquer que les textes parus au Réalgar (les seuls que j'ai lus de vous) : « Noces incertaines » était un roman construit notamment autour du passé d'un couple, et « Se taire ou pas » était une déclinaison très inventive et fine de courts textes où sont décrits ces moments cruciaux de la prise de parole (ou du renoncement à la prise de parole). « Chagrins d'argent » semble une forme hybride qui vous permet de déployer votre talent pour la forme brève tout en intégrant ces miniatures dans un récit plus ample qui s'apparente au roman. C'est aussi, comme « Se taire ou pas » une façon d'aborder l'universalité des comportements humains par une approche singulière (l'argent, la parole). Quel regard portez-vous sur ces deux grandes formes de narration, nouvelle et roman ? Quel élan initial vous emporte vers l'écriture ?
Le roman et la nouvelle sont deux exercices distincts, leur écriture respective ne répond pas aux même exigences. La nouvelle est économe, elle exige un style épuré, elle ne permet pas ou peu la digression, il s’agit d’aller rapidement à l’essentiel, d’atteindre le cœur du propos en quelques lignes. C’est une forme que j’aime beaucoup, une sorte de défi – ça passe ou ça casse- pour le dire sommairement. Dans Se taire ou pas j’ai poussé le défi jusqu’à écrire parfois une fiction contenue en une seule phrase. Etait-il possible de transmettre une émotion, de dresser un portrait, de décrire une situation aussi brièvement ? La nouvelle c’est l’art de suggérer, de permettre au lecteur de se raconter sa propre histoire en parallèle de la vôtre, d’en appeler à son imagination. Et la chute me direz-vous (ou pas) ! Vous me le dîtes, n’est-ce pas ? et je vous réponds qu’elle n’est pas indispensable, mais que cela m’amuse beaucoup d’essayer d’en trouver une. Quant au roman le travail est autre, je ne vous apprends rien, c’est avant tout le traitement d’une histoire qui nécessite bien plus que dans une nouvelle de se soucier de la cohérence des événements, de la temporalité du récit, de se méfier d’un risque d’essoufflement du propos ou du personnage. Mais comme vous le soulignez, dans Chagrins d’argent, entre roman et nouvelle, la frontière est floue, c’est un roman-nouvelles. Quant à l’élan initial d’un texte, cela part de pas grand-chose, parfois d’une simple image, ou d’une petite idée de rien du tout, un questionnement, une parole entendue et qui a résonné. En ce qui concerne Chagrins d’argent, c’est l’impuissance que je ressens à chaque fois que je passe à côté d’un mendiant qui a initié le roman. Une fois que j’ai la première phrase, j’ai le ton du récit. A chaque texte j’ai le sentiment d’aborder une nouvelle thématique, et au bout du compte je m’aperçois qu’on tourne toujours- peu ou prou- autour des mêmes problématiques au fil des écrits, ou du moins qu’il y a des ressemblances.
C'est écrit à la troisième personne, aucun nom n'est donné mais c'est assez travaillé pour ne pas perdre le fil, comprendre à quel personnage on a à faire. Et aussi, malgré le procédé de la troisième personne, on a l'impression d'entendre chacun s'exprimer ou penser avec sa propre voix. Les belles pages sont nombreuses ; permettez-moi de souligner celles qui décrivent le parcours et les pensées du SDF. Que sont pour vous ces personnages ? Comment avez-vous abordé celui du tueur de femmes par exemple ?
J’avais déjà utilisé ce procédé, l’anonymat des personnages, dans mon recueil Les Empêchements, et pour ce texte j’ai envisagé un moment de les nommer mais cela n’aurait rien apporté de plus. Encore une fois, c’est l’espace qu’il me plaît de laisser au lecteur.
Avant de me lancer je me suis effectivement posée la question de la légitimité, de quel droit allais-je parler au nom d’un SDF ou d’un tueur ? Je me la pose toujours. Jusqu’à présent, je me cantonnais à des univers proches du mien pour ne pas risquer « l’invraisemblance » et là j’ai osé, de la même manière que je n’hésite pas à parler au nom des hommes, réveiller le tueur ou le misérable qui sommeille sans doute en moi.
Comment s'est passé le travail d'édition avec Daniel Damart (éditeur du Réalgar) ?
Je lui ai dédié ce livre, tout est dit, la réponse est là. Daniel Damart est un éditeur avec qui il est très facile et très agréable de travailler. Il dit oui, ou non, et si c’est oui, alors il vous soutient, vous écoute, vous fait des blagues et c’est le bonheur.
En vous lisant, j'écoute une musique, je ne sais pas, une partition au piano, Satie parfois, peut-être Debussy ou Schubert… La musique et l'écriture, pour vous, Isabelle Flaten ?
Lire ou écouter de la musique sont pour moi des activités à part entière, aussi je lis et travaille dans le silence. Mais l’écriture n’est-elle pas la plus belle des partitions, une page blanche à déchiffrer chaque jour, que demander de plus ? -
2837
La fabrique de l'écrivain #2
Christian Chavassieux et Aurélien Delsaux
dialogue sur les coulisses de l'écriture
La fabrique de l'écrivain, cycle proposé par l'Arald et la Bibliothèque municipale de Lyon, propose un nouveau rendez-vous jeudi 24 mars à 18h30, à la Bibliothèque de la Part-Dieu. Les deux romanciers Christian Chavassieux et Aurélien Delsaux parleront de leur travail en cours, des mécaniques de la création, de leurs chemins littéraires, des premières notes du livre sur lequel ils sont en train de travailler au manuscrit final, jusqu'à la publication. Venez découvrir avec eux ce qui se cache et se révèle dans... La fabrique de l'écrivain ! -
2836
Vers la nuit
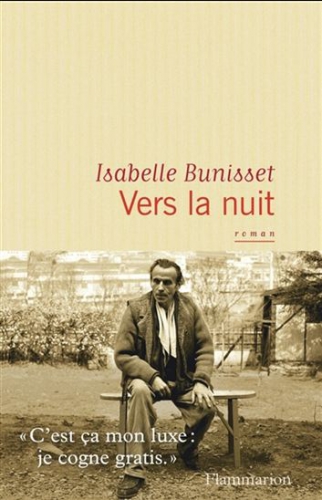 Le lecteur avance vers la dernière nuit de Céline, malade, dans sa villa à Meudon, à partir de 16 h. et jusqu'aux 5 h. fatales du 30 juin 1961. Heure par heure, Isabelle Bunisset nous invite dans les pensées de l'auteur qui corrige Rigodon, son ultime opus. C'est à la première personne. Je vous imagine perplexes : quoi ? Céline à la première personne ? Ses diatribes, sa fatigue, son amertume, sa haine, son orgueil, sa drôlerie, ses trouvailles, son ton, sa verve, sa langue, son ironie, son désespoir impoli… Comment recréer ça ? Comment être juste ? Pari casse-gueule assurément et, il faut bien l'admettre, pari formidablement réussi, parce que tout y est. Ce n'est pas la moindre qualité de ce roman gonflé qui semble aussi libre (« quitte à finir encagé ») et radical que son tragique personnage. Tout le monde en prend pour son grade, Céline dégomme Sartre, rappelle qu'il a viré de chez lui l'auteur des Mouches venu quémander son aide pour amadouer la censure allemande, lui n'a « jamais rampé devant les hauts dignitaires allemands. C'est ça mon luxe : je cogne gratis », Céline anéantit ses critiques « les plus débiles jugent avec leur barda de morale », Paul Nizan, « Mufle aveugle ! Ignare total » qui n'a pas compris que si, dans ses bouquins « tout est rabattu à la plus basse matérialité, (…) c'est pour obliger le ciel à répondre », Céline ironise sur ses épigones, ces feignasses, tous redevables de son style, mais pas un qui revendiquerait cet encombrant héritage, Céline crache sur la bien-pensance, la fausse compassion des bonnes âmes tandis que lui, le maudit, soigne gratuitement les pauvres et se frotte à la misère crasse. Céline pense aussi à l'avenir de sa compagne, s'inquiète du peu de ressources qui va lui rester après sa disparition. Il n'y a bien que les toutes dernières pages qui atténuent un peu le plaisir du lecteur. Le reste est une incontestable réussite. Il fallait oser, et il fallait avoir les moyens intellectuels et stylistiques pour relever le défi.
Le lecteur avance vers la dernière nuit de Céline, malade, dans sa villa à Meudon, à partir de 16 h. et jusqu'aux 5 h. fatales du 30 juin 1961. Heure par heure, Isabelle Bunisset nous invite dans les pensées de l'auteur qui corrige Rigodon, son ultime opus. C'est à la première personne. Je vous imagine perplexes : quoi ? Céline à la première personne ? Ses diatribes, sa fatigue, son amertume, sa haine, son orgueil, sa drôlerie, ses trouvailles, son ton, sa verve, sa langue, son ironie, son désespoir impoli… Comment recréer ça ? Comment être juste ? Pari casse-gueule assurément et, il faut bien l'admettre, pari formidablement réussi, parce que tout y est. Ce n'est pas la moindre qualité de ce roman gonflé qui semble aussi libre (« quitte à finir encagé ») et radical que son tragique personnage. Tout le monde en prend pour son grade, Céline dégomme Sartre, rappelle qu'il a viré de chez lui l'auteur des Mouches venu quémander son aide pour amadouer la censure allemande, lui n'a « jamais rampé devant les hauts dignitaires allemands. C'est ça mon luxe : je cogne gratis », Céline anéantit ses critiques « les plus débiles jugent avec leur barda de morale », Paul Nizan, « Mufle aveugle ! Ignare total » qui n'a pas compris que si, dans ses bouquins « tout est rabattu à la plus basse matérialité, (…) c'est pour obliger le ciel à répondre », Céline ironise sur ses épigones, ces feignasses, tous redevables de son style, mais pas un qui revendiquerait cet encombrant héritage, Céline crache sur la bien-pensance, la fausse compassion des bonnes âmes tandis que lui, le maudit, soigne gratuitement les pauvres et se frotte à la misère crasse. Céline pense aussi à l'avenir de sa compagne, s'inquiète du peu de ressources qui va lui rester après sa disparition. Il n'y a bien que les toutes dernières pages qui atténuent un peu le plaisir du lecteur. Le reste est une incontestable réussite. Il fallait oser, et il fallait avoir les moyens intellectuels et stylistiques pour relever le défi.
Après le régal de lecture, après le moment de stupéfaction pendant lequel on rend hommage à la virtuosité de ce livre hors-normes, après la cinquième heure quoi, comme au réveil, le lecteur commence à s'interroger. Isabelle Bunisset a soutenu une thèse sur La dérision chez Céline sous la direction de Philippe Murray, autre spécialiste de l'écrivain. Parrainage légitime. Un auteur polémique, contempteur de notre société festive, auteur d'un essai remarqué sur Céline. Très bien. Le récit à la première personne revient en écho dans la mémoire. A la première personne, Céline se défend, se défausse, on a été injuste avec lui, trop facile de le traiter d'antisémite, il ne s'est jamais vendu à un pouvoir quel qu'il soit, c'est le grand malentendu, deux malheureux livres qu'il a voulu ensuite faire disparaître et patatras, trop tard, ah, on lui en veut ! et le voici en exil à Meudon, à crever tout seul, conspué, misérable, malade, « victime expiatoire de la langue française ». C'est l’ambiguïté de la première personne, du « Je » qui pose alors question. On peut comprendre la mauvaise foi de Céline si c'est bien de la sienne dont il s'agit, si les mots sortent bien de son cerveau. Mais on repense soudain que c'est une auteure douée qui se met à sa place, l'interprète. Veut-elle être juste, fidèle, ou est-ce qu'elle tente de disculper l'écrivain qu'elle admire ? Chaque lecteur se fera son opinion, résoudra à sa façon l'énigme posée par ce texte, je le répète, j'insiste : formidablement réussi.Vers la nuit. Isabelle Bunisset. Flammarion.
-
2835
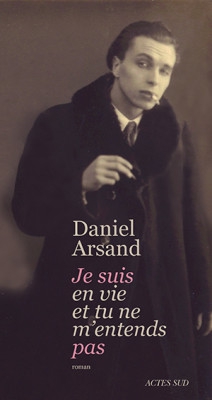 Klaus Hirschkuh « avait dix-neuf ans à son arrivée dans la boue et la poussière de Buchenwald ». Ni juif, ni étranger, ni communiste, ni tzigane, ni opposant politique, ni soldat ennemi, on ne l'avait affublé ni d'une étoile jaune ni d'un triangle vert. Klaus était allemand, et on avait épinglé à sa tenue de prisonnier l’infamant triangle rose de l'homosexuel, ce qui ne pardonne pas, dans l'Allemagne nazie de 1940.
Klaus Hirschkuh « avait dix-neuf ans à son arrivée dans la boue et la poussière de Buchenwald ». Ni juif, ni étranger, ni communiste, ni tzigane, ni opposant politique, ni soldat ennemi, on ne l'avait affublé ni d'une étoile jaune ni d'un triangle vert. Klaus était allemand, et on avait épinglé à sa tenue de prisonnier l’infamant triangle rose de l'homosexuel, ce qui ne pardonne pas, dans l'Allemagne nazie de 1940.
Pour Klaus Hirschkuh (Klaus comme Klaus Mann et Hirschkuh qui signifie Biche, tendre victime offerte aux prédateurs), survivre quatre ans dans un camp a signifié d'abord « ne pas vouloir mourir », et a réclamé de son corps de souffrir tous les viols, toutes les abjections et les insultes, les règles en fer dans le cul. Cela lui a demandé de tenir, de survivre à la castration des autres, à la défenestration de Heinz, son cher amour. Il a tenu. Et voici Klaus, de retour dans sa famille. Klaus inattendu, Klaus d'une maigreur accusatrice, dérangeante, Klaus qui ne sera décidément jamais comme les autres. Père et mère attentifs mais inquiets, n'osant savoir, n'osant préciser pour eux-mêmes les raisons qui ont permis d'envoyer leur fils en camp. Un frère cadet, Golo, ambigu, blessé des attentions qu'ont ses parents pour ce fils prodigue. Pour ce Klaus, ce pédé, cette fiotte, qui, en plus, trouve rapidement du travail, s'émancipe, déniche un appartement dans Leipzig dévastée. Pas de haine pourtant, ou bien fugace, surtout l'incompréhension face à l'étranger. Klaus décide de partir. Il prend le train pour Paris avec René, un Français, ancien prisonnier, rencontré dans un atelier de couture.
Les premières pages et toute la première partie du roman de Daniel Arsand, Je suis en vie et tu ne m'entends pas, sont certainement les plus puissantes parmi les récits de fiction qui décrivent le retour d'un survivant des camps. Écriture taillée au burin, enragée, livrée avec trop d'urgence pour se plier au désir d'être aimable. Les phrases sont des halètements, des coups de poings permanents, le parcours de Klaus parmi les ruines devient une errance vague traversée de visions, souvenirs de sévices et humiliations prêtes à resurgir, un songe écœuré, criblé de phrases nées dans les camps, des pensées venues avec l'instinct de survie, quand il fallait éviter de broncher sous la bedaine de kapos enamourés.
Dans Leipzig anéantie, où l'arbre de Goethe n'a pas été épargné par les bombardements, Klaus était un solitaire déraciné, irréconciliable avec son passé ; à Paris, la situation n'est pas idéale mais le jeune homme s'épanouit, son ami français a retrouvé sa femme, ils ont un enfant. Klaus a vingt-six ans, a appris la langue de son pays d'adoption. Les haines nocturnes, là-bas parce qu'il est homosexuel, ici parce qu'il est Allemand, remuent les souvenirs certes, mais il suffit à celui qui a survécu à l'enfer, de se laver lentement pour se débarrasser « d'une ancienne peur ». Et puis, il y a des promesses qui balayent les pires douleurs « Demain, ça ira mieux, tu iras te balader dans Paris, la nuit, tu seras en chasse, la ville est peuplée de garçons. » Certaines coucheries sont hantées par le souvenir de Heinz, l'amant défenestré. On n'échappe pas si facilement aux morsures des tortionnaires et de leurs chiens. Ainsi, entre travail, virées nocturnes et fêtes chez René, les années passent pour le nouveau Klaus ; il a trente-quatre ans, la guerre est froide à présent. Les souvenirs de son numéro de matricule et des tortures ne s'effacent pas, mais leurs surgissements s'espacent. L'écriture de Daniel Arsand s'apaise alors tout en gardant assez de nerf, le phrasé réconcilie, illumine. Il y a des dimanches, les enfants s'empâtent, Klaus fredonne des chansons dans l'atelier de couture où il a trouvé un travail chez un arménien obèse. On passe de « ne pas vouloir mourir » à « vivre n'était pas mal du tout ». D'autres années, d'autres rencontres, et puis, le passé est tenace, Klaus a quarante ans, il est l'heure pour lui de retourner à Leipzig, de connaître le sort des parents, de reprendre langue avec l'Allemagne. Et s'apercevoir qu'il ne craint plus rien de son père, de sa mère, de son frère : tous s'effacent. Il revient à Paris, aimera assez un Julien pour lui confier Buchenwald et les humiliations scatologiques, lui préciser que « de tous les détenus et internés, les pédés seuls n'avaient pas reçu d'indemnités. » Klaus et Julien sont ostracisés à cause de leur amour contre-nature ; on passe maintenant de « vivre n'était pas mal du tout » à « Je t'aime et j'ai envie de mourir. » On n'en finit donc jamais avec la haine compulsive des autres, y compris en vacances, à Pourville. La province française décorsetée des années 70 n'a pas largué ses préjugés, loin s'en faut, on insulte à voix basse. Sur la plage, adossé à la digue, Klaus voit Julien s'éloigner dans les vagues, tout revient en mémoire (et ce sont encore, jusqu'au bout, de superbes pages.) Après l'ultime déferlement de la mémoire, le lecteur se croit revenu indemne à Paris, quand la haine reprend soudain des couleurs, envoie Julien au tapis pour le compte, os brisés, hôpital. Rien n'a changé, sauf que livre et procès, cette fois, concluent l'agression. On n'est plus à Buchenwald. Les « gay » sont nés.
C'est le rappel de l'injustice permanente faite aux homosexuels qui donne au récit de Arsand sa force documentaire, force qui double celle du récit de fiction. Il faudra encore rappeler que, dans les années 90 (mille neuf cent quatre vingt dix !), des homosexuels venus partager le recueillement d'une cérémonie du souvenir en France, furent chassés aux cris de « Au four, les pédés ! » D'où la rage, d'où l'urgence, et le peu de souci qu'a eu l'auteur de polir une langue aimable.
Daniel Arsand, Je suis en vie et tu ne m'entends pas. Actes Sud, 2016. -
2834
Le Salon du Livre de Paris m'avait laissé, à l'époque du Baiser de la Nourrice, un souvenir amer, un ennui, une fatigue. L'expérience renouvelée en 2013 (pour la sortie de Mausolées) était plus concluante, mais encore un peu terne. Cette année, je comprends que des choses ont changé. Comme le dit mon éditeur, "tu es en train de te constituer une fan-base", j'en ai eu la démonstration en éclusant la presque totalité des Nefs de Pangée apportées sur le stand des Indés de l'Imaginaire. Ailleurs, des auteurs et des éditeurs m'ont repéré, des rencontres se sont produites, les bonnes nouvelles s'enchaînent. Tout prend un temps extraordinaire, rien n'est achevé (surtout à peine amorcé), les horizons promis paraissent inaccessibles et pourtant, ils seront un jour ou l'autre à portée de main.
En attendant que se réalisent ces promesses et que leur concrétisation soit imminente, je me permets de rappeler ce proche rendez-vous, à Lyon, en compagnie d'Aurélien Delsaux, dont j'avais adoré "Mme Diogène" (article ici). C'est ce jeudi 24 mars, à 18h30, à la Bibliothèque Part-Dieu. Modération : Danielle Maurel.
-
2833
Ce soir, à 19h30, j'ai le bonheur de poursuivre les rencontres organisées par Lettres-Frontière, aux côtés de l'équipe de la médiathèque d'Arenthon.
Le lendemain, je file à Paris pour le Salon du Livre où vous pourrez passer me dire bonjour dimanche, entre 11 heures et 15 heures. Pensez à moi, parce qu'alors, j'aurai livré ma copie à mon éditeur. La Grande Sauvage débutera ainsi son périple éditorial avec deux mois d'avance sur l'échéance que je m'étais fixée, et quatre mois d'avance sur celle qui figure sur le contrat. On m'a laissé entendre que c'était rare, dans le milieu.
Grâce aux lectures des amis, grâce à ma douce pour ces ultimes journées, le manuscrit que je donne à lire a été sévèrement amendé, retravaillé, peaufiné jusqu'à la dernière minute. Il y aura sûrement encore des aménagements (j'ai encouragé mon éditeur à être impitoyable), mais je suis confiant. C'est un moment étrange, ce passage de relais, quand l'auteur pose devant son éditeur (et ami) une pile de papier, trace résiduelle de l'entreprise entamée - disent mes premières notes - en juillet 2014.
Il sera justement question de ce chantier d'écriture et plus généralement de la manière dont un écrivain « fabrique » son roman, le 24 mars à la bibliothèque de La Part-Dieu, à Lyon, en compagnie d'Aurélien Delsaux. Je reparlerai bientôt de ce « dialogue sur les coulisses de l'écriture » que j'attends avec impatience (et pas mal de stress.) -
Les rencontres de mars
Le mois de mars, et surtout les jours qui viennent, sont assez chargés, pour moi. Je me permets ici une petite synthèse. J'en profiterai pour évoquer l'actualité d'un autre écrivain, à propos d'un livre majeur, puissant, dont je vous parlerai plus longuement bientôt.
Vendredi 18 mars à 19h 30, je suis accueilli à la médiathèque d'Arenthon (joyeuse équipe, à ce qui m'a semblé lors de premiers contacts) das le cadre de Lettres-Frontière, pour évoquer surtout L'Affaire des Vivants, coup de cœur pour la sélection française cette année. On m'a parlé d'un jeu… Je ne suis pas inquiet, je sais qu'on va aborder les choses avec légèreté. C'est bien.
Le Week-end qui vient est celui du Salon du Livre de Paris. Dimanche 20 mars, par exemple, n'hésitez pas à rendre une petite visite sur le stand des Indés de l'Imaginaire (Mnémos, ActuSf, Moutons électriques) où de nombreux auteurs seront présents pour signer leurs ouvrages. Pourquoi dimanche ? Eh bien, ce jour m'intéresse particulièrement parce que c'est celui de ma participation (à votre vais, de qui on parle, sur Kronix?). Je serai là, entre 10 heures et 15 heures. Je signe et je fais des petits dessins sur la page de garde. Si, si.
Jeudi 24 mars, retour dans la région occupée par les troupes de Wauquiez. Une rencontre que j'attends avec impatience. Aurélien Delsaux et moi avons été les heureux bénéficiaires d'une bourse d'écriture DRAC + Région. Cette aide est allouée après l'étude d'un dossier, c'est-à-dire, pour un projet de livre. Celui d'Aurélien, Sangliers, et le mien, La Grande Sauvage, approchent de leur conclusion. Ce rendez-vous organisé par l'ARALD est le second d'un cycle intitulé La Fabrique de l'écrivain. Il s'agira pour nous, avec l'aide de Danielle Maurel, de tenter de décrire le processus qui aboutit à un livre (roman en ce qui nous concerne). C'est un exercice difficile, parce que chaque roman est un prototype, que les engouements ou résolutions initiales connaissent des détours et des renoncements, c'est difficile parce que c'est intime. Disons que d'essayer de jeter de la clarté sur ces longs et mystérieux moments nous apportera sans doute beaucoup, à Aurélien et moi. Ensuite, j'espère que de remuer ce magma indécis apportera aussi à notre auditoire. Ce sera à partir de 18h30, à l'amphithéâtre, Bibliothèque de la Part-Dieu (30 boulevard Vivier-Merle, 69003 Lyon) La pression, croyez-moi. Je prends ça très au sérieux.
Ensuite, une actualité qui ne me concerne qu'indirectement, puisqu'elle est celle d'un ami très cher et d'un auteur remarquable. Daniel Arsand sera le 26 mars de 9 heures à 12 heures, à la librairie Ballansat, à Renaison (Loire), pour dédicacer son dernier ouvrage : Je suis en vie et tu ne m'entends pas paru chez Actes Sud. Un roman incroyable, dévastateur, implacable, qui raconte le retour d'un jeune allemand du camp de Buchenwald, où il a passé quatre ans, pour la simple raison qu'il est homosexuel. Arsand nous rappelle qu'en 1990, lors d'une cérémonie du souvenir en France, on repoussa des homosexuels venus inscrire leur mémoire dans le cortège des autres douleurs, au cri de « Au four les pédés ! ». Je vous parlerai bientôt de ce roman formidable, enragé, et je vous conseille dores et déjà de le lire. Je suis surpris et un peu atterré du peu d'écho qu'il rencontre, malgré son intérêt. Pour information, Daniel Arsand sera également accueilli à La Grande Ourse à Dieppe, le 8 avril, et à la librairie Ombres blanches à Toulouse, le 13 avril. Je me fais fort de le recevoir dans l'année à la libraire de ma petite ville d'adoption, Charlieu.
Le mois d'avril est aussi très chargé pour moi ; Kronix vous en dira plus dans une semaine.Lien permanent Catégories : actu, Ecrire, Livres, rencontres avec des gens biens, Travaux en cours 3 commentaires -
Nefs de Pangée - Rencontre
Demain, j'ai le grand plaisir de participer à un soirée thématique SF à la librairie Decitre, située dans le centre commercial Confluence, 112 cours Charlemagne (Lyon 2ème) pour mon dernier roman Les Nefs de Pangée.
 Cette soirée se déroulera comme suit, à partir de 17h30 :
Cette soirée se déroulera comme suit, à partir de 17h30 :
- Table ronde animée par nos libraires et les auteurs invités (moi-même, Alain Boillat, Dominique Douay et Stéphane Przybylski) - durée environ 1h
- Échange et questions du public - durée environ 30 minutes
- Cocktail et jeu inspiré de l'univers de Blade Runner pour une animation à partir de 19h. -
Rencontre
Aujourd'hui, à 18h, la librairie Les Danaïdes, à Aix-les-Bains me fait le plaisir et l'honneur de m'inviter en compagnie de Jean-Laurent DEL SOCORRO (auteur de Royaume de vent et de colères, chez ActuSF) pour parler des mondes imaginaires.
A nous deux, nous réussirons peut-être à remplir la jauge des Danaïdes (huf huf). En tout cas, entrée libre, ambiance amicale garantie.


