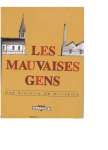Quarante ans plus tard, Marcus cherchait encore. Même aux temps difficiles de ses études, même à la dure époque de ses premiers emplois de botaniste, dévolus à d’autres tâches, même au moment de ses égarements amoureux, il n’avait eu de cesse de parcourir le pays et ses frontières puis l’Europe au sud, puis l’Europe au nord...
La Roumanie et ses vastes contrées encore préservées, son alternance de saisons et ses températures, en certaines lattitudes acceptables, lui sembla digne, cette année-là, de son attention.
Il avait su convaincre les décideurs du CNRS du bien-fondé de ses recherches et était donc, ce jour-là, perdu dans la forêt de ... où rodent encore le loup gris, le chat sauvage et le tortionnaire fugitif. Marcus aimait ce pays.
Au petit matin, il émergeait de sa tente rudimentaire, élevait son regard jusqu’aux cimes embrumées des arbres et respirait, respirait... S’étonnant chaque fois de la chance qu’il avait de faire EXACTEMENT le métier dont il avait rêvé et que, de plus, il lui soit une joie perpétuelle, une source d’émerveillements. Comme de se trouver seul ici, au milieu des bois. La troisième guerre mondiale pourrait bien éclater. Lui, ici, n’en saurait rien et continuerait d’explorer les tourbières détrempées que la forêt recelait.
Le lecteur aura bien deviné, compte tenu de la mécanique conventionnelle d’un récit tel que celui-là, que si l’auteur s’attarde à décrire ces instants de la vie de Marcus Cornélius Eischer, c’est qu’il doit y trouver sans doute l’objet de sa quête. Pourquoi en effet, ménager un suspense qui n’en est pas un : oui, notre biologiste trouva bien, au coeur de la forêt de ..., dans les replis d’un terrain difficile d’accès, au fond d’un marais profond, noir et malsain, dont les moustiques impitoyables défendaient le secret, une nigelle ! Ou même deux ou trois plants, blottis l’un contre l’autre. Décrire l’excitation du chercheur ou plutôt même la confusion, le vertige d’émotions mêlées qui submergeaient alors Marcus serait une tâche bien difficile et lui-même ne pourrait s’en acquitter.
Avant même de les avoir vraiment vues, alors que, les jambes embourbées jusqu’aux cuisses dans le marécage nauséabond, les fleurs de la nigelle n'étaient que d’imprécis éclats blancs, Marcus savait déjà qu’il touchait au but. Sa lente progression lui laissa tout loisir de voir se concrétiser, plus tangible à chaque pas, l’aboutissement de ses recherches. La petite plante indifférente était là, ramassée sur elle-même, ses fleurs mollement balancées par les remous épais que provoquait le chercheur.
Elle attendait, proche et lointaine à la fois, distante et tangible, modeste et orgueilleuse. Incroyablement présente malgré sa taille débile. Marcus fut enfin près d’elle. Comme un automate, il caressa les pétales, les feuilles, épouvanté du silence qui le gagnait tout entier, jusqu’au ventre.
Il dominait cette petite chose ridicule qui lui avait valu quarante ans de passions dont seize de recherches exclusives. Dans son ombre, les minuscules pétales blancs rayonnaient, comme de petits mots chagrins et blessants. Si petite et arrogante... Comme une funeste bestiole, comme une fillette moqueuse dont le rire éclate et tranche. Elle toisait de ses quelques centimètres des années d’abnégation et d’efforts, raillait son adolescence perdue, ses amours négligées. Une saillie aiguë, une écharde mauvaise et dure qui traverse la chair. Un concentré de sarcasmes malfaisants.