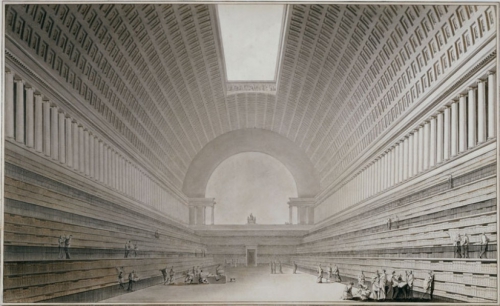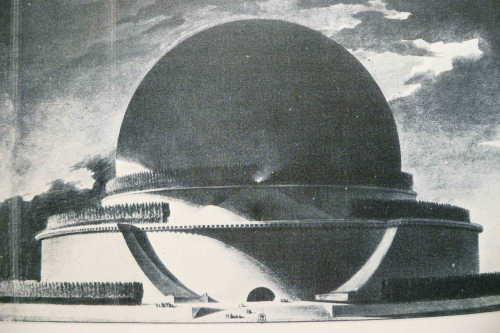Comme vous le savez peut-être, L'Affaire des Vivants, mon livre paru l'an dernier chez Phébus, fait partie de la 22e sélection Lettres Frontière. J'en suis très honoré, et heureux surtout parce que cette sélection a du sens pour moi. Le Baiser de la Nourrice, mon premier roman, avait été pareillement distingué, et les rencontres que cette distinction suscita furent fécondes en amitié, et essentielles pour accepter l'idée que, oui, bon, j'étais un écrivain. Ce n'est pas rien. Une sorte de baptême.
Budget limité oblige, je n'ai pu m'autoriser que la découverte des auteurs rhônalpins. À la lecture des ouvrages de mes quatre confrères, je dois dire que je ne sais pas comment va faire le jury pour resserrer son choix sur une seule œuvre « coup de cœur ». Je lui souhaite bien du plaisir. Débats houleux en perspective.
Comment j'ai mangé mon estomac. Si l'humour est la politesse du désespoir, c’en est aussi un des vaccins les plus efficaces. Atteint d'un cancer, tandis que celui de sa femme s'est déjà déclaré, Jacques A. Bertrand nous fait vivre le parcours bien balisé des soins, des salles d'attente, des sondes humiliantes, des chimios et des radios, des rencontres avec des docteur Bo, professeur Po ou docteur No, sans nous infliger de pathos complaisant, ni d'épiphanie finale, alors que tout cela serait légitime. Sa grand-mère disait souvent « ça me fait souci » quand un problème pointait son nez, Bertrand renverse les vapeurs coutumières en sous-entendant « ça me fait écrire ». Et voici bien la capacité de transmutation qu'on demande à un écrivain. Parce que, quand l'œuvre est accomplie, elle l'est pour le bien de tous. Si on ne craignait pas d'énoncer quelque lourdeur à propos d'un livre si alerte, on pourrait même parler de leçon de vie. Mais chut...
Tristesse de la terre. D'abord, d'abord, pour un amoureux des stylistes comme moi, le plaisir de retrouver la belle et puissante écriture d'Eric Vuillard, que j'avais personnellement adorée à la lecture de Conquistadors (2009, déjà ?). Et puis ce thème, prometteur : l'histoire de William Cody, plus connu sous son pseudonyme (effarant et grotesque, quand on y pense) de Buffalo Bill, à partir de son fameux Wild West Show. J'ai lu ce livre assez tôt, avant de savoir qu'il était sélectionné pour Lettre-Frontières, et le souvenir s'en est en partie effacé. Essayons tout de même. Parce que, justement, je me souviens d'un beau moment de lecture, d'une série de surprises, de la tristesse éprouvée pour Sitting Bull, jouant son propre rôle dans le show, des rapports plus ambigus que j'imaginais (l'histoire ne m'était pas inconnue) entre Buffalo Bill et le chef indien. Il me reste de tout cela une vague nausée, une tristesse en effet, l'impression d'au moins un mystère qui résiste à l'auteur lui-même (volontairement, j'imagine, on ne résout rien sans dommages pour la littérature) : qui était William Cody ? L'autre mystère semble le véritable sujet du livre, en tout cas son approche essentielle : quel est ce monde paradoxal qui dévore les faibles pour ensuite en admirer une représentation indécente et rabaissée ? La fascination de l'occident pour ce qu'il ne peut se retenir de détruire.
Le collier rouge. Ruffin, toujours parfait. Un roman court qui pourrait presque inspirer une pièce de théâtre, puisque l'essentiel du livre est soutenu par deux protagonistes qui dialoguent : Lantier, juge venu enquêter sur l'acte de provocation d'un héros de guerre, et Morlac, le héros en question. Il y a aussi un chien mystérieux, souvent hors-champ mais dont les aboiements occupent toutes les pensées. Le moment le plus fort du roman, les quelques lignes qui permettent au récit de l'élever au dessus des considérations habituelles sur la guerre, est le bilan terrible de Morlac sur le vrai héros de guerre : ce chien qui aboie là-bas, qui était avec lui sur le champ de bataille. Normal qu'un chien soit un héros, il est le soldat idéal, parce qu'il est, intrinsèquement, in-humain. La misère du soldat, et sa possible révolte, viennent du fait qu'il est humain, désespérément, et malgré tout. Pour les lecteurs que le sujet pourrait rebuter, qu'ils se rassurent : ça se termine bien pour tout le monde.
Le mal que l'on se fait. Je l'admets, je ne connaissais pas Christophe Fourvel, publié régulièrement chez La Fosse aux Ours et à qui je voue désormais une admiration profonde. Le mal que l'on se fait aurait pu s'intituler L'Etranger, mais c'était déjà pris. Le personnage principal est approché par bribes, au fil d'une déambulation dans deux villes où il va séjourner plusieurs mois, en Amérique latine et en Turquie, avant de revenir en France. Les raisons de son périple et de son retour, nous seront connues dans la troisième et dernière partie, alors que le « il » initial s'est insensiblement mué en « tu », et donc, a fait traverser le lecteur, par cercles concentriques, de l'enveloppe d'un être jusqu'au plus juste de son intimité.
Des récits d'âmes désamarrées, de solitude paumée dans un ailleurs, la littérature en est obèse. Sauf que là, l'errance n'en est pas une, les pas modestes que fait cet homme (comme font tous les hommes, rappelle l'auteur : « Un homme ne peut pas grand chose, il accomplit de petits pas ») le rapprochent d'un enjeu essentiel auquel il doit se confronter, qu'il doit affronter. La pénitence, double, voire triple, tant l'intolérance de ce salaud a provoqué de malheurs. Notre étranger n'a peut-être pas vécu « trois minutes intenses » depuis des années, et cela vaut peut-être mieux : prendre vraiment conscience de l'ampleur du mal qu'il a causé serait insupportable. Et pourtant, après une ultime rencontre, nécessaire et terrible, par laquelle il espérait partager la responsabilité du drame qui l'a lancé dans son périple, il revient au salaud la tâche d'accepter le désastre. L'errance reprend, il n'ira pas loin. De toute façon, pour ceux qui restent, il y a un avenir, et ça, ils n'y peuvent rien opposer.
Le mal que l'on se fait est d'abord un texte, pardonnez ce truisme, je veux dire : il est ce que je cherche dans un livre, une voix, une langue au plus près, l'incessant questionnement des mots pour disséquer ce qui ne nous épargne pas. Bref, un texte. Oserais-je dire que c'est le meilleur livre de la sélection ? Non, ça ne se fait pas, hein ?
De la sélection suisse, je n'ai lu que Le Miel de Slobodan Despot, parce que c'est avec cet auteur que je partagerai une heure de rencontre le 14 novembre, à Genève, dans le cadre de l'Usage des Mots, la manifestation organisée par Lettres Frontière. Je me permettrai de n'évoquer mon ressenti qu'après, de façon à tenir compte de ce que je pourrais apprendre alors.
Pour plus d'information sur les livres et la sélection, rendez-vous sur le site de Lettres Frontière.