Lancé dans un récit (de prospective, anticipation, SF... comme vous voudrez), déroulant un futur sur plusieurs millénaires, je suis contraint de m'arrêter et de tout remettre en question à cause de nouvelles données scientifiques. Certaines échéances catastrophiques, que, lors de l'écriture de Mausolées (1995, mais publié en 2013), je plaçais à un siècle, semblent se profiler à moins de trente ans. Il devient de plus en plus délicat de faire correspondre la chronologie de mon vieux roman (chronologie cachée, à l'époque : les points de repères étaient volontairement laissés dans le flou) avec le calendrier plus vaste du récit que j'entreprends. Ah, c'est inconfortable, la SF ! Je comprends que des auteurs amoureux de l'imaginaire, emmènent leurs lecteurs dans d'autres mondes, créent un moyen-âge fantastique ou n'importe quelle société débarrassée des cadres de la nôtre, passée ou présente. De même, le roman historique a bien des atouts, car le passé est acquis ; ou encore le roman contemporain, qui est en droit de se concentrer sur les affres des personnages, sans s'inquiéter de déployer un arsenal de contexte, puisque le contexte est celui des lecteurs.
Ce qui est compliqué, c’est la confusion (entretenue, par moi notamment, c’est bien fait), entre contes futurs et divination. Nous ne sommes pas des prophètes, mais aucun auteur du genre ne reniera la bête fierté d'avoir décrit les phénomènes à venir.
Matières à penser - Page 5
-
3457
-
3442
Vous passerez chez le coiffeur, n'est-ce pas ? Vous vous habillerez correctement. Il vaudrait mieux mettre une cravate. Et être bien rasé, aussi, ça compte. Voilà. Vous vous assiérez bien droit. Regardez bien votre interlocuteur dans les yeux. C'est votre futur employeur, il faut que vous lui inspiriez confiance. Un contact franc, direct. Poli, attention. Et puis parlez doucement. Pas trop. Pas trop et pas trop doucement. Juste assez vite. Des mots choisis. Soyez calme, c'est rassurant, quelqu'un de calme. Enfin, surtout, surtout : soyez vous-même.
-
3440
Et voilà, je me suis encore "accroché" avec un membre de la rédaction du Pays Roannais (l'hebdomadaire local). Cette fois, avec le rédacteur en chef (je monte en grade). Je suis encore bon pour des années de disparition dans ce journal, moi. C'est ennuyeux, ils étaient les rares, dans leurs pages, à se faire l'écho de l'actualité littéraire, grâce au concours d'un libraire et ami. Si l'on ajoute que le bulletin municipal de ma ville natale considère qu'avec "le nouveau format du magazine nous réalisons moins d'articles sur des livres" (en fait, plus du tout), la disparition du magazine "La muse" qui relayait autant que possible l'info culturelle, la part donnée de façon générale à la culture devient famélique, et, pour moi, quasiment réduite à néant.
Pour Pierre-Olivier Vérot, avec qui je viens d'échanger des considérations réciproques sur la notion de mépris, je fais partie de ces maudits intellos que les journaux "du peuple" dégoûteraient. Cette antienne un peu rance, resservie à l'envi par Zemmour et consorts, a donc ses affidés près de chez moi. Comme disait (de mémoire) un auteur qui, par ses prises de position, devraient plaire à ce rédacteur en chef : Renaud Camus, la littérature est un lieu de tranquillité, puisqu'il bénéficie du mépris général. Je savoure assez moyennement cette tranquillité, au niveau local (côté national, pas à me plaindre). Me voici donc relégué parmi les intellectuels ennemis du peuple, dont le rédacteur en chef serait, je suppose, un représentant. Si je ne suis pas "du peuple", que suis-je ? Il doit m'imaginer installé dans ma tour d'ivoire, détaché des réalités, condescendant parfois à me préoccuper d'affaires humaines qui sentent trop la sueur à mon goût. C'est amusant. J'aimerais assez qu'on compare nos revenus, pour voir qui est le plus "peuple" des deux... Si c'est un critère, bien entendu, et j'admets qu'il n'est pas suffisant. C'est, au fond, la même discussion qui m'avait valu une première période de boycott dans ces colonnes : j'avais été révulsé par l'idée, défendue par un journaliste du même journal, que la presse "doit donner à son public ce qu'il veut". Voilà ce que je considère, moi, comme du mépris.
Et dire que j'ai le pus grand respect pour les journalistes qui y travaillent. Mais je suppose que ça les dépasse, ce genre de nuances.
-
3439
Mis au défi de mettre au point une utopie qui fonctionne, les élèves de l'atelier que je suis venu « animer » (l'atelier) trouve de suite la solution : prendre tout l'argent disponible et le redistribuer de façon égale à tout le monde. Je rappelle ma demande : une utopie « qui fonctionne », et on n'a qu'une heure devant nous, pas le temps de rigoler, soyons sérieux. Non mais !
-
3438
Je lui adresse une nouvelle récemment publiée et qu'elle a inspirée. Elle m'écrit : « Je ne savais pas que tu avais remarqué tout ce qu'il s'était passé, que tu avais pu ressentir de façon aussi juste ma douleur, ma rage, ma colère contre ma sœur, contre mes parents, contre moi-même, contre ma vie. Si seulement j'avais su cela à ce moment ! J'ai perdu tant d'années à espérer être aimée... Même si cela a ravivé une vieille blessure, ton texte m'a fait du bien. » Nos vieilles batailles, les cicatrices de ces drames moindres et pourtant essentiels... Ma petite maîtrise des mots enfin capable de les soigner. Souviens-toi, je travaillais, ensommeillé, dès l'aube, sur un oreiller de pages, et tu n'y prenais pas garde, tu te moquais, tu négligeais... Tu aurais dû prêter un peu d'attention à l'œuvre au blanc sur quoi j'étais penché, tu aurais dû surveiller les arcanes de mes alchimies. Car le philtre qui vient d'apaiser ton mal, c'est là que je le préparais.
-
3428
Seuls visiteurs sûrement depuis des lustres, nous entrons chez ce petit homme solitaire. Connaissant notre amour des livres, il a décidé de nous montrer sa bibliothèque. Une bibliothèque exclusivement consacrée aux sciences, dans tous les domaines. Ma douce et moi nous frottons les mains par anticipation depuis que l'invitation a été lancée : cela fait quarante ans de professorat, que notre hôte achète régulièrement des ouvrages sur la biologie, l'astronomie, la physique, la géologie, les mathématiques, la paléontologie. Quelle merveille ce doit être !
Nous voici dans le salon comble de rayonnages. Nous ne voyons d'abord qu'une invraisemblable collection de peluches. Les rayons sont encombrés d'oursons musiciens, plâtriers, garçons de café ou docteurs, un orang-outang est juché sur l'ordinateur et une énorme girafe encombre le passage. Les livres ? Oui, on les devine derrière les bibelots, rendus inaccessibles par un peuple de douceur figée.
Le célibataire nous apprend qu'il s'agit d'une collection achetée pour sa défunte mère. Ce n'est pas une bibliothèque, mais deux mausolées imbriqués que nous regardons, voués aux deux amours de son existence, sa maman et la science. Et l'une des deux a submergé l'autre, l'a confinée, masquée, réduite. Le petit homme n'est pas malheureux, non, il a concilié ces deux dévorations et y a consacré sa vie. L'appariement insolite des deux collections, tellement opposées dans leur caractère, entre érudition pointue et décoration poussiéreuse, forme le manifeste d'une solitude irréparable. -
3427
Première rencontre avec des élèves de 1ère, dans le cadre de ma résidence. Nous parlons utopie, puisqu'ils ont étudié ce sujet et que certains de mes livres en explorent des aspects. Le paradoxe de l'utopie est qu'elle n'a pas de lieu, et pourtant… Me promenant autour de cette idée, il me vient à l'esprit qu'il a existé récemment une petite communauté, tentant de faire vivre une utopie : la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Pas mécontent d'avoir su relier un thème millénaire avec notre actualité, je poursuis ma démonstration, que la professeure interrompt. Elle demande aux élèves (car, plus exercée que moi, elle a lu les regards perplexes des enfants) : ça vous dit quelque chose, Notre-Dame-des-Landes ? Moues d'incompréhension. Aucun des élèves présents n'en a entendu parler. Je ne juge pas, je suis seulement abasourdi. Nous ne vivons pas exactement dans le même pays, me dis-je. Je demande alors ce qui, dans l'actualité, a retenu leur attention. En gros : que savez-vous du monde qui vous entoure ? Regards et silences. Après réflexion, une élève témoigne enfin. Il y a bien cette histoire de Trump qui menace la Corée… (je ne suis pas sûr qu'elle précise « Corée du nord »). Bon. OK. Sur le chemin du retour, je me demandais, moi, à leur âge, soit 16-17 ans, ce que je savais du monde qui m'entourait. Honnêtement, je ne sais plus. Il est bien possible que j'en savais autant qu'eux, ou aussi peu.
-
3422
Sur les tombes, entre les deux dates, la minuscule césure qui contient pourtant toute la vie.
-
3420
Je ne suis pas certain qu'une déduction fine s'en suive, mais je remarque que nous sommes passés du format réduit du codex, à celui d'écran de plus en plus larges, de plus en plus vastes, colorés, tonitruants, de plus en plus nets... Ce qui m'inspire cette réflexion (grossière, j'avais prévenu) : notre intellect s'est accoutumé à un appétit de vision pour compenser l'anorexie textuelle, oublie ainsi combien l'infime est le germe de l'illimité.
Et puis encore, toujours à gros traits : du relief, de la couleur, la précision de l'image, du son amplifié, une débauche technologique pour reproduire le réel contre nos murs, mieux qu'aucun peintre de Salon n'a jamais su le faire. Par l'introduction des tableaux animés dans nos maisons, nous nous sommes tous embourgeoisés. Les revenus modestes s'autorisent ainsi ce que leurs pareils de jadis ne pouvaient imaginer : l'exacte même image qui s'agite dans les riches intérieurs, est pendue à leur cimaise. Ce qui nous fait à tous une belle jambe. -
3415
« La philosophie nous enseigne à douter de ce qui nous paraît évident. La propagande, au contraire, nous enseigne à accepter pour évident ce dont il serait raisonnable de douter. » (Aldous Huxley)
-
3408
Allez, vite fait, un petit panorama rétrospectif de l'année qui vient de s'évanouir. Elle a existé, c'est ainsi, personne ne pourra nous enlever ce que nous y avons fait, ni nous absoudre de ce que nous n'aurions pas dû y faire. Je vous épargne les soucis que chacun traverse dans sa vie de tous les jours (par contre, je ne vous épargne pas mes réalisations, c’est mon blog, vous êtes assez grands pour passer à autre chose, je vous fais confiance).
Côté écriture, beaucoup de travail pour pas mal de déception (voire d'ébranlements). Deux pièces de théâtre. L'une, acceptée, mais dont la production est repoussée à une date indéfinie : « Le sort dans la bouteille » (titre provisoire, je vous rassure). Une autre, née d'une initiative passionnante : « Courage », écrite pour une classe de Seconde au lycée Jean-Puy, à Roanne. Nous verrons cela mis en scène par une professionnelle et interprété par les élèves (et pourquoi pas, aussi, par des profs audacieux) avant la fin de l'année scolaire, logiquement. Il y eut aussi cette belle expérience autour des témoignages des tisserands de Charlieu et environs : « Portraits de Mémoire ». Un site, des photos et vidéos de Marc Bonnetin et des musiques de Jérôme Bodon-Clair. Ajoutons deux scénarios inédits : l'un de Bande-Dessinée, pour l'ami Thibaut Mazoyer en recherche d'éditeur, et un de documentaire : « Joseph Déchelette précurseur de l'archéologie ».
Hors les romans avortés (il y en a eu deux, abandonnés cette année : « Cryptes » et « Mado »), j'ai achevé deux manuscrits, l'un pour Mnémos, l'autre pour Phébus. Les deux ont été rejetés, ou plutôt... pas acceptés en l'état. Des ratés, quoi. Plus d'un an d'écriture pour rien, si l'on veut voir le verre à moitié vide (ce qui est ma nature, hélas). Tout reprendre, tout refaire, tout reconsidérer, sans garantie de faire mieux. Bon. Encore sous le coup de cette double perplexité de mes éditeurs, je n'ai pas écrit plus d'une page ou deux, depuis. Ces échecs m'ont atteint plus que je ne saurais le dire, plus que je ne croyais en tout cas. Combien de temps peut-on se prétendre écrivain quand on n'est plus publié ? Dans le même temps, j'ai vu tant d'amis auteurs bien « implantés », réputés, sûrs, dont les manuscrits sont refusés… Je ne me plains donc pas. Je préfère qu'un éditeur me refuse des textes faibles plutôt qu'il les accepte pour de mauvaises raisons (même l'amitié serait une mauvaise raison). Je vais donc tenter de travailler mieux, avec encore plus d'exigence. Dès que je serai remis de ce double uppercut.
Côté publication, l'année a commencé avec clairons et tambours (en fanfare, quoi), par la sortie de « La vie volée de Martin Sourire » chez Phébus. Réception variable, mais plutôt bonne en général, une presse assez attentive à ce qu'elle considère comme mon deuxième roman (la presse ignore ma veine « imaginaire » et mes romans précédents, éditions trop confidentielles pour lui être parvenues). Des lecteurs nombreux, des retours, des fidélités qui se dessinent. Quelques prix ou sélections, de nombreuses rencontres, de nouvelles librairies qui commencent à s'intéresser à mon travail. Pour la première fois, avec ce titre, des éditions simultanées pour « clubs de lecture » : France-Loisirs, Le Grand livre du Mois… dont des libraires et amis me disent que c'est dévalorisant. C'est possible. Il faut que je vous dise, ici, qu'on ne me demande pas mon avis. Mon éditeur me prévient seulement que mon roman va être publié chez un tel ou un tel, point. Dans le cas contraire, m'y opposerais-je ? Je ne crois pas : je vis toujours le syndrome de l'auteur immensément reconnaissant (et un peu incrédule, même) qu'un éditeur veuille bien dépenser des sommes extravagantes en pariant sur ses écrits. Alors, si l'éditeur peut rentabiliser son investissement, et bien, ma posture d'auteur trop au dessus de la mêlée pour confier ses si belles réalisations aux communs, me paraîtrait à la fois méprisante et vaniteuse.
2018, année aussi des sorties en poche de deux romans : « L'Affaire des Vivants » et « Les Nefs de Pangée ». Deux versions dont je suis assez fier. La couverture du poche de « L'Affaire des Vivants » enfin, belle ! comme j'aurais souhaité que celle du grand format le fût. Une seconde vie pour ces deux romans. Je n'ai pas encore les chiffres (il faut attendre plus d'un an), mais j'ai vu les livres bien diffusés, longtemps. Notons pour « L'Affaire » une diffusion particulière sous la forme « Mybookbox », une jolie formule et un contact chaleureux avec les inventeurs de cette formule.
Côté publication, toujours, un grand merci aux Éditions Le Réalgar d'avoir accepté un texte singulier : « Lettre Ouverte à l'autre que j'étais », et aux éditeurs associés pour l'occasion : Mnémos et Les Moutons électriques, d'avoir élevé au statut de préface un article spécialement écrit pour l'occasion de la réédition de « Salammbô » de Flaubert. Une manière de se réapproprier ce monument et de le revendiquer comme l'ancêtre, le précurseur, du genre Fantasy. Vision à laquelle j'adhère totalement, d'où ma participation avec un long texte intitulé : « Salammbô, raté, comme un chef-d’œuvre ». Enfin, une publication confidentielle, prévue en 2017, ne sortira qu'en début de cette année : « Étrangères » aux éditions Les Petits Moulins.
2017 aura été riche en commandes. Une conférence sur l'histoire de l'Art abstrait : « Retour aux signes » et une « masterclass » autour des scènes de batailles. Beaucoup de travail pour les préparer, je n'ai pas fait les choses à moitié, je vous assure. La récompense étant, par les réactions venues ensuite, de constater qu'on a pu apporter aux autres.
Et puis un grand nombre de rencontres en librairies, en bibliothèques, dans des classes en collèges ou lycées, ou dans des salons du livre. Cette année, j'ai choisi avec plus de rigueur qu'autrefois ceux auxquels j'étais invité : Salon du livre de mer de Noirmoutiers (pour « Les Nefs de Pangée »), Fête du livre de Saint-Etienne, Salon du livre de Ménétrol et surtout le festival de littérature itinérant « Les Petites Fugues » en Franche-Comté, dont je ne cesse de vanter les mérites autour de moi. Je distingue l'expérience de la rencontre au « Hibou Diplômé », petite librairie de ma région, car elle avait la particularité d'être inspirée par un lecteur. Il se reconnaîtra, qu'il soit ici remercié.
2018 s'ouvre avec la perspective d'une résidence d'auteur. Dès la semaine prochaine, je serai à Saint-Etienne, par la grâce d'un jury qui m'a proposé. Je ne vous accable pas de mes expressions émues. Sachez seulement que, parmi les membres dudit jury, il y a deux écrivains que je vénère (sans parler d'un éditeur et d'un bibliothécaire bienveillants). Je ne sais pas encore si Kronix sera le relais quotidien de cette expérience prometteuse mais je vous signalerai les rendez-vous publics qui vont ponctuer trois mois d 'installation dans la préfecture de la Loire.
Assez parlé bilan, l'année 2018 s'ouvre sur de belles promesses. J'essaierai d'en être digne.
Bonne année à vous aussi. -
3407
je me souviens qu'une certaine année (ce devait être 2014) où, sur un caprice peu coûteux, j'avais refusé de le dire. L'année en question se déroula avec une moyenne de drames et de joies semblables aux précédentes. L'absence de mes vœux n'avait donc rien changé. Cette année, allez, je veux bien me plier à cette tradition dont nous savons tous qu'elle est idiote mais qui doit être, quelque part, de l'ordre du signe amical adressé universellement, alors pourquoi se priver ?
« Ô doute ! je te hume, arôme délétère
Toi qui fais vaciller mon ancrage à la Terre ! »
(Petrus Irénée de Songecreux, 1711-1744, cité par l'ami Roland Bouly dans ses propres vœux. Je le soupçonne d'avoir inventé, façon Borgès, cet auteur du XVIIe. La phrase n'en reste pas moins délectable)Bref...
Entre doutes et certitudes, soyons éveillés, éblouis, curieux, tendres et incertains.
C'est le meilleur de notre condition.
Bonne année 2018, paraît-il ! -
Causons avec Christian Degoutte
Kronix est fier de vous offrir ce grand entretien avec Christian Degoutte. Merci à lui. Cette « causerie » comme il préfère l'appeler a été réalisée par courriel, le mois dernier. Profitez, parce que la parole de Christian est rare, et, comme vous allez le lire, précieuse.
Christian Degoutte est né le 10 septembre 1953 « la même année que le livre de poche ». Il habite près de Roanne, à quelques pas de la Loire. « Pile entre les Montagnes du Matin et les Montagnes du Soir. Sur les marches tantôt du Forez, tantôt du Beaujolais…. » Romancier et poète, il lui est arrivé de se définir comme « Un cycliste en sabots sur les pentes du Ventoux ou comme un Dexter Gordon aux doigts cassés par l'arthrose. » Il participe à la revue Verso, dans laquelle il chronique les nombreuses revues de poésie dans une rubrique nommée « En salade ». C'est un auteur qui aime faire connaître le travail des écrivains et poètes (il rassemble des textes de Claude Seyve pour les éditions Gros Textes, en 2000, par exemple). Ce goût pour l'écriture des autres était visible, pour ma part, dans sa revue Bulle où il consacrait plusieurs pages à l'actualité poétique. C'est aussi l'impression qu'avait laissé son passage à l'écritoire d'Estieugues, où le garçon avait si peu parlé de lui, pour préférer raconter 'ses' poètes. On retrouve certains de ses textes dans l’anthologie Poésie d'aujourd'hui en Rhône-Alpes (Maison de la poésie Rhône-Alpes et éd. Le temps des Cerises) et dans La poésie de A à Z (éd Rhubarbe) de Jacques Morin. Après ses premiers textes comme Sibylles Ocres ou L'Homme de septembre (écrits sous l'influence de René Char ?) Christian Degoutte se tait pendant 20 ans.> Des remarques sur cette présentation ?
Christian Degoutte - Une petite correction : L'homme de septembre n’est qu’un bout de Sibylles Ocres. Cette plaquette, si je me souviens bien, est un bric-à-brac de poèmes plutôt raconteurs.
Sinon l’œuvre de Char avait un côté pétrifiant. Cette haute idée du poète qu’il interrogeait sans cesse faisait qu’on ne savait plus où se mettre. Je dis ça pour des gens qui ne sont sûrs de rien et surtout pas d’eux-mêmes.
Ceci dit, il y a des choses magiques dans l’œuvre de René Char : Congé au vent par ex. Qu’il vive, Allégeance, L’amoureuse en secret…
> Je vous ai entendu dire, à propos de votre "silence" de 20 ans, évoqué plus haut : « C'est comme ça, je n'écrivais rien d'utile » Vous pouvez préciser cette notion d'utilité en poésie, et pourquoi ce silence ?
En vrai, c’est le futile que je n’osais pas affirmer. Cette remarque a l’air d’une blague, pourtant… Bon, comme pour tout agissement humain, il y a tout un tas de causes à ce silence extérieur bien relatif : je noircissais des cahiers et des cahiers de notules, de bribes, d’intentions, de bouts de trucs, d’idées fumeuses…
D’abord une incapacité à se libérer des modèles, à oser ce qu’on croit juste. D’où « faire de la poésie » était, à la fois, rêve caressé, objet de pulsion, de désir, d’impatience, de violence et de répulsion, d’écœurement, de crispation. Un signe impuissance ?
Je ne savais pas encore que c’est le poème qui commande, qu’il a un fil comme le bois ; qu’il faut des années, voire des dizaines d’années, avant qu’il trouve sa résolution (ainsi que l’on dit en musique ? Comme si un poème était toujours l’objet d’une tension harmonique !)
Je ne savais pas que l’on a beau faire, que l’on écrit toujours depuis l’intérieur de sa nature, son vécu, ses capacités… Que jamais je n’aurai les jambes de Marie-Josée Pérec, d’Eddy Merckx ou la couenne amarinée d’Éric Tabarly.
Enfin un jour je suis tombé sur ce propos de Constantin Brancusi : ce n’est pas que les choses sont difficiles à faire, ce qui est difficile c’est de se mettre en état de les faire. Y’avait plus qu’à.
Retour à l'écriture dans les années 90 avec ce que vous appelez de « faux poèmes »
> Comment ça ; de faux poèmes ?
Retour ? Donc non. En farfouillant dans mes cahiers, mes manies, mes tics m’ont sauté aux yeux. Par exemple j’écrivais « comme si » à tout bout de champ. J’ai fait une collection de ces phrases commençant par cette expression. Je l’ai envoyée à Roland Tixier qui l’a publiée aux éd. du Pré de l’Age sous ce titre Comme si. Cet ensemble a plu à Claude Seyve qui m’a sollicité pour sa collection VR/SO : j’ai de nouveau puisé dans mon bric-à-brac de phrases pour composer Jokari. Zéro inspiration là-dedans. Juste du collage. Si c’est pas ça qu’on appelle faire semblant de faire de la poésie ? Tordre des notes intimes pour les ordonner en suite : j’avoue que cela a fini par être un procédé. Un truc qui n’avance à rien. Comme s’il n’y avait personne à l’intérieur du texte. Quand j’ai laissé les choses en fouillis comme dans Sur les hauteurs de St Polgues, elles me sont devenues plus justes. Vous dites aussi que vous faites « fictionner la poésie ». L'un de vos récents ouvrages est une sorte de nouvelle poétique Jour de Congé sous-titré « Récit », d'ailleurs. Une femme, qu'on imagine jeune (« tendre cycliste, juste vêtue des particules de la vitesse) profite d'un jour de congé pour se promener en vélo, « sous un soleil massif ». On suppose un été dans le sud de la France... la jeune cycliste traverse le paysage. Une journée déroulée, une sorte de nouvelle. Du matin au soir.
Vous dites aussi que vous faites « fictionner la poésie ». L'un de vos récents ouvrages est une sorte de nouvelle poétique Jour de Congé sous-titré « Récit », d'ailleurs. Une femme, qu'on imagine jeune (« tendre cycliste, juste vêtue des particules de la vitesse) profite d'un jour de congé pour se promener en vélo, « sous un soleil massif ». On suppose un été dans le sud de la France... la jeune cycliste traverse le paysage. Une journée déroulée, une sorte de nouvelle. Du matin au soir.
> Un poème, c'est une histoire ?
Inscrire le poème dans une histoire, j’aime bien cette idée. Que le poème avance, nage, marche, roule, galope. Comme le Romancero Gitan de Garcia-Lorca. Et si la poésie, en passant, veut bien se montrer à la fenêtre, alors…
J’aime bien cette idée parce qu’elle nous débarrasse de tous ces gnagnagna du poète-prophète, visionnaire, flambeau de l’humanité, éclaireur de l’avenir ; toutes ces conneries du poème-tombé-du-ciel, de la poésie-extase, de la poésie-pépite (comme si le poème n’était pas autant dans ses scories…)
Parce qu’elle nous débarrasse des poèmes-discours, de ça qui nous veut en clameur au bas des tribunes.
Le poème n’est qu’un véhicule littéraire. Au bout du compte guère différent de la bicyclette qu’un mécanicien assemble dans son atelier, du soin prodiguée par une infirmière, d’une tarte aux pommes, ou de la prière adressée à l’invisible parce que d’un coup, sur nous, la douleur est trop lourde etc. Le poème est un acte humain comme un autre : chargé des mêmes mensonges et des mêmes vérités, etc.
La poésie, c’est différent. Elle est en quelque sorte transversale puisqu’elle voyage depuis toujours dans les poches de l’humanité : ce qui la suscite est à la fois commun à tous et particulier à chacun. Pas la peine de la chercher bien loin, elle reste à portée de main ou pour dire mieux : à portée de lèvres.
Jour de Congé est accompagné de créations graphiques de Jean-Marc Dublé.
> Comment s'est passé votre collaboration ?
Quand on écrit, souvent une bien étouffante solitude nous tombe sur le paletot. Faut sortir, trouver quelqu’un avec qui boire un coup, partager une tournée. Donc ce recours (cette sollicitation, cette prière) à des œuvres graphiques, à une personne qui les ferait, c’est bien trivial. Voyez : rien qu’une façon d’échapper à l’état déplorable dans lequel on se met en écrivant. Qu’attendent les artistes (plasticiens) du partage des pages avec un faiseur de vers ? Quel bénéfice espèrent-ils ? Quelle forme de promotion, de publicité (bien illusoire quand on connaît le retentissement de ce type d’écrit) ? C’est pour moi, un mystère. C’est à eux qu’il faudrait poser la question.
J’ai sollicité Jean-Marc Dublé parce que je connaissais son talent de « gribouilleur » qu’a pas la grosse tête. Et je savais qu’avec lui, j’échapperais aux barbouillages d’encre (genre essuyage de pinceau) qui sont à l’honneur dans moult livres de poèmes. Qu’il y aurait de quoi rire ensemble.
Mais ce que j’ai découvert, c’est l’homme à son métier de croqueur d’images ; comment ça le triturait rudement pour mettre en mouvement le paysage (mental) que traverse le texte ; pour produire les accidents qui relancent le poème. Pour en faire voir le contre-champ. Le contre-chant, ça marche aussi. Dans la revue Voleur de Feu qui vous est consacrée, on découvre de grandes gravures d’Iris Miranda. Vous-même, à l'époque de Bulles vous ouvriez vos pages à des artistes. Souvent, la publication de poésie est le lieu (j'allais dire le prétexte), d'un compagnonnage visuel (il est arrivé que ce soit la photographie, pour vous).
Dans la revue Voleur de Feu qui vous est consacrée, on découvre de grandes gravures d’Iris Miranda. Vous-même, à l'époque de Bulles vous ouvriez vos pages à des artistes. Souvent, la publication de poésie est le lieu (j'allais dire le prétexte), d'un compagnonnage visuel (il est arrivé que ce soit la photographie, pour vous).
> Que vous inspire ces liens anciens (et comme allant de soi) entre textes poétiques et images ?
C’est bête à dire, mais les images font s’ouvrir les livres. Ça ramène au plaisir des illustrés de l’enfance.
Sinon, je voudrais, bien naïvement, que chaque poème prouve la quadrature du cercle. Un des éléments de cette démonstration c’est que le poème soit une sorte de fête des sens. Les choses tombées du pinceau (ou du crayon) participeraient à cette fête. Pour danser avec le texte. Métaphore un peu cucul, j’en conviens, mais qui dit bien une façon d’aller ensemble des images et du texte.
C’est William Mathieu, le patron de Voleur de feu, qui a réuni les façons d’Iris Miranda et les miennes. On s’est retrouvés sur la même piste pour partager quelques valses. Qu’ils soient tout deux, Iris et William, vivement remerciés.
A propos de Jour de Congé et du vélo dont vous êtes un adepte (passez-moi l'expression), vous nous conviez, comme souvent, à un festin de sensualité. Sous la lumière, la robe de la cycliste oscille entre le vert et le bleu (« … les cuisses … dans le fourreau d'abeilles de la lumière »). La vie est sensuelle, tout respire et tout bat, la chair est partout sous le soleil : « les mamelles de bruyère » ; « une fillette sur une balançoire, échevelée jusqu'au sexe » ; « les cailloux gardent mémoire de la sueur » ; « le temps est un animal qu'elle caresse contre sa cuisse » Et c'est ainsi dans beaucoup de vos recueils (tous ?). Tenez : dans Henry Moore à Nantes, à la sensualité des femmes en courbes de Moore répond celle des robes des visiteuses, « plis nombreux dans l'étoffe des robes et des jupes comme une profusion de lèvres. » L'envie de toucher, bien sûr, est pressante (« toucher, toucher, toucher : ferraille et barbe, herbe, peau, toutes les peaux... »). Les jeunes étudiantes en job (et en robes) d'été surveillent « à l'intérieur des sculptures, je touche des os : la tige du fémur, la lame du tibia, les degrés d'une nuque, du désir dur. » « C'est oser qu'on voudrait, aller nu pieds... » « Je trouve aux figures couchées d'Henry Moore quelque chose des couilles étalées sur la cuisse. » Dans Sous les feuilles : « seins en grappe cuisses rapides sexes pressés chacun emballé dans sa peau » ; à propos des passantes : « larguer mes mains dans les passantes, toucher les danseuses » « toucher l'air prendre l'air à pleines mains plonger dans les danseuses » ; « toucher leurs gambades » ; « cette robe dont tu sors presque nue comme d'un lac de feuillages ». Dans Des oranges sentimentales, le sexe, sans tourment, est comme un dialogue solaire. Estival, coloré, à peine traversé d'ombres, entre sueur et salive, souffles, haleines, entre les cuisses nombreuses, toujours, et « la chair lunaire des bras », entre « la bouche sombre des aisselles » et les seins « jaspés de veines » entre pupilles et mains, et « sa bouche sur tes lèvres est un ocarina de glaise fraîche », tout l'inventaire des sources du plaisir des sens, des corps d'hommes et de femmes, accueillants, aimants, doux. Et la vitalité, le bonheur de l'amour, « comme on libère les fauves du souffle », « comme on croque tout le long du corps les petits bulbes des chagrins », « comme on pèse de toute sa chair sur l'impatience d'en venir aux lèvres » Etc. etc. Chez vous, tout est toujours sensuel. Je devine même un certain fétichisme de la cuisse… (une récurrence de l'image en tout cas, dont je vous accorde qu'elle est plaisante).
Tenez : dans Henry Moore à Nantes, à la sensualité des femmes en courbes de Moore répond celle des robes des visiteuses, « plis nombreux dans l'étoffe des robes et des jupes comme une profusion de lèvres. » L'envie de toucher, bien sûr, est pressante (« toucher, toucher, toucher : ferraille et barbe, herbe, peau, toutes les peaux... »). Les jeunes étudiantes en job (et en robes) d'été surveillent « à l'intérieur des sculptures, je touche des os : la tige du fémur, la lame du tibia, les degrés d'une nuque, du désir dur. » « C'est oser qu'on voudrait, aller nu pieds... » « Je trouve aux figures couchées d'Henry Moore quelque chose des couilles étalées sur la cuisse. » Dans Sous les feuilles : « seins en grappe cuisses rapides sexes pressés chacun emballé dans sa peau » ; à propos des passantes : « larguer mes mains dans les passantes, toucher les danseuses » « toucher l'air prendre l'air à pleines mains plonger dans les danseuses » ; « toucher leurs gambades » ; « cette robe dont tu sors presque nue comme d'un lac de feuillages ». Dans Des oranges sentimentales, le sexe, sans tourment, est comme un dialogue solaire. Estival, coloré, à peine traversé d'ombres, entre sueur et salive, souffles, haleines, entre les cuisses nombreuses, toujours, et « la chair lunaire des bras », entre « la bouche sombre des aisselles » et les seins « jaspés de veines » entre pupilles et mains, et « sa bouche sur tes lèvres est un ocarina de glaise fraîche », tout l'inventaire des sources du plaisir des sens, des corps d'hommes et de femmes, accueillants, aimants, doux. Et la vitalité, le bonheur de l'amour, « comme on libère les fauves du souffle », « comme on croque tout le long du corps les petits bulbes des chagrins », « comme on pèse de toute sa chair sur l'impatience d'en venir aux lèvres » Etc. etc. Chez vous, tout est toujours sensuel. Je devine même un certain fétichisme de la cuisse… (une récurrence de l'image en tout cas, dont je vous accorde qu'elle est plaisante).
> Êtes-vous « l'enfant des automnes ? » (Page 33 de Sous les feuilles) qui apprend la sensualité en traversant en vélo des tapis de feuilles et en rêvant aux robes des baigneuses ?
Bon, je ne vais pas répondre à toute la question.
Oui, je suis par ma naissance comme Guillaume Apollinaire (pardonnez le côté je-me-pousse-du-col de la comparaison) « soumis au chef du signe de l’automne ». Mais je crois (pour le plaisir de dire) qu’on naît plusieurs fois au cours d’une vie (quand cette vie n’est pas trop tôt réduite à néant). Que nos vies, pour aussi continues qu’elles paraissent, sont, pour reprendre une image éculée, comme les rivières, relancées par des accidents dans leur pente.
Donc j’ai eu cette chance incroyable : une de mes naissances a eu lieu quand la minijupe déferlait sur la France. C’est quand même plus plaisant que de naître sous les bombes, non ? Les jambes des filles c’est l’été en toute saison. Je suis né aussi avec l’apparition des seins nus sur les plages. C’est cet instant de grâce qui fait, comme dit l’autre, que « je sais aujourd’hui saluer la beauté ! ». Je suis né quand la blonde dont j’étais amoureux se voulait frisée comme Angela Davis : elles étaient également explosives. Je suis né quand j’ai vu mes enfants sortir des « entrailles » de leur mère. Et j’imagine que je suis né à la poésie chez mes grands-parents dans cette grande salle qu’on appelait cuisine (la ferme n’avait que cette cuisine et une chambre) quand je lisais et relisais jusqu’à plus soif les douze poèmes de Maurice Carême du calendrier de l’année. Et les douze de l’année précédente. Etc. Pensez des paysans, jeter un calendrier ! Maurice Carême ! Je veux croire qu’il me sera beaucoup pardonné. Dans ce que j’écris…
On écrit qu’à partir de ce qui nous a éblouis ; que ce soit merveilleux, ravissant, terrifiant ou ignoble. C’est ce qu’affirment certains spécialistes. Tandis que d’autres spécialistes soutiennent que l’on n’écrit rien d’autre que ce qui nous a manqué (dans l’enfance, bien-sûr). D’où j’aurais ce besoin incessant de toucher, de caresser, de nommer le corps, les parties du corps, toutes. Bah ! De la même manière, j’espère, qu’Allen Ginsberg dans Howl : « Sacré ! Sacré ! Sacré ! Le monde est sacré ! L’âme est sacrée ! La peau est sacrée ! Le nez est sacré ! La langue et la queue et la main et l’anus sacrés ! Tout est sacré !... ».
Une combinaison des deux, peut-être : l’éblouissement et le manque ?
> Je dirais que vous comblez une timidité étrange dans la poésie contemporaine à évoquer non pas l'amour (ça…), mais le corps, les sens, la chair pétrie et caressée. Tiens : avez-vous imaginé faire de la sculpture ?
Vous avez l’œil ! Oui, c’est par là que j’ai commencé. Pour situer : j’ai 8, 10 ans… Comme mes productions, en bois ou en terre ou en boites de conserve martelées (chez mes grands-parents encore !) ont plutôt fait rire, ou pire provoqué des regards désolés (« c’est pas pour nous ça, les ouvriers, les petites gens, etc » était une des sentences maternelles. Du côté paternel, les références culturelles étaient plus nettes : giclettes de branleur et autres délires de tapettes) : j’ai abandonné la sculpture. Preuve que je n’étais ni Rodin ni Germaine Richier ni Emile Ratier. J’ai compensé (encore !) ensuite en fabriquant des meubles (buffet, armoire, lit, table, chaises, etc…) : du sérieux, de l’utile, du qui provoquait les bravos : on a tous nos faiblesses : on veut être aimé. Ghost Notes et Au toucher sa peau brille, A huit et la petite foule et Chanson pour Hautbois semblent de la même veine ou parentes. En tout cas, participer d'une même intention, d'une attitude envers le quotidien, un catalogue d'images saisies, d'instantanés sur lesquels vous vous attardez qui feraient surgir des souvenirs musicaux ou que vous reliez à un morceau, de variété ou de classique, de jazz, de tout ce qui produit une culture musicale.
Ghost Notes et Au toucher sa peau brille, A huit et la petite foule et Chanson pour Hautbois semblent de la même veine ou parentes. En tout cas, participer d'une même intention, d'une attitude envers le quotidien, un catalogue d'images saisies, d'instantanés sur lesquels vous vous attardez qui feraient surgir des souvenirs musicaux ou que vous reliez à un morceau, de variété ou de classique, de jazz, de tout ce qui produit une culture musicale.
> Pouvez-vous nous parler de ces textes dont on pourrait croire qu'ils sont nés d'un même ensemble ?
D’une même évolution, peut-être ? Je reconnais une maniaquerie du détail réel, du détail sensible. Jadis on aurait dit du truc qui va impressionner la pellicule, mais au temps des pixels que vaut cette métaphore ? Ce sont des façons qui ne sont guère différentes du travail romanesque. Ça me rappelle ce conseil que Jean Paulhan adresse à Marc Bernard (un Goncourt d’antan) : « Ne dites pas les choses, montrez-les ».
Je ne crois pas que le poème tombe tout rôti dans le bec de l’auteur.
Je sais que, pour dire l’émotion (cette chose animale ?) qui est à l’origine du besoin d’expression, les premiers mots qui viennent sont des clichés, tous les tics mentaux accumulés. Qu’il faut commencer par s’en débarrasser. Et que si l’expression semble neuve, actuelle, souvent elle dit quand même des vieilleries.
Un exemple : une nuit d’été, une porte ouverte, une femme noire qui fait la vaisselle dans l’arrière-cuisine d’un restaurant. Elle chante façon blues. La première chose qui attrape, c’est le pittoresque, l’exotique ; je veux dire vu d’ici où les femmes noires sont rares. Et le blues de même. Le poème pourrait s’arrêter là. C’est sympa, l’exotique.
Mais cette femme me trouble (je crois que c’est un des maîtres mots du poème, ce trouble). Bref, je sens bien qu’elle dit tout haut quelque chose que je n’arrive pas à entendre. Je passe et repasse entre la Loire et ce restaurant : je relève les détails. Elle fait toujours la vaisselle, elle chante toujours. Ce que je voudrais parvenir à faire.
Ce trouble me renvoie à une autre femme qui avait ôté ses chaussures, à un homme assis au café qui ressemblait à la photo d’Eugenio Montale sur un livre que j’ai lu maintes fois, etc. à ces gens qui font corps avec l’instant, avec la matière qui les entoure : les jambes qui vont, les mains qui font, les mots qui soulignent les gestes, les gestes qui prolongent l’espace et font dévier la course du temps ; tout ce qui dit le trouble (la nudité, l’humanité ?) sous les apparences (sociales ?). Oui, ces poèmes sont nés d’un même mouvement. C’est les nécessités de l’édition qui les a éparpillés.
> Quand vous jouez*, arrive-t-il que vous pensiez 'poésie' ?
Penser poésie, non surtout pas : quand on fait de la musique faut avoir toute la tête à ça. Mais garder les oreilles ouvertes (les yeux, l’odorat, la peau, etc. itou) pour ne pas se laisser perdre la poésie si elle survenait. Ça oui.
Quand les musiciens parlent : dimanche dernier, nous travaillons des morceaux cubains. Notre chef nous prodigue ce conseil (c’est plutôt une exigence) : pour que ça danse, il faut que chaque silence soit dynamique. Voyez , pas besoin de penser poésie. Si l’on s’arrête sur ces mots : un silence dynamique : il y a de quoi nourrir ses sensations, son imaginaire des heures durant. Quelle leçon : Un silence dynamique !
C’est donc le contraire : c’est quand j’écris que je pense musique. Que je pique des trucs musicaux pour tâcher d’en faire des effets de langage.
Dans d'autres textes (dont certains inédits), j'ai pu admirer votre capacité à évoquer la musique, à décrire comment on la reçoit. Je sais que vous êtes musicien (clarinettiste), que votre compagne est accordéoniste… La poésie est traditionnellement associée à la musique. A moins de composer, les enjeux d'une pratique et de l'autre sont pourtant différents.
> Quel lien les unit, pour vous (ou les sépare) ?
Je crois que là-dessus, je n’ai rien à dire d’original.
Ce qui unit la musique et la poésie, c’est leur permanence : aussi vieilles (ou jeunes) que l’humanité l’une comme l’autre sont une pâte sonore avec des prétentions magiques.
Outre le besoin d’expression commun à tous les arts (voici une affirmation bien hâtive, mais passons), ce qui unit la musique et l’écriture, c’est en quelque sorte la mise en évidence de la relativité du temps.
Ce qui sépare poésie et musique : le concret et l’abstrait (je ne fais que reprendre des théories : de qui ?). Langue pour l’une, langage pour l’autre.
Mais quand l’écriture n’a qu’un fil la musique court plusieurs voix à la fois, mêle les registres. J’envie cette simultanéité. Je suis jaloux de la façon qu’a la musique d’installer le temps dans toute sa largeur. D’offrir sans cesse des instantanés panoramiques. Du mouvement panoramique.
C’est ce que fait Jérôme Bodon-Clair** lorsqu’il vient mêler ses compositions musicales au texte de Jour de Congé : il en élargit le propos. Il le transforme en moment choral. Et nous (Odile Gantier, Jean-Marc Dublé et moi-même) qui en donnons une représentation publique (j’aime ce moment) nous devenons un chœur. Un trio ! Bon d’accord, un trio.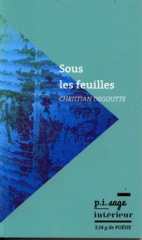 Je reviens à la sensualité, chez vous. Elle n'est pas seulement celle des corps en surfaces, elle se trouve sous nos pas, « entre les larves qui boulangent la terre » ; (Jour de Congé) mais là, c'est une forme terrible, morbide, sur quoi vous revenez plusieurs fois. L'impudeur comme décrire un accouchement, crûment. Dans Sous les feuilles : « Orchidée de ta mère » où vous trouvez une manière incroyable de décrire un accouchement… L'inavouable, du deuil et de la mort « ce beau scandale que tu es de n'être venue que pour obscurcir de ton sang le mystère déjà si emmêlé de vivre » ; « puisque tu ne fais rien qu'à mourir je t'en prie ne fais rien qu'à mourir lentement » (c'est l'exigence qu'on pourrait avoir pour tous les êtres qu'on aime.) Ou dans Il y a des abeilles : « Tu reposes, juste vêtue d'un court jardin » ; « tu feras seule tes premiers pas de morte » ; « fallait-il que tu meurs pour que je devienne comme un autre ». Des mots qui vont jusqu'à l'obscène. Sous les feuilles, encore, le corps, sans artifices, sang viscères, excréments, os, fluides : « suivre les lacis palpitant de tes veines descendre lentement où mûrissent les fruits chauds de tes viscères » ; « la sauvagerie de tes organes ». Et dans Il y a des abeilles, « Je marche sur la terre dans laquelle Tu dors je marche sur ta nuit je marche Sur ton sommeil je marche sur l'eau crevée De tes regards Sur ta bouche remblayée De terre à galets tes dents descellées Comme des silex sont-elles déjà à coudre Bord à bord le tissu du temps Et la langue des baisers que tu Glissais entre mes dents quel fruit Pourri, quelle poire blette C'est déjà » ; « le jus de ta chair abreuve les prés alentour ». Des passages superbes et éprouvants (oui, cette interview est un exercice d'admiration, on l'aura compris).
Je reviens à la sensualité, chez vous. Elle n'est pas seulement celle des corps en surfaces, elle se trouve sous nos pas, « entre les larves qui boulangent la terre » ; (Jour de Congé) mais là, c'est une forme terrible, morbide, sur quoi vous revenez plusieurs fois. L'impudeur comme décrire un accouchement, crûment. Dans Sous les feuilles : « Orchidée de ta mère » où vous trouvez une manière incroyable de décrire un accouchement… L'inavouable, du deuil et de la mort « ce beau scandale que tu es de n'être venue que pour obscurcir de ton sang le mystère déjà si emmêlé de vivre » ; « puisque tu ne fais rien qu'à mourir je t'en prie ne fais rien qu'à mourir lentement » (c'est l'exigence qu'on pourrait avoir pour tous les êtres qu'on aime.) Ou dans Il y a des abeilles : « Tu reposes, juste vêtue d'un court jardin » ; « tu feras seule tes premiers pas de morte » ; « fallait-il que tu meurs pour que je devienne comme un autre ». Des mots qui vont jusqu'à l'obscène. Sous les feuilles, encore, le corps, sans artifices, sang viscères, excréments, os, fluides : « suivre les lacis palpitant de tes veines descendre lentement où mûrissent les fruits chauds de tes viscères » ; « la sauvagerie de tes organes ». Et dans Il y a des abeilles, « Je marche sur la terre dans laquelle Tu dors je marche sur ta nuit je marche Sur ton sommeil je marche sur l'eau crevée De tes regards Sur ta bouche remblayée De terre à galets tes dents descellées Comme des silex sont-elles déjà à coudre Bord à bord le tissu du temps Et la langue des baisers que tu Glissais entre mes dents quel fruit Pourri, quelle poire blette C'est déjà » ; « le jus de ta chair abreuve les prés alentour ». Des passages superbes et éprouvants (oui, cette interview est un exercice d'admiration, on l'aura compris).
> L'impudeur, l'inavouable, l'obscène… C'est encore de la sensualité, non ?
Le poème est le nœud de toutes mes contradictions. J’ai déjà dit ça. Alors, au risque d’être ridicule, il ne me reste plus qu’à oser ce qui me semble une évidence : c’est une femme qui a inventé la poésie. C’est le geste d’Eve qui invente la poésie : dans un même mouvement il y a la transgression, le don d’où viendront le plaisir, la jouissance, l’ivresse (comme on veut) et le désir de vérité (le savoir). Et aussi, ce qui découlera de ce geste : l’impossible retour, le sentiment de la perte, le regret.
Notre monde ressemble si peu aux temps mythiques d’Eve qu’on pourrait le croire perdu à jamais le geste d’Eve, enfoui sous les épaisseurs sans nombre des matières sociales, mais dans maints endroits, instants, où ça craque un peu, etc. il reparaît le geste d’Eve. Dans toutes ses dimensions. Avec toutes ses conséquences.
Chercher sans cesse le geste d’Eve.
Je me rends compte que j’ai répondu à côté. Que je me suis arrangé une histoire pour éluder la question. C’est pas bien grave ?
> Non. En allant plus loin, est-ce que la poésie ne serait pas la place de l'impudeur, de l'inavouable ? N'est-ce pas ainsi qu'il est utile, le poème : en exprimant pour les autres, leurs mots imprononçables ?
Pour les autres ? C’est le mot « pour » qui ne me va pas trop. Je rêverais plutôt d’un « avec ». Mais il est vrai que les poèmes créent parfois (souvent) une gêne certaine. Ce dont on se défend par avance en transformant la poésie en amusement, en exploit, en moment de virtuosité, en truc brillant.
Il y aurait bien ce que dit Annie Ernaux dans La honte : « J'ai toujours eu envie d'écrire des livres dont il me soit ensuite impossible de parler, qui rendent le regard d'autrui insoutenable. Mais quelle honte pourrait m'apporter l'écriture d'un livre qui soit à la hauteur de ce que j'ai éprouvé… ? », mais puisqu’on a commencé par René Char, on pourrait finir avec lui, non ? « Ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égards ni patience ».*car Christian Degoutte est musicien (c'est précisé plus loin)
** Jérôme, compositeur vivant dans la région roannaise, complice de la compagnie NU.
Œuvres citées :
Comme si (Le Pré de l'Age)
Trois jours en été (éditions l'Escarbille)
Il y a des abeilles (édition Pré#Carré)
Des oranges sentimentales (éditions Gros Textes)
Henry Moore à Nantes (Wigwam)
Sous les feuilles (éditions P.i. sage intérieur)
Jour de congé (Thoba's éditions)
A huit et la petite foule ; Chanson pour Hautbois (éditions La Porte)
Ghost Notes (Potentille)
Au Toucher sa peau brille (Revue Voleur de Feu) -
3355
(Ce billet date de trois ans, je ne sais plus à quelle source j'avais emprunté le sujet de ce récit, j'ignore ce qu'il est advenu des protagonistes, mais compte tenu de l'actualité, j'espère que les choses, aujourd'hui, seraient différentes)
A 21 ans, il n’est pas impossible qu’une jeune femme un peu paumée, mal dans sa peau, se laisse aller à inviter chez elle un gars rencontré dans un bar. Chez elle, c’est-à-dire l’appartement où elle vit avec son bébé. C’est envisageable. Le gars peut éventuellement envisager, lui, qu’il va se passer des choses, que la soirée n’est pas finie. C’est possible. On ne saurait l’en blâmer. Qu’il s’imagine. C’est-à-dire que cela reste du domaine des projets, des fantasmes. Après un dernier verre, que le type fasse des avances. Bon. OK. Le type a vu tellement de films porno que ça lui semble la seule issue logique. C’est là que le problème se pose. Parce qu’il y a la réalité. La réalité, c’est que la jeune femme se dit « ça suffit ». Merci, au revoir, on n’est pas chez les bonobos. Que le type soit en colère, trouve ça dur, pourquoi pas ? Qu’est-ce que j’aurais fait ? « Je t’envoie des fleurs demain et on en reparle ? » Oui. Je crois que c’est ce que j’aurais fait. Sincèrement. Parce que j’aime qu’on garde une bonne image de moi. On peut envisager les fleurs et une fin de soirée dans un sourire. C’est envisageable.
Mais le type a frappé, frappé, violé, violé encore, frappé encore et laissé la fille pour morte, le bébé hurlant dans la pièce à côté. Le réflexe d’hommes qui pensent que quelque chose leur est dû, et qu’ils peuvent prendre ce droit si on le leur refuse. Évidemment, quand la jeune femme se rend au commissariat, on prend sa plainte en considération. Non. Je plaisante : on ne prend pas sa plainte en considération. La considération est du domaine de l’envisageable, du domaine de ce qui est possible. On ne prend pas sa plainte en considération, on lui balance qu’elle l’a bien cherché. Ils ont la description du type, le nom de l’agresseur, son numéro de téléphone et le bar où ils se sont rencontrés, mais ils ne feront rien.
Il y a quelques jours, la jeune femme s’est suicidée. 21 ans. 21 ans. Vingt-et-un ans ! Les policiers vont peut-être prendre sa plainte en considération. Le type va peut-être regretter son geste, et payer d’une manière ou d’une autre. Le bébé grandira et deviendra peut-être un adulte bien dans sa tête. Ce n’est pas impossible. C’est envisageable. -
3352
C'est vrai que j'aime plutôt les femmes féminines. Mais c'est que je n'aime la masculinité, ni chez les femmes, ni chez les hommes.
-
3349
Tous ces miracles galactiques, ces forces astronomiques, et nous, malgré la conscience que nous en avons, forcés de descendre les poubelles.
-
3342
Ce jour, je file à Saint-Etienne préparer avec les organisateurs la résidence d'auteur que je suis invité à vivre pendant deux mois : janvier et février prochains. Autour de moi, des partenaires, des amis, des connaissances, des écrivains aussi, pour faire de cette expérience une réussite. Impressionnant, agréable, retour dans cette ville que je connus étudiant, puis jeune homme démarrant dans la vie, auprès de sa future ex-femme. Je les vois d'ici, les souvenirs, se bousculer pour exiger que je les traite et les raconte. Mais non, Saint-Etienne ne sera pas le prétexte d'une nostalgie.
-
3335
Plusieurs lectures récentes m'ont proprement enthousiasmé. Elles sont, je l'avoue, d'auteurs que je connais, personnellement ou plus indirectement, et je ne peux empêcher personne de craindre ici les effets d'un éventuel copinage. Un paramètre qui pourrait également me rendre suspects les hommages des amis écrivains quand ils se fendent d'une chronique sur un de mes textes. Cependant, nous savons les uns et les autres que nous sommes assez idolâtres de la déesse-littérature, pour ne pas abandonner tout esprit critique quand il s'agit d'évoquer des livres d'amis. Il est possible que notre attention soit plus grande à les lire, ou que, pour dire notre plaisir, nous soyons plus gais, mais il est certain que jamais nous ne nous mettrons, ni les uns, ni les autres, à mentir. Autrement dit, ces derniers livres que j'ai aimés, je crois sincèrement en leur valeur, je sais qu'ils apporteront « quelque chose » à leurs lecteurs, je suis persuadé qu'ils sont très bons. Un aspect de cette question est la conséquence de l'amitié en littérature : quand on exerce sa discipline avec une certaine exigence, les relations se font naturellement avec des personnes qui partagent cette exigence. Inévitablement, on se trouve au contact avec des œuvres intéressantes, pour prendre le mot le plus minimal.
Je vous suggère donc trois belles publications, dans l'ordre de mes découvertes.
Au toucher, sa peau brille, de Christian Degoutte, dans le numéro de la revue Voleur de feu qui lui est consacré. Dans la veine de Ghost Notes, son opus précédent, une série d'images saisies au passage de ses déambulations, livrées avec amour et scrupule. Rien de nécessairement récent dans les scènes qui ont motivé ces courts textes, aucune apparition spectaculaire ou morbide, ces moments choisis sont restitués par l'écriture après de longs temps de sédimentation intime, quand l'image s'est en quelque sorte révélée à l'auteur, qu'il peut enfin la traduire et lui associer une musique ou une chanson, des morceaux de toutes époques et origines (Schubert, Ionatos, Duke Elington, Louis Sclavis, Bjork, etc.) Je reconnais mon peu de pertinence quand il s'agit de parler de poésie, aussi j'envisage d'interviewer Christian Degoutte sur ces derniers textes. Mon emploi du temps ces dernières semaines ne m'a pas permis d'y parvenir, mais promis, c'est toujours d'actualité. Physiquement, le recueil est un bel objet, au format confortable, et les textes de Christian sont accompagnés par de grandes gravures de Iris Miranda.
L'autre livre est celui d'une auteure dont on aura pu apprécier les textes précédents parus au Réalgar (ceux que je connais) : Noces incertaines, Chagrins d'argent et Se taire ou pas. Son dernier roman, Bavards comme un Fjord, semble d'ailleurs un prolongement de la réflexion menée par Isabelle Flaten dans l'opus précédent sur la parole empêchée volontairement ou non, les enjeux autour des choses tues, des choses dites, non dites ou mal dites. Je voudrais exprimer ici la constante jubilation procurée par cette lecture. Le cadre exotique pour un latin comme moi (un type qui reste au gîte, un latin de garenne, quoi) : la Norvège, ses paysages (décrits en quelques mots, mais décrits enfin, sensibles : une nouveauté dans mes lectures de cette auteure) et sa communauté, ses relations et coutumes, bien connues par Isabelle Flaten qui a vécu dans le pays ; la finesse de la psychologie des hommes et des femmes (mention spéciale pour la justesse des pensées intimes masculines !) ; la construction du récit qui circule entre les personnages, définit un cercle concentrique de plus en plus serré autour d'un événement marquant (Sigrid, la femme parfaite -et un peu chamboulée affectivement ces derniers temps- pense avoir renversé quelqu'un dans la nuit). Un régal de drôlerie, d'intelligence, d'élégance. Il n'y a bien eu qu'un détail à la fin pour m'inspirer une réserve, mais c'est un ressenti personnel, tout le livre est magistral.
Le troisième livre, (paru en avril dernier, j'ai du retard) est le premier roman de Maryse Vuillermet : Frontaliers pendulaires, les ouvriers du temps. Cette chercheuse à l'université Lumière Lyon 2, spécialiste de la représentation du travail, notamment ouvrier, dans la littérature romanesque, avait nourri notre imaginaire avec un récit qu'elle range elle-même dans la catégorie de l''autofiction : Naven, en 2010, et avec l'essai suivant, développement de Naven en quelque sorte, mêlant l'autobiographie à la reconstitution du destin des émigrés, immigrés, migrants, qui ont fait sa genèse : Pars ! Travaille !, en 2014. Ici, Maryse Vuillermet n'a pas tenté de s'approprier les arcanes et principes romanesques, et rejoindre ainsi la cohue des romanciers du réel. Elle a inventé ses propres solutions, frisant le documentaire, mêlant dialogues plaisants ou dérangeants et scènes vivement brossées, donnant généreusement à voir, à entendre, à s'inquiéter ou se réjouir. Maryse Vuillermet nous fait vivre chaque enjeu de vie de ses « ouvriers du temps ». Le livre suit plusieurs travailleurs frontaliers de la France vers la Suisse et retour, au cours d'une sorte de synthèse de toutes les journées, de tous les destins sur plusieurs saisons, à la manière dont une Julie Otsuka a pu raconter les trajectoires de ses japonaises dans Certaines n'avaient jamais vu la mer, mais sans le précieux artifice de l'accumulation des anonymats. Ici, chaque personne est nommée, approchée, comprise, chaque destin est inscrit dans son environnement économique, familial, social. Un horloger, un conducteur d'engin, une fille d'immigrés marocains, une épouse et mère de famille, etc. Bien sûr, l'universitaire est là, ses techniques d'investigations apportent tous les éléments qui feraient déjà un essai passionnant, mais ses héros et héroïnes sont vrais, proches, on les aime et les comprend. Les "pendulaires" sont lancés quotidiennement dans une marche quasi hypnotique vers le travail de l'autre côté du pays. Au delà d'une frontière impalpable. Même langue, mêmes paysages, le décalage est léger et pourtant, responsabilité identique, compétence égale, horaires similaires… Les salaires sont multipliés par deux, au bas mot. Qui résisterait ? La puissance d'attraction d'une telle offre commence à produire des effets au-delà des trente kilomètres qui furent la règle, avant Shengen. Certains commencent à se convaincre que, de Nantes ou de Bordeaux, venir chaque jour à Genève, et bien… Pourquoi pas ?
L'auteure nous décrit, avec une précision de monteur de haute horlogerie, les attentes, les aspirations, les angoisses, liées à la condition des travailleurs « pendulaires ». On apprend des milliers de choses, c’est passionnant. Les descriptions du travail vertigineux des horlogers de luxe, la façon dont l'auteur détaille leur recherche inconcevable de la perfection, parviennent à nous faire toucher du doigt l'amour fétichiste que de tels objets peuvent inspirer. Je dois avouer que je comprends à présent qu'on puisse mettre 300 000 euros dans une montre. C'est un des effets imprévus de la lecture du livre de Maryse Vuillermet. Chaque métier est traité avec la même attention scientifique, combinée à une égale affection humaine pour les êtres. Cet équilibre maîtrisé fait de ce texte un récit passionnant, humain et pédagogique à la fois. Bouleversant et riche d'enseignements. Dans les derniers chapitres, le rêve éveillé d'un des protagonistes donne à voir la fin apocalyptique du système. Un avertissement car, nous dit Maryse Vuillermet en épilogue, « l'histoire ne s'arrête jamais ». Au fil des parcours et des portraits, une certaine Suisse est dessinée, peu aimable avec ses immigrés, menaçante même, et c'est peut-être cela qui a compromis l'accès de Frontaliers pendulaires au prix Lettre-Frontières (attribué par des jurés suisses et français). A la lecture d'un livre aussi puissant et nécessaire, on ne peut qu'enrager d'une telle absence. Si c'est le cas, le Prix Lettre-Frontières, pour lequel j'ai une tendresse toute particulière, ne s'est pas grandi à cette occasion.
Au Toucher sa peau brille, Christian Degoutte. Revue Le voleur de Feu N°7, 2017. 26 pages. 15 €
Bavards comme un fjord, Isabelle Flaten. Editions Le Réalgar, 2017. 144 pages, 15 €
Frontaliers pendulaires, les ouvriers du temps, Maryse Vuillermet. La Rumeur libre, 2016. 256 pages, 20 € -
3324
On vient de m'interroger sur la clavette de Donnersberg. J'avoue que c'est une donnée assez lointaine pour moi, mais elle nous a permis dix bonnes minutes de discussion sur la notion de lacune.
-
3318
A force de jouer un rôle, la question de la vérité est posée. Dans cette famille de très bons comédiens, personne n'est certain de la sincérité des relations. Quand un membre veut éprouver un sentiment vrai, il l'imite avec assez de talent pour s'en convaincre lui-même. Quelle surprise quand ils découvrent que d'autres familles, des amateurs ceux-là, sont plus doués qu'eux !