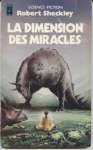 De Robert Sheckley (avec une vilaine couverture de Siudmak).
De Robert Sheckley (avec une vilaine couverture de Siudmak).
Ce livre a une histoire. Il y a fort longtemps, un jeune étudiant travaillait pendant l'été dans un Office HLM, balayait les cages d'escalier, chassait les rats de derrière les poubelles, dans le local ultime des vide-ordures à 6 heures du mat' (ça vous apprend la vie).
Bon, c'était moi, d'accord, on ne va pas poursuivre vainement sur le ton indirect. Dans une des poubelles pleines, je découvre, avec un ou deux San-Antonio, ce livre. A l'époque, gros lecteur de SF, je lisais beaucoup d'anglo-américains : Huxley, Wells, Asimov, Clarke, Herbert, Van Vogt, Bradbury, De Camp, Spinrad, Brunner, Bloch et King (plutôt fantastiques d'ailleurs), K. Jetter, K. Dick... mais je ne connaissais pas Sheckley.
Je découvre un ton neuf, drôle, un conte philosophique à la manière de Voltaire, mais avec l'invention délirante et non-sensique de l'école anglaise. L'histoire est celle du médiocre Carmody, bureaucrate fallot, seulement doué dans le pérorage philosophico-dérisoire, capable d'ergoter sur tout et n'importe quoi, de discourir à perte de vue sur n'importe quel sujet qu'il ne connaît pas. Bref, Carmody est diablement humain et fichtrement proche du gamin que j'étais, raisonneur et bavard (comment, toujours ?). Rentré chez lui, prêt à s'offrir un petit whisky dans son fauteuil, il assiste à la matérialisation d'un extra-terrestre venu lui annoncer qu'il vient de gagner au grand Sweepstake intergalactique, et qu'il doit venir avec lui au Centre y retirer son Prix. Carmody accepte. A l'autre bout de la galaxie, Carmody reçoit donc son Prix (et quel prix !), mais ensuite... personne n'a envisagé son retour à la maison. Comment ce petit factotum insignifiant va-t-il rentrer sur la Terre ? D'autant plus qu'il ne suffit pas de remettre les pieds sur la Terre "Où", c'est-à-dire la terre à l'endroit où elle se trouve, mais aussi la terre "Quand", c'est-à-dire au bon moment, et enfin la Terre "Quelle", la bonne terre, celle de Carmody. Et le temps presse : perdu dans l'espace, Carmody est poursuivi par un prédateur généré spontanément, selon la loi de l'Univers qui veut que toute créature possède son prédateur, dans le but exclusif de manger du Carmody. Une course contre la montre s'engage.
Ce livre, je l'ai lu à l'époque une bonne dizaine de fois. Ce qu'il disait du monde, ce qu'il disait de l'humanité, ce qu'il disait du destin, sous ses dehors d'aimable aventure, me touchait profondément. Surtout la fin. Et puis, un jour, je l'ai prêté, je ne sais même plus à qui. Le je-ne-sais-plus-qui ne me l'a jamais rendu. J'étais bien triste.
Il y a quelques mois, lors d'un festival de la SF, bien connu par chez nous, je retrouve "la dimension des miracles" sur l'étal d'un bouquiniste. Je soupçonne même, compte-tenu de certain pli, certaines usures singulières, qu'il pourrait s'agir du mien, revenu sous mes yeux au terme d'un périple indicible. Je l'ai donc acheté et relu, à haute-voix, pour la délectation de ma douce. J'ai retrouvé Carmody, l'ai découvert plus bavard que je ne pensais, mais l'émotion était toujours là.
je n'ai jamais rien lu d'autre de cet auteur, redoutant qu'il ne se répète dans ses autres livres.
 La collaboration Cronenberg/Mortensen semble promise à un certain avenir, vu les deux dernières réalisations du cinéaste canadien. Moins dérangeant que l’opus précédent (History of violence, dont j’avais largement parlé dans une version précédente de Kronix) et la plupart des films de Cronenberg, « Les promesses de l’ombre » laisse pourtant, après la vision de ce qu’on croit être seulement un bon thriller mâtiné de film noir, une sensation indicible, un écœurement discret*. L’impression n’est probablement pas due qu’aux scènes violentes et sanglantes, coutumières chez le réalisateur de « la Mouche » ou « Crash », mais à une sorte de mystère qui résiste à la première vision.
La collaboration Cronenberg/Mortensen semble promise à un certain avenir, vu les deux dernières réalisations du cinéaste canadien. Moins dérangeant que l’opus précédent (History of violence, dont j’avais largement parlé dans une version précédente de Kronix) et la plupart des films de Cronenberg, « Les promesses de l’ombre » laisse pourtant, après la vision de ce qu’on croit être seulement un bon thriller mâtiné de film noir, une sensation indicible, un écœurement discret*. L’impression n’est probablement pas due qu’aux scènes violentes et sanglantes, coutumières chez le réalisateur de « la Mouche » ou « Crash », mais à une sorte de mystère qui résiste à la première vision.
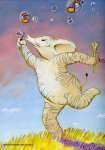
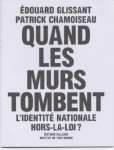 Par les temps qui... courent, les journalistes engagés (on entrouve) se révèlent et considèrent comme un devoir d'alerter une opinion publique bien atone. Edouard Glissant et Patrick Chamoiseau ont commis cet opuscule, publié par les éditions Galaade, pour rappeler que, tandis que nous nous inquiétons de notre pouvoir d'achat, la sinistre entreprise xénophobe de Machin se poursuit, avec tests ADN, murs politiques et policiers, ministère mêlant immigration et identité nationale.
Par les temps qui... courent, les journalistes engagés (on entrouve) se révèlent et considèrent comme un devoir d'alerter une opinion publique bien atone. Edouard Glissant et Patrick Chamoiseau ont commis cet opuscule, publié par les éditions Galaade, pour rappeler que, tandis que nous nous inquiétons de notre pouvoir d'achat, la sinistre entreprise xénophobe de Machin se poursuit, avec tests ADN, murs politiques et policiers, ministère mêlant immigration et identité nationale.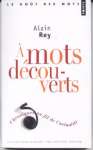
 Nous étions à une conférence donnée par Marek Halter à propos de son dernier livre. De "Je me suis réveillé en colère", je ne dirai rien, ne l'ayant pas lu ; de la conférence, pas grand chose : l'ensemble était savoureux, mais j'attendais des sommets d'intelligence et de culture, tandis que j'ai seulement agréablement voyagé sur des reliefs à peine soulignés. C'était bien, pourtant. Mais je me demande si Halter n'a pas tellement l'habitude de se mettre à la portée de ce qu'il pense être le niveau général, qu'il n'ose trop élever le débat. Je me disais cela, quand sont arrivées les questions : "Ne trouvez-vous pas que le français se perd, la syntaxe, le vocabulaire, la prononciation?" (une blonde bougeoise, inconnue des rayons de la médiathèque où se déroulait la rencontre), et l'écrivain de devoir expliquer que le français est une langue vivante, qu'elle change, bouscule, transforme, que Rabelais aujourd'hui doit être traduit pour être lu, etc., autant de mises au point qu'il est presque embarrassant de faire. Question suivante : "Croyez-vous que les orientaux soient faits pour la démocratie ?", là, Marek Halter est nuancé, la rengaine de la démocratie occidentale comme modèle imparfait qu'on tente par la force d'imposer à des populations qui ne demandent qu'à conserver leurs bons vieux rois et dictateurs, parce que "c'est dans leur tradition" pointe son nez un moment. Je m'agace, mais je sens un murmure consentant dans la salle. Encore une question ?, une question d'un grand barbu habillé en bûcheron : "Le Coran n'est-il pas l'ennemi de la science, vu que les musulmans n'ont rien apporté au monde depuis mille ans ?"... Oui, je comprends pourquoi Marek Halter est obligé de s'exprimer de façon point trop pointue pour ê-tre com-pris par ses au-di-teurs. Il ne reviendra donc pas sur l'algèbre, les algorithmes,
Nous étions à une conférence donnée par Marek Halter à propos de son dernier livre. De "Je me suis réveillé en colère", je ne dirai rien, ne l'ayant pas lu ; de la conférence, pas grand chose : l'ensemble était savoureux, mais j'attendais des sommets d'intelligence et de culture, tandis que j'ai seulement agréablement voyagé sur des reliefs à peine soulignés. C'était bien, pourtant. Mais je me demande si Halter n'a pas tellement l'habitude de se mettre à la portée de ce qu'il pense être le niveau général, qu'il n'ose trop élever le débat. Je me disais cela, quand sont arrivées les questions : "Ne trouvez-vous pas que le français se perd, la syntaxe, le vocabulaire, la prononciation?" (une blonde bougeoise, inconnue des rayons de la médiathèque où se déroulait la rencontre), et l'écrivain de devoir expliquer que le français est une langue vivante, qu'elle change, bouscule, transforme, que Rabelais aujourd'hui doit être traduit pour être lu, etc., autant de mises au point qu'il est presque embarrassant de faire. Question suivante : "Croyez-vous que les orientaux soient faits pour la démocratie ?", là, Marek Halter est nuancé, la rengaine de la démocratie occidentale comme modèle imparfait qu'on tente par la force d'imposer à des populations qui ne demandent qu'à conserver leurs bons vieux rois et dictateurs, parce que "c'est dans leur tradition" pointe son nez un moment. Je m'agace, mais je sens un murmure consentant dans la salle. Encore une question ?, une question d'un grand barbu habillé en bûcheron : "Le Coran n'est-il pas l'ennemi de la science, vu que les musulmans n'ont rien apporté au monde depuis mille ans ?"... Oui, je comprends pourquoi Marek Halter est obligé de s'exprimer de façon point trop pointue pour ê-tre com-pris par ses au-di-teurs. Il ne reviendra donc pas sur l'algèbre, les algorithmes, 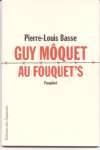 Pierre-Louis Basse, quand il évoque Guy Môquet, lui, connaît son sujet, il a écrit "Guy Môquet, une enfance fusillée", et a subi un choc quand il a entendu la parole du jeune homme dont il avait travaillé la biographie, utilisée, dévoyée, vulgarisée, détournée, à des fins politiciennes.
Pierre-Louis Basse, quand il évoque Guy Môquet, lui, connaît son sujet, il a écrit "Guy Môquet, une enfance fusillée", et a subi un choc quand il a entendu la parole du jeune homme dont il avait travaillé la biographie, utilisée, dévoyée, vulgarisée, détournée, à des fins politiciennes.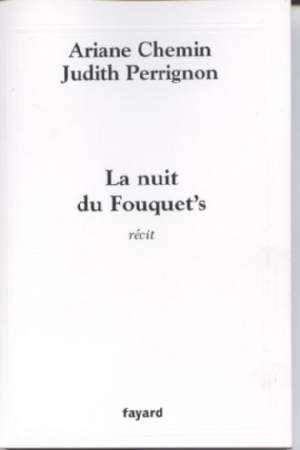 par Ariane Chemin et Judith Perrignon.
par Ariane Chemin et Judith Perrignon.